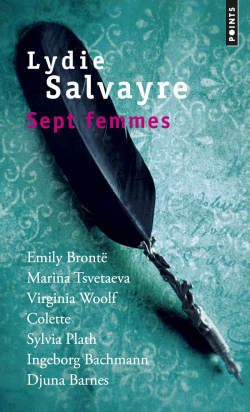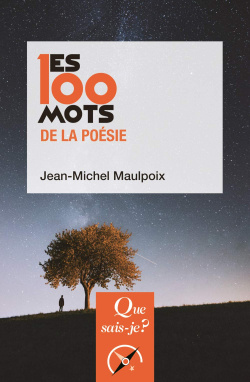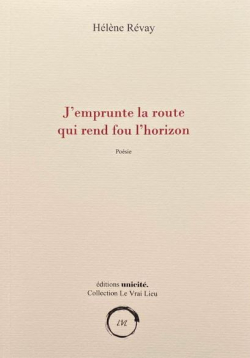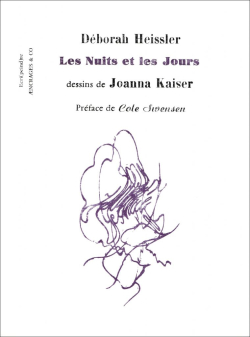« C’EST DE VIVRE QUE JE PARLE »
« Une histoire passera ici ». Tel est le titre d’un précédent recueil d’Ariane Dreyfus, édité en 1999 dans la collection Poésie/Flammarion. Ce titre pourrait aussi bien être celui de son dernier opus : Sophie ou la vie élastique. Ici, une histoire passe en effet : celle de Sophie de Réan, héroïne malheureuse de la comtesse de Ségur. Et c’est peut-être aussi un peu l’histoire d’Ariane Dreyfus qui se dit/se lit ici en filigrane.
La poète au long cours aime à revisiter les histoires d’enfance, les histoires de l’enfance. Les westerns de John Ford (Une histoire passera ici), Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur pour Sophie ou la vie élastique. Conter est pour elle de la plus haute importance. Il arrive ainsi qu’un personnage vienne « se heurter à nous, qui sommes déjà en morceaux », confie Ariane Dreyfus sur la quatrième de couverture de son dernier recueil, Sophie ou la vie élastique, que viennent de publier les éditions du Castor Astral. La vie, semble-t-il, n’épargne pas. N’épargne personne. Elle atteint toujours son but, la mort. Entre les deux extrêmes, elle s’étire, joue avec les uns les autres, écrivains et personnages, animaux aussi et « presque vivants », comme la poupée aimée et meurtrie de Sophie, malmenée par sa jeune maîtresse. La vie joue à l’élastique et Sophie joue avec elle. Le fil tantôt s’étire et lâche du lest, tantôt se rétracte et c’est alors la mort qui se profile. Les quarante-six poèmes du recueil ravivent la mémoire effacée de l’histoire de Sophie.
Sous la plume ailée d’Ariane, des épisodes oubliés refont surface, comme autant de ramures tendues auxquelles s’arrimer ; refont aussi surface les personnages qui animent le monde de Sophie. Ses cousines, Camille et Madeleine ; son cousin Paul. « Ce sont des enfants qui font attention à la vie », écrit la poète dans « [n]on pas le dernier, mais le seul jour» ; Madame de Réan, fragile et aimante, désespérée ; et son autoritaire époux (pas vraiment sympathique !). Madame de Fleurville… et quelques protagonistes occasionnels. Le plus étonnant est de retrouver sous la version poétisée du roman de la comtesse de Ségur, l’enchantement que celui-ci avait déclenché quand nous lisions avec nos yeux d’enfant. Quand Sophie nous faisait passer du rire aux larmes. Et que pleuvaient les punitions.
Est-ce à dire qu’Ariane Dreyfus, par la magie de ses mots, restitue cette part d’enfance qui gît encore en nous ? Rébellions, bêtises et impertinences. Pour ce qui me concerne, je pense bien que oui. Tel est aussi le talent de la poète. Raviver ce plaisir. Autant saisir au passage les branches qu’elle nous tend dans ce nouveau recueil. Car c’est de vivre qu’elle parle. Et que, comme l’écrit Eugène Guillevic cité en exergue :
« On ne sait jamais
Ce que fera la branche
la prochaine fois. »
C’est bien de vivre que la poète parle. Même si la mort est partout présente dans la vie de Sophie. C’est parfois la petite fille qui l’occasionne, par maladresse, par naïveté ou par inconscience. Par enfantine cruauté aussi. Il y a les morts ordinaires, la mort de la « poule déplumée » — qui ouvre le cortège animalier —, celle de l’écureuil, celle des poissons (un épisode savoureux !) ; celle, impressionnante, du cheval et celle des bébés hérissons. Il faut bien, pour que le récit progresse, que les uns vivent et que d’autres meurent en cours de chemin. Comme dans la vraie vie. Dans Sophie ou la vie élastique, un seul animal échappe à la mise à mort. Une araignée, suspendue à son fil, qui se balance par trois fois et laisse sa trace dans le tremblé de la page. Il y a les morts qui marquent plus profondément Sophie, celle de la poupée de cire martyrisée dépecée fondue noyée soumise à enterrements et à résurrections ; et celle, autrement tragique, de Madame de Réan – « La mère s’est perdue dans la mer » – qui frappe l’enfant de plein fouet dans ce qu’elle a de plus cher au monde :
« Plus de berceuse pour se poser sur elle
Maman est un mot qui a trop voyagé »
(« L’autre voiture »).
Et voilà Sophie orpheline confiée à une étrangère qu’elle devra désormais nommer du nom de « Maman ». La mort est pour l’enfant une expérience continue et multiple. Mystérieuse aussi et incompréhensible la disparition : « – Où l’emmenez-vous ? Demain, il sera vivant ? », interroge Sophie qui s’inquiète du devenir de « l’animal mort ».
Mais Sophie connaît d’instinct l’art de rebondir dans la vie. Elle rebondit toujours sur les interrogations qui se posent sur son chemin, et c’est toujours à partir d’images simples et réconfortantes. En atteste cette nouvelle façon, un brin détournée, de moduler le carpe diem d’Horace :
« Que nous reste-t-il aujourd’hui que nous n’aurons pas demain ? »
La réponse, apaisante, est suggérée dans les deux vers suivants :
« La vieille chatte dort sur elle-même
La tête déjà posée sur l’herbe »
(« Le cadeau »).
Inventive, toujours prompte à se tirer d’affaires par une pirouette, sautant à cloche-pied par-dessus les obstacles et tirant la langue, Sophie brave les interdits. Elle collectionne bêtises et punitions. Soumise à la fessée, recluse au pain sec et à l’eau, elle s’enfuit de sa chambre et bat la campagne alentour. Sa vengeance ? Une frayeur terrible qui met Madame de Réan aux cents coups et lui arrache un « cri de bête ». Lequel sera suivi d’une profusion de baisers fous lorsque Sophie sera retrouvée saine et sauve. Frayeur extrême qui fait prendre conscience à la jeune maman qu’« il y a pire que partir ».
Sophie a ses formules à elle qui sont paroles de poète.
« La peur marche plus lentement que le plaisir ».
Ou bien :
« Possible suffira toujours ».
Ou encore celle-ci, très caractéristique de l’écriture de la poète :
« Une culbute éteint une flamme, le jeu est de faire le noir
Une par une ».
Ariane Dreyfus prête à Sophie de Réan sa philosophie de vie : « un pied dans le sol, un pied dans le vide ». Leçon que la poète tient de Jean Cocteau, à qui elle dédie son recueil. « À Jean Cocteau, qui m’a appris à marcher un pied dans le sol, un pied dans le vide ».
Ainsi la vie de Sophie et celle de la poète s’accordent-elles dans une même claudication. On doit à l’héritage de la lointaine lutte biblique de Jacob avec l’Ange, une longue généalogie de boiteries. Des boiteries que l’on retrouve dans la conception toute personnelle qu’Ariane Dreyfus met en pratique dans sa poésie. Boiteries briseuses de rythmes et de rimes. Briseuses de formes convenues. D’où sans doute l’hésitation (consentie) entre prose et poésie. Entre récit (avec dialogues) et poème. Entre « le réel et l’imaginé » qui, dans l’interstice, ménagent « la place du mot ».
Alternances discordantes aussi entre malheurs et plaisirs, sans cesse en déphasage dans la vie. Ce qui compte, c’est de faire que le plaisir l’emporte :
« Les malheurs, les casser en petits morceaux
En trois, en quatre, tout de suite en dix
*
Le plaisir de courir sur le chemin crissant ! ».
Hésitations jusque dans la formulation. Ainsi du poème d’ouverture « Sans crier » où l’on peut lire :
« J’hésite, je te regarde, chemin qui ouvre le parc
Tu es si pâle,
*
En deux, qui écarte le parc
J’hésite, je regarde »
(« Sans crier »).
C’est qu’Ariane Dreyfus s’y entend dans l’art de pratiquer la disjonction, comme dans ces vers exemplaires :
« Le revoici encore solitaire
Le temps de tendre vers la lune ses yeux gonflés
Et de, hissé sur ses pattes ou ses mains, se laisser tomber
Pour une brasse parfaite dans la mare du soir »
(« Un dernier acte »).
Ou dans l’art de pratiquer le déhanchement du vers en bousculant l’ordre usuel des mots. Cet écart qui, à la lecture, surprend et met cette dernière en suspens, qui suscite parfois la polysémie et l’interrogation :
« une presque personne »
[…]
« la toute fontaine joliment jaillissante »
(« Le cadeau »).
Ou encore :
« Relevées, des presque mains griffues se touchent
Inertes »
(« Demain non plus »).
Au détour d’une strophe, il arrive qu’on se laisse surprendre par un zeugma inattendu et savoureux :
« Sophie, bouche ouverte, se penche en arrière
Pour la suivre des yeux et le plaisir
De se balancer sur sa chaise
Fort et parfois moins fort »
(« Les malles ouvertes »).
Ou encore par cet autre :
« Pendant qu’elle a mal
Paul la dépasse au galop et en chemise blanche
On le perd lui aussi »
(« J’avais faim»).
La disjonction principale de Sophie ou la vie élastique me semble résider dans la présence inattendue d’un poème bien particulier, intitulé « En travers du lit ». Un poème qui se démarque de l’ensemble. Sans allusion aucune à Sophie. Une sorte d’écart d’écriture que ce poème identifiable par ses strophes. Des strophes inégales (3, 4 ou 5 vers), dans lesquelles reviennent à l’identique certains vers : « tel un jeune peuple d’une nature nouvelle » ; « la seule note de leur rouge ». Dès la seconde strophe, Ariane Dreyfus y multiplie les pas de côtés, bousculant inlassablement l’ordre des mots et des vers. Jouant avec les variations, les unes infimes, passant presque inaperçues, les autres plus franches. Un poème qui pourrait s’apparenter au pantoun malais. Un pantoun baroque, fondé sur des irrégularités. La poète y entrelace deux thèmes majeurs, celui d’un personnage masculin dont l’identité n’est pas donnée : « il y a devant lui de très nombreuses fleurs » et celui de « la nature nouvelle » assimilée à « un jeune peuple ». Le retour, d’un vers à l’autre, d’expressions quasi similaires, crée la surprise en même temps que cette sensation mystérieuse d’enroulement caractéristique de la vague qui roule sur elle-même, à la fois autre et pareille. Ce poème est introduit par une phrase en italiques : « Quand il arrive » et se clôt par cette autre : « C’est arrivé en dormant ». Est-ce rêve du lion de pierre entouré des « fleurs aux tiges serrées » ? Ces fleurs qui « jaillissent contre sa main de tout leur rouge », rendant vivant le morne animal. Peut-être. Mais c’est sans doute aussi un poème écrit en hommage au peintre Marc Feld à qui l’on doit le très beau dessin de couverture, Une pensée rouge, dédié au poète Thierry Metz.
De même qu’Ariane Dreyfus a dans sa malle aux trésors nombre de poètes et d’artistes qu’elle tient à portée de plume — l’ami de Pasolini, Sandro Penna, qu’elle cite à de nombreuses reprises —, Colette, Cocteau, Guillevic, Dickens, Yora Buson, Denise Levertov, Thierry Metz, Marc Feld… et Christophe Honoré pour son film Les Malheurs de Sophie (2006) sans lequel, dit-elle, « ce livre n’existerait pas », Sophie tient à sa disposition, comme dans les contes, nombre d’objets fétiches dont elle se sert pour se livrer à ses multiples expériences. La poupée, bien sûr, qu’elle soumet à de bien rudes épreuves et ce « charmant couteau ». « Son cher et vrai couteau ». C’est grâce à cet attribut indispensable que Sophie peut mener jusqu’à son terme l’expérimentation de son pouvoir de magicienne. Et de son pouvoir sur les autres enfants :
« Sorti de l’étagère, du blanc de Meudon
Sophie frotte avec son couteau
De quoi faire que l’eau soit crémeuse
Et pose le couvercle sur le pot de crème
Les morceaux de craie sont carrés
Donc c’est déjà du sucre dans le sucrier
[…]
« Vous n’avez plus qu’à boire c’est très bon »
(« Les mots et les choses »).
Les refus des cousins devant les exigences de Sophie engendrent sa colère. Et l’expérience s’achève en pugilat. Et engendre aussi un désarroi partagé face à ce qui résiste à être nommé.
« Deux corps tombent
Engloutis dans le tumulte de ce qu’ils ne peuvent
Nommer »
(« Les mots et les choses »).
Le cher petit couteau, « cet objet qui fait tout », intervient par deux fois dans l’épisode des cerises. Près du cerisier, un lion de pierre. Le lion a bon dos. Mais il semble inerte. Comment le ramener à la vie ? Grâce aux cerises, si rondes si rouges si dodues. Sophie s’applique à en couper une en deux : « ça peut faire des yeux ! ». Aussitôt dit aussitôt fait :
« Le lion soudain réveillé
Ouvre des yeux vraiment humides »
(« Un objet qui fait tout »).
Un peu plus loin, variation sur le même thème, dans « Souvenir inversé » : en cinq vers, le lion devenu féroce, gueule ouverte, se voit affublé d’une cerise entière par œil ! Une manière de le dompter et de le soumettre en l’obligeant à « fermer ses yeux ».
Sophie adoptée par Madame de Fleurville abandonnera finalement poupée et lion de pierre à leur vie immobile. « Tu sais je vais partir loin de toi », confie-t-elle au « lion gris et usé » (« Le dernier jour avant le premier »). Et à la poupée :
« Je ne vais pas te prendre avec moi,
Tu vas rester là pour
toujours, pour toujours
Je suis très légère, je ne suis pas morte comme toi, moi ! »
(« Naguère »).
L’optimisme réjouissant de Sophie l’emporte sur la mort.
« Je sais ce que j’ai vécu
et que je vivrai encore ».
Tels sont les derniers mots de l’enfant, en écho à ceux du très beau poème de Denise Levertov qu’ouvrent ces deux premiers vers :
« Me comprenez-vous bien ?
C’est de vivre que je parle… ».
L’air de rien, sous les dehors d’un simple récit de l’enfance, Ariane Dreyfus ouvre toutes grandes les portes de son monde intérieur. Un univers riche et complexe dont elle restitue par touches le substrat profond. Culturel, sensible, humain.
Dans Sophie ou la vie élastique, Ariane Dreyfus déploie, avec cette belle simplicité qui fonde sa personne, l’éventail de son talent poétique. Un talent enjoué, coloré et dansant. Vivante, Ariane Dreyfus, tellement ! Et qui entraîne dans son sillage tous ceux et toutes celles qui, comme elle, ont une soif brûlante de vivre.
Angèle Paoli
D.R. Texte angèlepaoli

|