
Jiri Vortruba, Um Kalthum, 2007,
acrylique sur impression numérique, 45,5 x 65,5 cm
Source
ODE À OUM KALTHOUM
Al aoud malouf Oum
Kalthoum chante
toute la tessiture du luth hante
l’âme-foule jusqu’à l’extase.
Son corps drape le bois et l’ouïe
l’orient Kalthoum toute
enchante syllabes au cœur-oud
la gamme orientale éclate
sanglots ourlés brodés jusqu’
Oum orne le temps.
Depuis longtemps l’oud,
l’ancêtre oud :
de la tombe de Pharaon
à la Chanson de Roland,
al aoud taqsim ud
chevillier renversé en arrière
table percée de trois roses
demi poire profonde –
maqâm taqasim El Sett Oum
Kalsoum tarab chante !
Chanteuse Oum ancêtre oud,
oud et Oum,
omeyyades aux longues cordes libres,
se mesurent se récitent
le plus ancien chant du désert,
nouba de suites larges perpétuées
modulations inlassables hanches,
se mesurent au temps :
Oum orne oud ordonne
le temps.
Oum Kalthoum orne le temps
andalouse sans quitter le Caire,
femme récite le plus ancien désir :
voix moire, soie blanche, foulard
heurte cascade le rythme d’étoffes
touffeur, odeur des sons, ardue
gorge sculpte accorde les mots
souffle fleuve, ardeur des sens, art du
ouï, bois, ancêtre, bleu
tarab !
Modulations inlassables hanches
nouba de suites larges, perpétuées
simple ou double plectre pince
oud ordonne Oum ourle corde
bourdonne, Kalsoum hausse
chante le temps.
Al-salâm muezzin foule
cantillations dans les mosquées
ardeur du sens se fond Allah
seule voix d’homme, nul oud
appel Allah prière de bien
psalmodier, narrer, minaret,
sauf Oum, déguisée en garçon
dans les mosquées par le père.
Longtemps, l’enfant Oum
a psalmodié longtemps psalmodié
Oum d’abord grimée en garçon
bédouin…
Fatima Ibrahim la petite
fille aux joues rebondies,
petite fille au koutab
l’école est coranique
imam papa chante
mariages, cérémonies, petite ville
du delta du Nil.
Longtemps l’enfant Oum
psalmodie longtemps psalmodie Oum
comme son frère psalmodie
déguisée en garçon l’enfant Oum
fille pourtant, mieux que son frère,
chante
dans les mosquées par le père.
Chansons du père
ce chant son père,
ce que chantait son père, elle le chant
que chantait son père la fille
le chantait.
Le perroquet du père
dit-elle
de la petite fille de la voix
prêtresse
ou des oiseaux.
Le père était gêné que la fille
surnommée la petite fille
à la voix puissante sa fille
sa fille devant des hommes qu’il ne connaissait pas
chante
enchante Oum fille déjà
charme son temps.
Rien qu’un regard
un regard et Oum
ouvrent la mélodie des égyptiens
disent : musique
les égyptiens disent musique muette
la musique sans le chant
d’Egypte le chant
est la musique.
Sur un gramophone
la première fois qu’Oum
Kalsoum entend
sa voix.
Poème qu’elle chante
commençait chanson
se répétait phrase dix fois douze fois
se décalait subtilement improvisait
devenait transe
devenait théâtre.
Ode à oud, oud à Oum
oud à l’âme à l’astre nommant
la mer, le fleuve, l’enfant du delta
son chant trouve le temps
secoue l’espoir entre Cordoue et ciel
du Bosphore au gramophone
inaugure en 1934 la première émission
de la radio nationale
voix d’Oum tachetée blanche, joie glotte
le Nil cadence les grands soirs
de Castille, Bagdad, Istanbul,
Tripoli, Rabat, Agadir, Gaza
de partout Yasmine adorne les grottes
mourhalef, lèvres gercées, Sahel
Hatchepsout erre sans visa
son visage – martelé
Yasmine, fatma, Nasser, Nil, El Sadate…
Babouche oud Isis sise,
enchante l’ouïe l’oasis-Oum
al-salâm ‘alaykum
Ell Sett Oum Kalsoum !
Sylvie Nève
texte inédit pour Terres de femmes (D.R.)





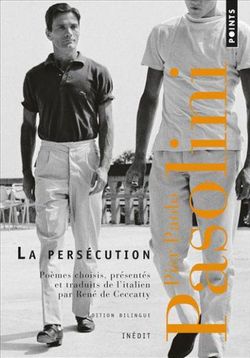

![H.D., Hymen, The Egoist Press, London, 1921 [First Edition] H.D.,Hymen](/wp-content/uploads/2025/09/6a00d8345167db69e201b7c7122dfb970b-250wi.jpg)
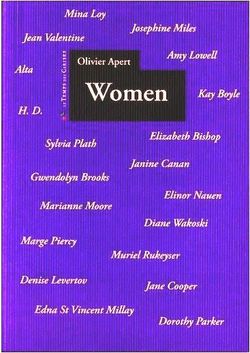


![Ghislaine Amon [Raphaële George], hiver 1973 Ghislaine 2](/wp-content/uploads/2025/09/6a00d8345167db69e201bb07b5837e970d-200wi.jpg)
![[Ph. Dayanita et Noni Singh] and I pick | up her lovely | dress, | all her loveliness gone Daynmita Sing](/wp-content/uploads/2025/09/6a00d8345167db69e201b8d08ff16a970c-300wi.jpg)




