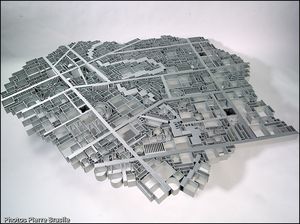Il y a quarante ans, le
26 septembre 1973, décédait à Rome l’actrice italienne
Anna Magnani.

Image, G.AdC
DOULEURS DE LANGUE | DOULEURS DE CORPS
(lecture de La Langue d’Anna de Bernard Noël, par Angèle Paoli)
Elle parle. Elle jette sa vie sur sa langue. Elle a toujours voulu tout et tout de suite. Elle est une comédienne célèbre. Elle a beaucoup parlé avec les mots des autres. Elle n’avait pas le temps de sa propre vie, mais voilà que son corps l’a rattrapée, l’a même doublée. Elle met du passé dans ce présent trop mortel. Elle appelle ses amis : Fellini, Pasolini, Visconti. Elle sait qu’il est trop tard. Elle ne s’y résigne pas. Elle ne s’est jamais résignée.
Bernard Noël, La Langue d’Anna (roman), « Quatrième de couverture », P.O.L, 1998.
Il y a pulsion vers, élan irrépressible vers, qui pousse à la rencontre. Rencontre de Bernard Noël avec l’autre, l’absente que la langue du poète va rendre présente, omniprésente. Illusoirement. Rencontre de la lectrice avec Anna et en contrepoint, avec le poète. Rencontre avec deux langues, en chassé-croisé et en surimpression. Langue d’un homme, entrelacée (enlacée) à la langue ― parlée ? imaginée ? pythique ? ― d’une femme. Le temps qu’opère la magie d’une écriture, stratégies et mensonges, propres à donner l’illusion de la vérité. Envers et endroit d’un même miroir bifrons. Le temps que dure la lecture de La Langue d’Anna, roman de Bernard Noël, l’adéquation se produit. Parfaite. Il y a imprégnation et appropriation. Symbiose. Avec ce « je » que Bernard Noël a choisi pour elle, ce « je » non autobiographique qui est celui de son personnage inextricablement combiné à celui de sa personne. À elle, Anna. Ce « je » qui traverse de part en part le roman d’une vie, jusqu’à la maladie et jusqu’à la mort ; et à travers lequel elle, Anna, parle, se dit, se raconte, elle, ses amours, ses délires et ses combats, ses contradictions. Et s’interroge sans fin : « Qui suis-je ? » « Je ne suis pas celle que vous croyez. » Leitmotiv obsédant qui rythme jusqu’au vertige le texte de La Langue d’Anna.
Je sais que je me contredis : je ne suis pas celle que vous croyez, et je la suis, et je ne la suis pas dans la mesure où je me vois l’être, et tant pis si j’ai l’air d’embrouiller l’écheveau que je me proposais de démêler.
De quelle identité est-elle faite ? Quel visage introuvable se cache désormais sous les masques multiples de son personnage ? Qui est-elle, sinon « une espèce d’hydre agitant les mille têtes qui furent d’autant plus » les siennes « qu’aucune ne l’était vraiment » ?
Et pourtant, c’est elle, celle que nous connaissons tous, que nous avons aimée à travers les images que l’écran du cinéma nous a données d’elle. Reconnaissable entre mille femmes, mille actrices du cinéma italien, elle est Anna. Anna Magnani, la grande, la Diva, la divine. Elle est Anna la furieuse, la déchaînée, la débordante, la braillarde. La harpie. La gouailleuse et truculente mère du jeune Ettore, dans l’inoubliable scène de mariage de Mamma Roma (1962) de Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo, qui la comprend et qui l’aime, même si la Magnani ne correspond pas tout à fait à son esthétique cinématographique. Pier Paolo, pour qui Anna nourrit une tendresse particulière. Elle est l’excessive. De tempérament et d’énergie, de trop de nez trop de chair trop de seins, de trop de. Elle est « l’excessive pour faire rire ou pour faire pleurer. » Celle dont Federico Fellini aurait déclaré : « Je ne peux pas te mettre dans mes images, tu les ferais déborder. » Elle est celle que Roberto Rossellini n’aimait que pour avoir aperçu en elle le personnage qu’il cherchait. Roma città aperta. Rome ville ouverte. 1945. Le coup d’éclat de l’actrice. Son sommet inoubliable qui la propulse au zénith et fait d’elle l’égérie du néo-réalisme italien. Nimbée de cette « couronne de douleur », « cette douleur ensanglantée », cette « douleur du monde » que l’actrice joue jusqu’à l’excès « pour en délier les spectateurs » et pour « expectorer » la sienne. Elle est la Magnani, prise dans le vertige d’une beauté construite de toute pièce, sublime beauté qui a relégué la laideur et la vulgarité ordinaire de la misère sous le tain du miroir, au fond du trou de la mémoire pour laisser émerger l’autre, l’éclatante dont la blancheur de la peau et les yeux de braise émeuvent autant que sa tignasse effarouchée et son cul ! Moulé dans l’étau de sa robe. La robe noire, mélange de dernier cri et de mode éternelle des paysannes de Ciocciara. Femme du peuple et symbole de la tragique exubérance de Rome pendant la Libération, elle est Anna. La Magnanime.
De l’autre côté de l’écran, côté page blanche et stylo plume, il y a Bernard Noël, écrivain et poète, un grand, un très grand. L’un des plus grands de ce temps. Le plus grand peut-être. Pourquoi Bernard Noël a-t-il choisi, parmi tant d’autres icônes, cette femme-là, cette actrice-là pour fixer sa fiction romanesque ? Question récurrente dont la lecture du « roman » de La Langue d’Anna ne livre pas explicitement la réponse. Et la lectrice d’interroger sans relâche l’entremêlement de l’un avec l’autre. Il s’agit sans doute, chez le poète, de l’une de ces nombreuses variations sur l’écriture comme « lieu de la quête ». Quête inlassable, toujours recommencée, du moi et de l’identité. « Qui suis-je » ? « Qui suis-je quand je parle ? Qui suis-je quand j’écoute ? » interroge le poète dans Une Messe blanche (1972). « Qui suis-je ? » reprend en écho Anna. Qui ajoute :
dans le patois de ma banlieue […] ça n’était pas une interrogation philosophique mais une exclamation d’étonnement.
Auteur polygraphe, mais avant tout poète, Bernard Noël est l’auteur de quatre monologues « gouvernés par les pronoms personnels ». Le Syndrome de Gramsci (1994), La Maladie de la chair (1995), La Langue d’Anna (1998) et La Maladie du sens (2001). Dans chacun de ces monologues, l’auteur fait le choix d’un pronom personnel dominant. Dans le troisième monologue, le pronom personnel « Je » donne la parole à Anna Magnani. La Langue d’Anna (1998).
l’autre est un sosie de moi
même cicatrice
confie Bernard Noël dans Tombeau de pierre. Peut-être dans cette cicatrice, cette autre s’insinue-t-elle, langue et corps, bouche et voix, sang et lymphe, viande et ventre, identité duplice, jusque sous la langue du poète, dans son être d’écriture et de chair ? Quelle est, dans La Langue d’Anna, la part de l’un la part de l’autre ? Par quels interstices de l’écriture se fait la pénétration de l’autre vers l’un ? Le poète n’est-il qu’« un simple porte-voix » à celle qui déclare ne pas savoir écrire ? La langue d’Anna « n’est pas faite pour le papier ». La langue d’Anna est celle du corps, un corps qui la déborde et attise sur elle la langue du désir et du sexe. Langue de l’amant d’une nuit, révélatrice d’un corps partagé en son milieu par une « plaie puante ». Qu’il a fallu apprivoiser pourtant, pour pouvoir se reconstruire. Langue apaisante, plus tard, réconciliatrice, de l’amant Rossellini, langue de la découverte de l’amour et de la jouissance :
J’ai déjà sa langue dans mon horreur, et voilà qu’au lieu de me révulser, elle me réconcilie. Je suis lustrée. Je ne sais d’où me vient ce mot. Je le murmure dans ma gorge et mon corps s’éclaircit dans les yeux que l’homme ouvre devant les miens…
langue virile,
qui bande au milieu pour faire jouir la foule.
Ailleurs, c’est la langue de la misère et de l’angoisse qui se tortille, cette
langue intérieure ― la langue de la bête silencieuse qui dévore en moi les épouvantes et les douleurs.
Et, avec la misère et sa horde dépenaillée de moisissures et de sordide, surgissent l’odeur de la vieillesse, le visage de la mère, ses yeux égarés, son haleine fétide et
sa langue agitée sans cesse par la même répétition, [pareille à un] hanneton tournant.
Rongée par la tumeur qu’elle voudrait arracher au trou de sa bouche, elle devient cette « corde » sur laquelle il lui faut tirer ― « tresse indivisible » des « douleurs de langue » et des « douleurs de corps ».
Bernard Noël investit de son élan celle qui l’habite et qu’il recrée. « Tout comme Dieu tira Ève du flanc d’Adam », le poète « tire des mots une forme ». La forme d’Anna. Toute bruissante de la jouissance secrète de celui qui l’invente à son tour, après tous les autres (Rossellini, Pasolini, Fellini, Visconti,…). Mais leurs langues se mêlent dans la polysémie d’un corps à corps invisible que l’actrice — emportée par l’obscène cancre incrusté dans son ventre, longtemps avant que ne paraisse La Langue d’Anna — n’a jamais connu avec aucun des hommes qu’elle a aimés. Il y a de l’éros dans cette longue « copulation vocale », de la violence et de la révolte. De la rage, de la colère. Passion et mort étroitement arrimées aux signes et aux images.
Images.
Images : langue du fond. Langue fondamentale.
Images filantes dans l’épaisseur émue où le sentimental est enfin tombé en poussières.
écrit le poète dans La Chute des temps.
Et Anna, à qui Bernard Noël confie ses propres images :
Je vois souvent ma langue flotter derrière les créneaux de mes dents comme une flamme : elle bat au vent d’un orage, reçoit la foudre, la renvoie au ciel. J’aime la tête que j’ai alors, pleine de bruit et de fureur et tout habitée par la tragédie. Je ne sais pas ce qui est en jeu. Je n’ai pas besoin de le savoir. Je suis dans l’élan originel, celui qui donne aux pierres la forme des dieux, et aux hommes la volonté de se tenir debout.
Peut-être est-ce là parole ardente, enfin libérée de la gangue des mots des autres ? Parole vraie, proférée depuis les profondeurs et sans prétention autre que celle de laisser son empreinte, juste une empreinte sur la page tremblée du miroir.
la forme d’un corps
la forme d’un visage
ce que font les ténèbres
en s’habillant de peau
une expression humaine
qu’est-ce que l’autre
pas la figure
pas le personnage
mais l’apparu
l’inévitable
au bout du doigt
au bout des yeux
le même souffle […] *
Angèle Paoli in Revue Nu(e)49, Bernard Noël, 2011, pp. 57-58-59-60.
________________________________
* Bernard Noël, Les Yeux dans la couleur, P.O.L, 2004, page 66.
![Comme nos failles se rejoignent [Sophie Bassot Gross] Comme nos failles se rejoignent](/wp-content/uploads/2025/09/6a00d8345167db69e2019affb1993d970b-350wi.jpg)