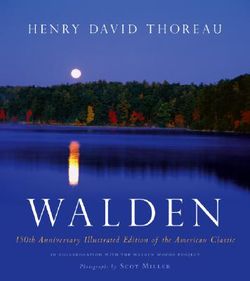“AINSI FONT NOS HUTTES…”
« La pensée, lorsqu’elle fuit sa demeure,
a plus de chance de l’atteindre. »
Christian Doumet
Qui n’a rêvé dans son enfance de se cacher dans les grands arbres, de dissimuler sa présence dans une grotte sous le sentier, de construire une hutte à soi où abriter ses secrets et se tenir à l’affût des secrets de la Nature, bêtes et gens ? Qui ne possède dans un coin de sa mémoire le souvenir d’une retraite creusée dans les excavations de roches propices à la rêverie et à la réflexion ou même à la contemplation ? Qui n’a jamais abordé le désir de « hutter » et de se fondre avec les éléments, dans l’intimité cosmique des arbres et du ciel ?
« Hutter » ? J’ignorais que le verbe existât. Il existe pourtant. Et je l’ai adopté. « Hutter » pourrait signifier « éprouver la vie, le silence relatif, la solitude, fût-ce à trois ou à quatre ; sentir dans les battements de son sang quelque chose qui ne bouge pas ou qui n’existe pas encore. Une attente. Une anticipation. Un irréel. »
Ou encore :
« Connaître en toute habitation terrestre le passager, le périssable ; savoir qu’aucune ne ressemble à notre tombe, que vivre est au prix d’incessants déménagements ― cette sagesse. » Qu’elles soient réelles ou rêvées, les huttes ne traduisent-elles pas ― « en manière de vivre » ― « le petit nécessaire des écrivains, des peintres, des faiseurs de monde ? » « Éloignement, isolement, retranchements. Toutes compagnes d’immenses tournoiements ascétiques menés à distance des choses afin de mieux en éprouver le goût. »
Mélange de réflexions philosophiques et de poésie, les Trois huttes de Christian Doumet sont une invite à partager trois manières différentes d’aborder et de vivre la vie « huttique ». Consacré à trois « constructeurs de solitude » ― Thoreau, Patinir et Bashô ― , le triptyque de Trois huttes traverse trois utopies. Éphémères et fragiles, peuplées de monstres ou itinérantes, les Trois huttes construisent à travers temps et espace un entrelacs savant d’observations et d’analyses où se mêlent art et création, philosophie et spiritualité. Tout en abolissant et le temps et l’espace.
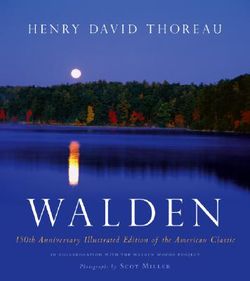 Pour Thoreau, le rêveur de Walden, édifier la hutte de branchages est une entreprise qui ne se construit pas sans violence. Rompre avec les hommes ; abattre quelques grands arbres. Deux violences nécessaires pour mener à bien son dessein. Pour habiter le monde autrement, il faut le transformer et donc « le détruire localement ». Le congé donné à la société des hommes se prend dans la véhémence du geste, se fond avec elle. Conduire ce geste jusqu’à l’édification de la hutte, telle est l’expérience que Thoreau met au centre de lui-même. L’identification de l’habitant à son habitat est telle, leur symbiose est à ce point totale, que l’un et l’autre se fondent en un seul atome, indivisible : « une hutte et son solitaire ». Un solitaire qui ne souffre nullement de sa solitude puisqu’il « incarne la solitude même ». C’est dans ce contexte « sauvage » d’« homme nu, déshabillé de la civilisation », que s’édifie la hutte de Walden en même temps que l’œuvre de Thoreau. « Construire la hutte, écrire le livre » participent de la même expérience, des mêmes transgressions, d’une mise à distance identique. Cet « effacement du moi singulier et des limites dans l’espace et dans le temps » signe l’acte poétique de Walden, qui « peut être lu comme le plus vaste des poèmes en prose ».
Intitulé « Patinir », le second volet du triptyque de Trois huttes interroge la toile de Saint Jérôme dans le désert, œuvre du peintre flamand Patinir (Dinant, 1485 – Anvers, 1524). Le propos passionnant de Christian Doumet, loin de doublonner le récit de la toile de Patinir, ouvre sur de nombreuses voies d’investigations de la pensée.
Cabane de fortune ouverte à tous vents, la hutte de saint Jérôme est sise sous un amoncellement d’escarpements rocheux. Loin au-dessus de la cabane du saint, arrimée aux anfractuosités de roches, une autre cabane, d’aspect plus confortable, laisse imaginer la possibilité d’« un parfait ermitage ». Délaissé par le saint ? Momentanément ? Pour quelle raison ?
Tout autour de la retraite du vieillard, le monde s’agite et miroite des feux de la civilisation. Sur la droite, un chemin serpente qui mène à une église lumineuse. Sur la gauche serpente un fleuve bleu bordé de champs, de bois et de villages. Partout hommes et animaux sont disséminés dans le paysage qui s’échelonne dans les lointains. Indifférents à l’ermite et à son abri de fortune, ignorants de sa présence et des visions qui peuplent ses méditations. Au loin, noyée dans la lumière de l’horizon, miroite une ville. Le saint tourne délibérément le dos au monde. De même notre regard. Longtemps distrait par le fourmillement de la vie et le foisonnement des signes ― « à perte de vue » et de couleurs ―, le spectateur revient vers le centre inférieur du tableau. Toute son attention se porte sur la hutte elle-même. Agenouillé sur le seuil, le saint émacié ― tunique bleue déguenillée ― semble dialoguer avec la robe pourpre et le chapeau de cardinal de même couleur qui lui font face, désœuvrés, abandonnés à même le sol. Le saint regrette-t-il les fastes de ses fonctions de haut dignitaire de l’Église ? Il y a de la violence dans le Saint Jérôme dans le désert de Patinir. Violence qui se lit dans l’aspect déchiqueté des roches, de l’arbre défeuillé, du tronc fourchu ainsi que du toit écorché de la hutte. Violence qui est à l’unisson de celle de l’homme, de la situation qu’il s’est choisie. « Jérôme, quittant le monde entre dans la hutte. Dépouillant la pourpre, gagne l’ humus avec lequel la hutte entretient une parenté ontologique ». Humilitas.
De cette première approche naît l’interrogation de Christian Doumet. Comment concilier « l’appel des horizons immenses et le goût du repli ? » Quelles visions peut-on tirer de cette invention du paysage et plus largement, que peut signifier : lire un tableau philosophiquement ? D’autres huttes, triangulaires et haut perchées dans les arbres, reliées à la terre ferme par des échelles, nidifient dans les toiles de Patinir. Ainsi de La Tentation de saint Antoine et de saint Christophe. Ce sont « huttes passagères », propres à traduire « la nature éphémère de l’intellection visuelle ». Complices de la philosophie du peintre flamand, elles disent l’inconstance de la vision.
En dépit de ce constat, Christian Doumet poursuit son cheminement à travers le tableau. Passant d’une hutte à l’autre, l’auteur fait jouer les oppositions. Quel sens donner à la présence, dans le même lieu, de deux cabanes aussi parfaitement antithétiques ? Que peut dévoiler le rapprochement de l’une à l’autre ? De la hutte visible qui occupe tout le premier plan à la hutte dissimulée, de la belle hutte de planche, close et rassurante, mais « hautaine », à la hutte hargneuse que s’est choisie l’ermite ? L’une est déserte, ou désertée, l’autre est habitée. Mais si « Jérôme rend le désert moins désert », il n’en demeure pas moins que c’est dans la hutte désertée que « niche le saint Esprit » et c’est cette hutte-là que « l’homme descendu ici, parmi nous, dans le paisible paysage de notre quotidien », regagnera bientôt. Et la présence de l’ermite dans sa hutte n’est-elle pas là pour « montrer ceci : la ferveur d’une contemplation ? » Questionnement qui rejoindrait la préoccupation essentielle du peintre flamand : se montrer « soi-même, en confidence intime avec le monde. En sainteté ».
Érasme de Rotterdam, « voisin » de Patinir, eut-il l’occasion de contempler cette toile ? Ses amis Dürer et Metsys lui en ont-ils parlé ? Peut-être. Mais par-delà ses contemporains, c’est avec Paul, Augustin et Thomas que dialogue le peintre dans son Saint Jérôme dans le désert.
Allégé du « poids de l’histoire », le tableau de Patinir retient la leçon de Paul :
« Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme. »
D’autres interprétations, philosophiques ou artistiques, accompagnent les approches spirituelles. Cependant, quels que soient les vagabondages inattendus que prend la pensée happée par la fascination qu’exerce le paysage, la peinture reste hors d’atteinte. Elle se dérobe en autant de tableaux mouvants qui laissent l’observateur désirant face à l’inassouvissement de son désir.
Troisième et dernier volet du triptyque, « Bashô » entraîne le lecteur vers de nouvelles errances huttiques, à la fois mêmes et autres. Comment en effet une hutte peut-elle convenir à l’errance du poète Bashô ? Comment Bashô parvient-il à concilier ses multiples déplacements entre huttes, ermitages, pavillons dans lesquels il fait halte ? C’est qu’il y a chez le poète Bashô concomitance entre trois énergies qui s’entrecroisent : fascination du voyage, « goût des habitats de fortune », perfection poétique du haïkaï. Voyager. « Éviter de rester au même endroit », ne pas s’inscrire dans le durable, rechercher la légèreté et la concision : telles semblent être pour Bashô ses principes de vie. Et, d’une hutte à l’autre qui borne ses déplacements, survient le haïkaï, né « d’une pause entre deux segments de la grande errance. » Marcher et écrire relèvent de la même pulsion vitale. Les errances réveillent, en même temps qu’« un monde de mots, de frappes verbales, d’estampilles poétiques », des réminiscences. Le poète, sensible à la répétition du même, s’applique à retrouver dans tout déplacement ce qui le renvoie à l’identique, au semblable. « Ainsi chaque hutte est-elle la réplique d’une autre plus ancienne, plus inspirée de lumière, mieux exposée au ciel, aux astres, aux flux souterrains : réplique et nostalgie ». Une nostalgie qui n’a rien à voir avec « le regret du monde » mais qui confère à celui qu’elle habite le subtil mélange « de tristesse, de ferveur et d’illumination » propre à la méditation.
Dès lors, suivre le poète dans ses pérégrinations nécessite pour celui qui le lit d’entrer dans le répétitif. Recopier, retranscrire. « À ma manière, je recopie le voyage de Bashô » | Je recopie l’équivalent du voyage de Bashô en pauvreté, en étonnement, en impréméditation », scande Christian Doumet tout au long de son propre voyage d’écriture sur la vie et l’œuvre du poète japonais. Et l’auteur d’ajouter : la hutte de Bashô, « sa poésie sont neuves parce qu’infiniment copiées. Bashô ressemble à Bashô. »
Monde des « finistères » ― ce que le poète lui-même nomme « Bout-du-monde » ―, le monde de Bashô est jalonné de huttes qui dessinent entre elles « le tracé d’une frontière mystérieuse. Une limite située non pas là-bas dans les brumes du Nord extrême, mais ici, maintenant, parmi nous. » Car les frontières, si éloignées soient-elles, « passent toujours là où nous sommes ». De ses cheminements sur les sentiers des montagnes, Bashô retient qu’« il suffit de construire une hutte pour atteindre la fin du voyage ; de tracer une seule phrase pour faire le tour du langage. »
Des palourdes
Les coques se séparent
À l’automne on se quitte.
Angèle Paoli
D.R. Texte angèlepaoli

|