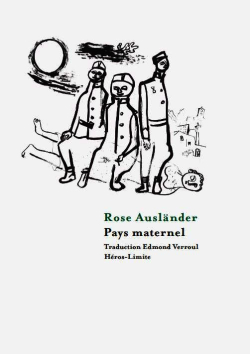La rumeur libre éditions, 2019.
Lecture d’Angèle Paoli
|
L’ÉCRIVAIN-CHEVREUIL Lecture de lente haleine, depuis tant de jours. Cherchant amers et balises, je trace mon sillon entre les pages du dernier ouvrage de Joël Vernet. Lentes les heures qui jalonnent mon vagabondage, d’année en année, de mois en mois, au fil des pages de Carnets du lent chemin. Presque quarante ans d’une écriture régulière (avec de rares ellipses), le plus souvent au jour le jour, composent cette somme de vie. De 1978 à 2016. L’écrivain a vingt-quatre ans dans l’incipit du livre, soixante-deux dans l’excipit. Mais comment refermer un tel livre ? Et comment entreprendre une autre lecture après la traversée de pages aussi incandescentes que celles des Carnets ? Images fugaces de campagnes, fermes et foins, noms de pays lointains, titres d’ouvrages, pensées diffuses in mentem persistent encore. Qui infusent dans les veines et poursuivent leur cours. Suis-je ce « lecteur-papillon » que le poète aspire à croiser sur ses traces ? Je ne sais. Pourtant je suis convaincue que de tels lecteurs existent. Silencieux et effacés. À l’image du poète. Les images fourmillent, à livre fermé. Visions de la mère pelotonnée dans ses châles et dans sa dignité silencieuse. Veuve depuis de si nombreuses années. « Ma mère, avec tant d’autres, n’attend plus rien, blottie dans un fauteuil qui ne sait pas qu’il reçoit une reine. » Image de la maison abandonnée, qui a emporté dans les brumes « l’enfance morte ». Mais qui garde secrète « la chambre d’écriture ouverte sur le monde ». Image du tilleul, emblème de la maison natale. Entre ces extrêmes se déroule « l’épopée des événements courants » qui accompagne la vie du poète. La mort accidentelle du père, alors que Joël Vernet n’est qu’un enfant. Celle d’un frère et d’une sœur. D’amis et de poètes. De connaissances ayant animé l’enfance paysanne. La disparition, plus récente, de la mère aimée. Vient aussi la naissance des enfants. Celle de L., la dernière, qu’il regarde grandir avec beaucoup de tendresse. Et qui le suit parfois dans ses escapades buissonnières. Innombrables les pérégrinations le long des routes et des sentiers de la Margeride natale, les errances dans les faubourgs des villes, les voyages à l’autre bout du monde. À la recherche de ? Du monde et de lui-même, de lui-même en accord avec le monde. De « l’Unité perdue ». Car la vie a basculé en 1965, à l’annonce brutale de la mort du père. Le père. Une perte tragique, déterminante pour l’enfant. « Ce jour-là, il sut qu’il n’aurait plus jamais vraiment de maison, qu’il irait ici ou là, contraint par les événements » (4 mars 2011). Un foudroiement que cette mort. Une fêlure béante. Une plongée dans l’exil intérieur. Le Père, la Mère, tendres figures tutélaires du poète. Toujours présentes à ses côtés, par-delà la séparation ultime. Plus tard, de manière insidieuse, la vie a de nouveau basculé dans le monde actuel. Le monde que nous connaissons, tel qu’il est devenu et tel qu’il promet d’être ou de devenir, ouvert sur le culte de l’argent-roi, sur le pouvoir absolu et aveugle des gouvernants de nos pays. Le consumérisme, la mondialisation et la barbarie font horreur au poète. Qui en appelle à l’insurrection. Étranger se sent-il. Depuis les origines. En marge d’une société qu’il voue aux gémonies. Et davantage encore depuis qu’une frénésie compulsive s’est emparée de l’humanité, la conduisant droit au désastre. Que faire lorsque l’on s’est exilé en soi-même, sinon retourner à l’essentiel ? Renouer avec le ciel et les nuages. Avec « la beauté primitive du monde ». Avec le bestiaire amical et paisible qui anime le jardin. Merles noirs, mésanges et rouges-gorges. Sauterelles et lézards. Escargots et lucioles. Et toujours revenir vers la maison natale qui l’attend, lui le vagabond, le nomade, le gitan ; la maison immobile, inchangée, chargée de présences et de souvenirs. Gardée par la mère qui jamais ne sait quand son fils va revenir. « Tu n’as jamais été là pour tes jours d’anniversaire, toujours à l’étranger, loin de nous », lui dit-elle lorsqu’il surgit à l’improviste. Et, qui va de pair avec l’errance du poète, l’écriture. Nourrie de ces autres vagabondages que sont les lectures. Une écriture vitale, qui tient le poète au corps et au cœur. Fidèle à son être, consubstantielle à son existence. Écriture de la vie, dégagée de toute mainmise, de toute superficialité, de toute ambition personnelle, de tout calcul, de toute richesse. De toute recherche. Écriture du regard, du fragile et du minuscule. Écriture tissée de silence et de solitude. Plus de cinq cents pages d’une écriture vivante pour dire ce qui happe ce qui taraude ce qui révolte ce qui hante jusqu’à l’angoisse et jusqu’au désespoir. Pour dire aussi les joies modestes qui soignent et qui apaisent. « Ces carnets sont un havre de paix où j’accoste après les tempêtes, les tourments », confie le poète à la date du 5 juin 1996. Et le poète de confier, le 27 mars 2011, à la mort d’un « être cher » : « J’ai écrit pour que la nuit ne soit pas toujours la nuit. » Les Carnets du lent chemin sont une somme de notes — bribes brindilles et fragments —, construite patiemment pour dire l’écriture telle que le poète la vit au quotidien, où qu’il aille et où qu’il se trouve. « Écrire, lire, marcher, écrire, lire, marcher » (18 décembre 1988). C’est là la seule réitération que supporte le poète. Elle relève de son choix et de sa liberté. Elle est le seul travail qui le concerne vraiment, au plus près, qui le construise dans la durée. « Petit bonhomme, tu avais mis en train un défi de Géant : celui d’écrire. Mais pourquoi écrire ? Pourquoi ne pas avoir confié ta vie à un autre métier, à une autre occupation exemplaire : boulanger, menuisier, médecin ? Tu ne voulais que les mots, leur sommation irrecevable. Cet amour des mots, tu en as la conviction aujourd’hui, t’est venu en gardant les bêtes, les troupeaux. Tu avais là sous les yeux la nature admirable : prairies, forêts, ruisseaux. Comment faire chanter cela dans un tout petit cœur ? Tu t’es saisi alors de l’outil le plus proche de toi : le langage et tu as essayé de jouer de cette musique, à la façon des musiciens de jazz. Tout à l’improvisation. Es-tu un écrivain sauvage ? » (22 janvier 2010). Écrire, oui. Mais quel type de livre est-ce là ? « Une sorte de journal du regard », écrit le poète le 1er mars 1997. Ce même regard qui avait donné son titre à une précédente publication, parue en 2009 aux éditions La Part commune : Le Regard du cœur ouvert, Carnets (1978-2002). Le volume actuel, Carnets du lent chemin, est sous-titré Copeaux. Ce mot revient à plusieurs reprises sous la plume du poète. Qui caractérise tantôt la nature de ces bribes qui obsèdent — pensées et aphorismes que le poète affectionne ; interrogations multiples (pourquoi écrire ? et pour qui ? écrire est-il agir ?) et citations, retours en arrière nombreux et redites ; tantôt le projet ou la quête du poète, tantôt l’écriture elle-même : « Je reprends les pages. Elles sont une part de moi, arrachées à mon corps. Détachées, déchirées. Je me reconstitue en les relisant. Je rassemble les copeaux épars… » (14 janvier 1994). Et plus loin : « Cette soudaine pensée dans le soir : des pages tombant comme des copeaux. » (16 octobre 1995) Ou encore : « Une écriture qui serait des copeaux de merveilles. » (4 janvier 1997) Ou bien cette phrase, soulignée au fil courant de ma lecture, et qui me fait sourire : « Les copeaux du petit crayon tombent dans l’herbe » (13 septembre 2009) avec son écho, du 18 mars 2015 : « le petit tumulus de copeaux sur la table – vestige du crayon à papier. » Et celle-ci surtout, qui aiguille la lecture, dans le préambule écrit par le poète lui-même : « Ce que vous lirez serait donc, au lieu d’un journal du passé, du présent, plutôt les copeaux d’un avenir toujours à réinventer. » Un autre mot affleure sans cesse, qui accompagne les errances. L’adjectif « lent ». Ou le substantif « lenteur ». Lenteur du rapace dans son envol. Lenteur de l’écriture. Correspondances : « Ce matin dans la brume, le rapace familier sur le fil. Au bruit du volet s’ouvrant, l’oiseau s’envole d’un lourd et lent battement d’ailes. J’aime cette lenteur du geste, comme dans l’écriture lorsque s’effacent les heures de la journée, qu’on atteint le soir sans vraiment s’en rendre compte. On lève la tête et « c’est déjà la nuit au-dehors ». Expérience alors d’être vraiment au monde, une fois le travail accompli, qui n’est qu’une aventure dans l’inconnu. » (25 octobre 2009) Qui dit lenteur (exaspérants sont les « bolides » qui traversent la ville à grand fracas) dit aussi « détour ». Lenteur de la marche, détours de l’écriture. Vagabondages de la pensée. Conjugués ensemble, vagabondage et lenteur permettent la juxtaposition, dans une même note, d’images et de voix d’époques distinctes ; de lieux étrangers les uns aux autres. L’ensemble constituant une sorte de collage naturel où se côtoient des visages et des êtres, des gestes aussi, que seul le poète peut assembler. Par l’écriture. Ainsi en est-il, par exemple, dans cette note du 1er mai 2011 : « Le regard perdu de ma mère, de la Vieille-Femme-Universelle. L’enfant, attentif au café, balaya les pellicules sur le col de la chemise noire de son père. Les bruits de la cascade, autrefois, dans le Sud du Burkina-Faso. Les poussins si jaunes piaillant devant la case, la jeune fille dont la mère peignait les cheveux en de longues tresses. Me rendant à l’épicerie du village chercher le pain ou autres courses, passant dans la ruelle inondée de soleil, la merveilleuse glycine me fait fête, répandant son odeur entêtante, enivrante, me rappelant que ce monde est beau, fût-il tapissé de barbarie. » Le regard du poète attentif se pose successivement sur les menus événements du jour. Des non-événements pour une « épopée » du quotidien. Ainsi serpentent les chemins qui mènent de Saugues à Gao ou à Vladivostok ; du Portugal à la Laponie, de Tachkent à Vénissieux, de la Creuse à Abidjan, puis, du Nord au Sud, et d’Ouest en Est, le long des rivières et des fleuves, jusqu’aux abords de la Mer Blanche et des îles Solovki. La pensée voyage d’une année à l’autre, évolue par vagues successives, depuis les aphorismes qui abondent dans les premiers carnets aux grands textes lyriques qui caractérisent davantage les carnets les plus récents. Elle charrie au passage nombre d’auteurs et de poètes de tous pays, de toutes nations. De l’italo-argentin Antonio Porchia à Pier Paolo Pasolini ; de Christian Gabriel/le Guez Ricord à Giono ; de Fernando Pessoa à Alexandre Blok ou à Marina Tsvetaieva ; de Vassili Grossman à Varlam Chalamov ou à Anna Akhmatova. De Blaise Pascal à Christian Dotremont ou à François Augiéras. De Vélimir Khlebnikov à Rimbaud ou à Tomas Transtömer… Pour ne citer que quelques noms parmi les innombrables écrivains et poètes affectionnés, dont les silhouettes surgissent au hasard des voyages, des lectures et des affinités électives. Car les poètes sont « frères de silence, invisibles dans ce monde » de Joël Vernet. Et la poésie omniprésente sous sa plume de poète, lequel joue volontiers de l’antagonisme roman/poésie. À l’avantage de la poésie que le poète tient en haute estime, et qui lui est indispensable. Ainsi écrit-il au cours du mois d’août 2015 : « Avec les mots de la langue commune, tu inventes un autre alphabet : voilà la poésie, symphonie de la réalité vivante. Pas de poésie abstraite, universitaire, mais toute incarnée, sauvage, indomptable, comme les bouleaux de la steppe russe. » Sauvage, indomptable la vraie poésie, comme l’est le nomade Joël Vernet, sempiternel insoumis qui n’obéit qu’à sa seule émotion. Engagement singulier. À l’exact opposé de l’actuelle doxa poétique, prônant distanciation et froideur. Les Carnets du lent chemin sont une véritable « défense et illustration » de l’émotion et de la sensation. Un refus absolu de « la littérature coup de sabre » au profit d’un lyrisme revendiqué et assumé : « L’émotion dompte les mots. Émotion sois vivante en moi pour toujours, et non pas seulement lorsque je contemple ce monde, mais en permanence, jusque dans le sommeil, jusque dans les rêves. Émotion, sois mon bâton de pèlerin ! » (19 septembre 2012). Tous les détours recherchés et mis en pratique par le poète sont ce qui donne ses assises à son projet d’écriture : « Projet d’écriture sur le pays natal. Récit après de lents détours » (21 juillet 2000). La personnalité profonde du poète semble façonnée par le détour ; les mouvements de la pensée s’accordent aux mouvements du monde ; les détours géographiques annonçant ou engendrant les détours de l’écriture : « Peut-être as-tu eu tort, au temps de tes lents détours à travers le monde, de n’avoir pas nommé, décrit les lieux où tu séjournais, habitais, plus que tu ne passais. Ainsi, cette chambre, dans un village du Sud de l’Albanie : Himara. » Et, un peu plus loin, le même jour : « L’écriture qui vise le détour et, par le détour, l’essentiel. Sainte lenteur » (12 février 2010). Et à l’enfant qui l’interroge et qui lui dit : « Qu’as-tu fait de ta vie ? », le poète répond : « J’ai accompli beaucoup de détours pour apprendre à admirer la lumière qu’il y a en ce moment sur ta joue. Détours, voyages et sommeil, paresse dans la lecture. L’écrivain est un mort ébloui de lumière » (26 octobre 2010). Magnifiques Carnets du lent chemin. À lire et à relire. À reprendre et à méditer. Une gageure que de restituer une vision totalisante de ces drôles de journaux, métissage d’intime et d’universel. Il y aurait tant à dire encore. Juste s’en remettre au plaisir du texte. Intense et passionnant. Exalté et beau. Et retenir, disséminée entre les pages, l’image du chevreuil (ou du renne), qui culmine dans un échange émouvant du poète avec sa Mère : « Miracle, présence d’un café au bord de la petite place, avec sa minuscule terrasse, ombragée par une treille. Joie de nous asseoir là tous deux dans la paix du soir qui descend paisiblement sur les collines, les villages et les prés, d’être vivants dans ce si beau silence d’une fin d’été, de ne parler qu’à peine, à voix basse […] Elle sourit en portant le verre à ses lèvres. » L’écriture est vraiment ton chemin. Rien que pour avoir été conduits ici, tous deux, ton choix de vivre ainsi fut le meilleur. »
Hier dans le pré devenu une jungle, en contrebas de la maison, trois chevreuils broutaient, l’œil, le corps cependant aux aguets, sursautant au moindre bruit. N’es-tu pas l’écrivain-chevreuil ? » (20 novembre 2010). Vagabond et craintif, mais libre. Libre de son chant, libre de son écriture. Angèle Paoli D.R. Texte angèlepaoli  |
| JOËL VERNET  Source ■ Joël Vernet sur Terres de femmes ▼ → Décembre 2010 | Joël Vernet, Carnets du lent chemin, Copeaux (1978-2016) [extrait] → L’oubli est une tache dans le ciel (lecture d’AP) → Les petites routes (extrait de L’oubli est une tache dans le ciel) → [De Rimbaud […] tu n’auras jamais rien su] (extrait de Mon père se promène dans les yeux de ma mère) → 30 août 1994 | Joël Vernet, Le Regard du cœur ouvert ■ Voir aussi ▼ → (sur remue.net) Joël Vernet /marcher vers un ciel de pierre → (sur Le Nouveau Recueil) Joël Vernet, ou l’esthétique de la trace, par Sylvie Besson (fichier Word) |
Retour au répertoire du numéro de décembre 2019
Retour à l’ index des auteurs
Retour à l’ index des « Lectures d’@angelepaoli »