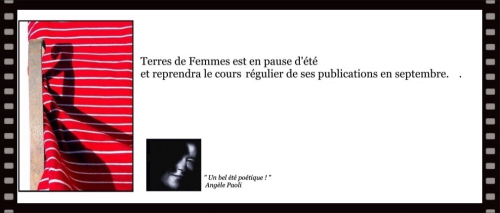

Photographies et montage de Guidu Antonietti di Cinarca
Image: G.AdC

Image: G.AdC
♦ SOMMAIRE DU MOIS DE JUILLET 2023 ♦
Cartouche du N°223 de Terres de femmes / juillet 2023
Terres de Femmes / Pause d'été 2023
TdF sommaire du mois de juillet 2023 / N° 223
Catherine Pont-Humbert | Noir printemps
Michael Bishop | Revue NU(e)81 | La Grande Arborescence
Jean-Louis Giovannoni | Tout corps entame
Claudine Bohi | Un couteau dans la tête
Michel Diaz | Sous l’étoile du jour I Lecture d’Alain Freixe
Bruno Grégoire & Anne Segal | Le jardin et la cible
Michaël Glück | Appelez-moi Fougère
Michel Diaz | Sous l'étoile du jour
Joël-Claude Meffre | Ma vie animalière
Judith Chavanne | Prix international de poésie francophone Yvan-Goll 2023 | De mémoire et de vent
Germain Roesz | Claude Ber | Main Tenant
TdF sommaire du mois de juin 2023 / N° 222
Cartouche du sommaire du mois de juin 2023 ( N° 222)
<< Poésie d'un jour

" Les mots … "
Photomontage d’inspiration typographique / G.AdC
en hommage à → Yves Thomas
LES MOTS PARFOIS
Les mots parfois ouvrent des chemins ensoleillés
Éclairent les mystères
Trouent l’opacité
Les mots parfois s’assoupissent à mes côtés
Sur le bord de la route
Les mots parfois parlent en dormant
Chuchotent à l’oreille de la terre
Les mots parfois glissent au rythme de mes pas sur le chemin
Les mots parfois
Éblouis par une flaque de soleil
Font silence sur la beauté du monde

Catherine Pont-Humbert, Noir printemps, La rumeur libre 2023, p. 40

♦ Voir sur TdF:
→ Les Lits du monde, La Rumeur libre Éditions, 2021
♦ Voir aussi :
→ Légère est la vie parfois, Jacques André éditeur, Collection Poésie XXI n°61, 2020
→ RCJ
Le Numéro 81 de la revue NU(e), coordonné par le poète Michael Bishop est en ligne sur → Poesibao.
Création de la poète → Béatrice Bonhomme, la revue NU(e) est disponible sur le site de Florence Trocmé et également → ICI.

<<Poésie d'un jour

à Anna Coudart
L’ombre se déporte peu à peu
-corps parti on ne sait où
Au soleil couchant
Les formes s’allongent
La nuit les confond.
Vouloir rejoindre.
La rive
Nous éloigne
Autant nager vers le large.
Tu aimerais rejoindre
Les derniers rayons du soleil.
La matière
Colle à la peau
Et tu ne peux t’en dégager.
Ce que tu écartes
Pousse à nouveau.
Nos mains ne vont
D’un corps à l’autre
Que peu de temps.
Elles ne savent aller profond.
Continue de nager dans la fraîcheur du soir
Il ne te reste que cela.
L’air circule
Se délite
Comme le sable.
Sois assuré
Les draps
Sont des frontières
Qu’on ne peut franchir.
Océan intact autour de toi.
Nos mains ne peuvent.
Le Perchoir
2012/2022
Jean-Louis Giovannoni, « Nos mains ne peuvent » in Tout corps entame, Gravures de Philippe Duthilleul, Æncrages &Co/ Écri(peind)re, 2023, pp.43,44,45.

Ph. © Fabienne Vallin
Source
Voir sur → Tdf
<< Poésie d'un jour

" Elle note les pas de danse "
Aquatinte de → G.AdC
Dans le puits de sa vie résident des pensées en flocon. Elle recense
les souhaits reclassés. Derrière ses yeux secs, elle ne cesse de
ressasser les souvenirs sépia. Seuls quelques mots sont laissés à son
répertoire. Les mots superflus ont reflué d’eux-mêmes comme des
enfants sages sans vanité. Bisogna morire. Bisogna morire.
Tout avait toujours été trop tard.
Et sur le tard, la sagesse ne lui avait rien appris.
À six ans déjà, Emma abandonnait les romans commencés. Parfois,
elle esquissait la couverture. Souvent, elle s’en tenait aux titres.
-Leur liste, longue et intrigante, faisait œuvre de rêves.
Elle n’a jamais cru qu’il s’agissait de paresse mais plutôt de
paralysie. Elle était empêchée.
Elle a attendu de ne plus l’aimer pour le revoir.
Elle n’a pas le souvenir de l’avoir vu autrement qu’en songe.
Il y revêtait les costumes étranges d’animaux.
-Des voilures d’éphémère
des carapaces de scarabée
des pelures de tatou
des fourrures de dasyure
des peaux d’ânes.
Elle note des notes qu’elle perd, qu’elle jette,
qu’elle égare, qu’elle déchire.
Elle note les pas de danse
sans parvenir à relire ses notations.
Elle étiquette les objets qui perdent leur nom.
Elle astique et désétiquette. Elle déchiquette et frotte.
-Non
non elle ne sait plus à quoi sert ce bout de papier.

Sylvie Marot, Physalis, La Crypte, (le pays qui grandit), Image de couverture Sylvie Marot, 2023, pp.75,76,77,78.
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
SYLVIE MAROT
■ Sylvie Marot
sur Terres de femmes ▼
→ Lisianthus (note de lecture d’AP)
■ Voir aussi ▼
→ (sur le site des éditions de La Crypte) la fiche de l’éditeur sur Lisianthus
→ (sur Recours au Poème) une note de lecture de Marie-Josée Desvignes sur Lisianthus
→ (sur lelitteraire.com) une note de lecture de Jean-Paul Gavard-Perret sur Lisianthus
→ (sur lelitteraire.com) un entretien de Sylvie Marot avec Jean-Paul Gavard-Perret (1er janvier 2016)
→ (sur Lire le Japon) une note de lecture sur Lisianthus
<< Poésie d'un jour
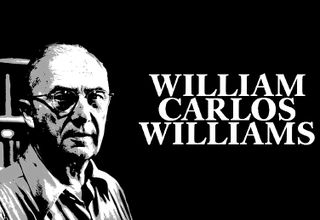
Image de G.AdC
: la fierté du pays ; le printemps, l’été, l’automne et la mer
; à mon tour
de tenter ma chance
mais je commence en plein hiver :
et si la mer est loin
si cet hiver bat des records
pluie pluie pluie pluie pluie pluie pluie
même le dimanche
la Seine monte centimètre par centimètre
ici à Ivry
elle a déjà submergé les berges
j’entends le clapotis
léger le ressac plus sourd des mètres
cubes de liquide
contre les dépôts de ciment et de béton
l’eau recouvrira bientôt
le ruban d’asphalte qui a remplacé les petits pavés ronds
enfoncés surf leur lit de sable
à coups de marteau
par les ouvriers de la voirie
mais qu’est-ce qui déborde – à part ma gratitude ?
réponse : c’est toujours le temps
il n’y a plus qu’à nager à contre-courant
sans plus se tracasser
avec cette vieille fredaine pourtant tellement intempestive
du commencement
et de la fin
*
William Carlos Williams ce n’est pas seulement
les asphodèles notre mariage
des petits riens
c’est aussi Paterson
la ville ouvrière où il vécut
et pour Paterson il s’était inspiré de Dublin
dans le sillage d’Ulysse
autant dire personne
ni rien d’autre que trente siècles au moins
derrière nous et demain devant
-oui avec les citrons oui
la rosée oui un chien oui l’imperfection de tout
les lapins une colonne le flux
du Traité de la nature humaine oui
avec vos seins parfumés
une célébration avec ajouts
et retraits –
et puis il faut bien reconnaître que Ulysse et Ulysse
ce sont quand même la Grèce
et que la Grèce est notre bien commun
comme la mer et la neige
l’amour ou l’amour de l’amour
ou appelez ça comme bon vous semble
vieillesse ou jeunesse ou vieillesse
quand Williams commence à publier son Paterson il a soixante-trois ans
*
pas de chute d’eau
à Ivry – quelques
papillons communs et des confettis de couleur
le jour de la fête de l’enfance
en juin-
beaucoup de péniches et de cheminées
dans le quartier du Port
des usines en veux-tu
en voilà
les briqueteries les tuileries les journaliers
qui tirent des brouettes
remplies de briques de tuiles de sable de gravier
une charronnerie où réparer une roue
ou le moyeu
la compagnie des Lampes qui brille
au firmament industriel
juste au-dessus de l’usine des eaux
devenue le dépôt d’œuvres d’art
de la ville de Paris
la réserve des es plâtres et de ses tableaux
pas de chute
mais des remous autour des piles du pont Nelson Mandela
et qui d’autre cette nuit pour plonger
puisque
Tout mérite d’être tenté
et qui sait
encore
qui est le Marcel Boyer du quai Marcel-Boyer
quand on pose le pied
à Ivry-sur-Seine ?

Bernard Chambaz, La vie d’après Williams in « Contre-Allées », Revue de poésie contemporaine, Printemps 2023, pp.2, 3, 4, 5.
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
BERNARD CHAMBAZ

■ Voir aussi ▼
→ (sur Encres vagabondes) un entretien avec Bernard Chambaz (propos recueillis par Brigitte Aubonnet, mai 2015)
Claudine Bohi Un couteau dans la tête
Éditions l’Herbe qui tremble 2022
Lecture de Patricia Cottron-Daubigné

Portrait de Claudine Bohi par G.AdC
Le titre interpelle. Claudine Bohi ne nous a pas habitués à des expressions aussi violentes. L’exergue choisi par l’autrice confirme cette impression :
« Un livre doit être la hache pour la mer gelée qui est en nous » (Kafka).
Nous entrons dans un livre où quelque chose des fondations d’une existence est en jeu.
Cette expression « un couteau dans la tête » parcourt tout le recueil, formule obsédante qui dit bien son impact répété dans la vie des protagonistes. De la guerre à l’inceste.
L’histoire s’origine dans la guerre 14-18. Un jeune homme, jeune soldat, doit, sous la menace de ses chefs achever ses compatriotes agonisants, avec un couteau. Violence définitive dans cet homme qui sera « un monstre » – dit sa fille qu’il a violée -, couteau dans la main, sexe dans le corps, et enfin dans les mots, pour poser tout cela, à distance.
On entre là dans l’inimaginable de la guerre. Je songe au roman d’Erich Maria Remarque, À l’Ouest rien de nouveau, récit dans lequel le narrateur revenant dans sa famille se trouve totalement étranger à la vie normale, perdu dans la violence qu’il a vécue, comme vidé de lui-même.
Dans la première partie de son livre, Claudine Bohi dit l’horreur de ce qu’a été contraint de faire ce grand-père. Comme il a fallu peser les mots pour écrire cela ! On sent, malgré les événements qui suivront, toute l’empathie que l’autrice a pour ce jeune homme que la guerre détruisit totalement sans le tuer. Et ce n’est ni pour justifier, ni pour expliquer l’inceste qui suivra, mais pour tenter de comprendre un homme, en profondeur. De comprendre ce que chacun vit et qui le mène là où il va, si rien ne l’a aidé à éliminer la violence subie. Le rouge du sang et la colère dévastent tout :
« ce couteau nu
tout au fond de ces chairs
sanglantes
où meurent tes camarades
ce dur couteau obligé à ta main
et le fusil du capitaine te guette
si jamais tu dis non
ce couteau-là tu l’as conservé
au milieu de ton crâne
il s’est planté fiché
(…) »
Ce que la guerre fait aux hommes est la réflexion que génère ce livre.
Dans ce récit, Un couteau dans la tête, c’est – par propagation de cette violence initiale – l’inceste qui est nommé, qui détruit ses victimes et les proches. Violence propagée dans la tête de tous :
« ce couteau dans ta tête
secrètement porté
il s’enfonce partout
s’enfonce dans ta vie
s’enfonce dans tes yeux
et dans tes mains de père
et dans tes mains d’amant
dans toutes tes mains d’homme
(…) »
« il continue sa guerre
(…)
la blessure est profonde
qui ne se connaît pas
(…)
de père en fille
jusqu’en petite fille »
Le couteau qui tranche, ce sont aussi les mots répétés de la mère violée, détruite, « tous les hommes sont des monstres », mots venus de l’enchaînement des drames qu’elle vit, détruite, détruisant à son tour.
Le sujet est répandu. Il occupe fréquemment l’espace médiatique, au point que, involontairement, nous le reléguons en place de faits divers à moins que, par effet de voyeurisme, nous ne nous y intéressions quand le monde des « people » est concerné.
Mais quand une poète comme Claudine Bohi s’en empare, c’est autre chose qui se passe : le terrible tragique est posé là sous nos yeux, sans pathos, sans lamento, avec la seule force de ce qui se joue. Dire pour l’arracher, ce couteau planté dans la tête. Dire pour mettre fin aux violences qui s’enchaînent. Dire, comme l’ont fait jadis les grands poètes tragiques grecs.
Un couteau dans la tête est un livre puissant.
Claudine Bohi ouvre ce recueil par un hommage à la langue poétique :
« Il n’y a sans doute que la parole poétique, celle où les mots sont aussi musique,
pour que puisse enfin surgir ce qui laissa sans voix. (…) »
Et sans doute a-t-elle eu raison. Car c’est grâce à elle, à la maîtrise qu’en a l’autrice, que ce livre atteint son efficacité : force, délicatesse, partage. On a déjà pu le mesurer aux citations données plus haut.
Je pourrais citer aussi de nombreuses pages où le rythme subit comme une accélération essoufflée, dans la scène de l’inceste, dans le martèlement de la parole maternelle, dans le départ du père.
« Elle a cinq ans de boucles blondes
et de caresses
un soir d’hiver où il ne neigeait pas
simplement froid dessus
jusqu’à fendre les pierres
elle s’en souvient encore
elle a mal à son père
elle a froid à son père
il est parti au loin
il est parti partout »
C’est à chaque fois de l’irrespirable. Cette poésie a à voir avec le blues, la musique pour dire et atténuer la douleur, dans le partage et les effets lancinants.
Il y a aussi le travail des couleurs. Le rouge du sang qui de réel devient métaphorique ; le blanc du mutisme, tant d’années à ne rien dire (malgré tous les livres écrits, qui s’approchaient peu à peu de cela), le blanc du brouillard – qu’a vu l’enfant, quelle horreur est fichée dans sa tête, qu’a-t-elle vécu ? -, le blanc de la neige qui recouvre (mais est-elle si pure ?), le blanc du regard qui veut se vider.
« la petite fille s’endort
dans le lit de la mère
(…)
un soir d’hiver
où il ne neigeait pas
le souvenir est blanc
le geste est effacé
où sont allés les mots
où passa la parole
où part la petite fille
d’où elle ne revient pas »
Mais la couleur qui , selon moi, domine au moment où je clos cette note, c’est la blondeur de la petite fille qui est celle du père, avec les mêmes yeux bleus, une image de la douceur trahie, abîmée, mais énoncée de manière répétée avec une telle tendresse, un tel enveloppement, les mots comme des bras d’amour, que je veux croire que ce livre est, pour l’adulte devenue, le sourire possible.
« une petite fille dorée blondie
comme un soleil en son premier matin »
<<Poésie d'un jour

" Je garde l’œil plaqué contre la plaie silencieuse. "
Aquatinte de G.AdC
De quelle lenteur je me détache. Des mots ne sont pas les miens.
Nous sommes l’ombre l’un de l’autre. Invisible, l’enfant en moi
n’a pas d’autres mains que ses yeux.
Les instants déroulent leurs volets clos derrière les fenêtres. Des
images me reviennent, d’autres me regardent. Je garde l’œil plaqué
contre la plaie silencieuse.
Le passé prend corps à mesure que je déroule ma propre solitude,
que je gravis le chemin abrupt. Je sens l’aggravation des ombres,
le vertige. Il n’est plus temps de rebrousser chemin et à peine
possible de me retourner. Le vide est passé en moi. Quelques mots
dérisoires pour le combler, des gestes ou des prières. Je ne peux
guère que deviner là où rien ne se donne. Main sur la pierre, les
yeux clos.
Le véhicule s’éloigne. La maison, derrière nous, rapetisse dans
la nuit, éclairée de sa seule fenêtre. Lui, sur le siège passager, ne
laisse rien paraître. En une seconde, grosse de terreur, je vois la
nuque suintante, la figure difforme se retourner au carreau et me
voir, savoir que c’est moi. Il m’était impossible de le quitter. J’ai
compris qu’il était en moi. Le matin ne filtrait pas encore à travers
les lames du volet.
Dans le jardin, le jeu n’était qu’une attente de plus. Les murs
blancs, silencieux, des soupirs dont on exige qu’ils portent tout le
poids et se contiennent. L’ombre est lourde des fruits qui n’ont pas
mûri. Du cri ancré en moi, comme si tout devait encore être vécu.
Les terreurs laissées pour morte, les pensées niées arrachées à ce
que je vivais. Enfant, je ne pouvais les fuir, ni fuir en elles.
Je ne voulais pas voir. Je voulais que cela meure. Qu’il boive plus
vite. Que le sommeil l’avale plus vite et qu’enfin en moi tout
s’endorme.
J’ai étouffé l’enfant. Le mal avec la racine.
J’aperçois sa fêlure à lui, ma fragilité. Contigües l’une à l’autre. La
plaie s’assèche. Je la regarde, muet, comme je regarde grandir mon
propre fils.
Dans les yeux de mon père ce n’est plus lui que je voyais. Jamais
il ne quittait sa détresse pour la mienne. Les instants sans lien.
Chaleur d’été sans issue. Comme l’intuition d’une patience qui
n’est pas celle d’un enfant.

Olivier Vossot, « fils » III, in fils, Édition La Crypte 2023, pp. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Olivier Vossot sur → Tdf