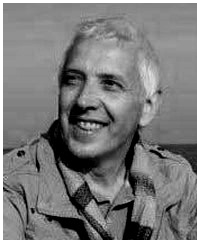Site de Claude Ber : www.claude-ber.org

DU GENRE DANS LA LANGUE
( Illustration : source )
Le genre « sexuel » et le genre dans la langue sont distincts. Les confondre c’est risquer de projeter sur la langue une intentionnalité qui lui est étrangère. Le « e » final est certes, en français, le signe du féminin de l’adjectif, mais la langue est plus souple et plus riche qui dit la chanson, la raison, la vertu, la peur, la main, la mer, la vérité, etc. au féminin sans « e », l’article suffisant à le marquer, et le voyage, le rivage, le courage, le fleuve, le rire, le sable, le neutre etc. au masculin en terminaison « e ». Un discours trop dogmatique sur le sexisme de la langue se heurte à son arbitraire sans rapport avec l’idéologie et, non sans quelque humour, au féminin des attributs masculins tels que la verge, la couille ou la barbe et à une virilité tout aussi fémininement genrée que le sein, le vagin, le clitoris, le sont masculinement.
Une langue porte, néanmoins, trace des mentalités et de l’histoire. Elle est surtout périodiquement instrumentalisée. L’énoncé grammatical « le masculin l’emporte sur le féminin » est un exemple de l’instrumentalisation d’un fait linguistique sans intention par un discours dominant misogyne.
Au terme d’une évolution phonétique et morphologique, le masculin et le neutre du latin se sont confondus en français. Des trois genres latins – masculin, féminin, neutre- n’en sont restés que deux, le masculin portant le neutre car leurs finales devinrent identiques par perte respectives du « s » (de dominus par exemple) et du « m » (de templum par exemple). Le grammairien Grevisse le présente ainsi en parlant « d’indifférencié ». D’autres grammairiens ont, en revanche, expliqué ce fonctionnement par une argumentation sexiste – « Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l’emporte. Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle » écrit le grammairien Beauzée en 1767 reprenant Vaugelas qui en 1647 décrétait déjà « Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoiqu’ils soient plus proches de leur adjectif. » -. C’est cette instrumentalisation politique et bien sûr erronée de la langue que perpétue la formule grammaticale « le masculin l’emporte sur le féminin ». Dire « le masculin porte le neutre en français » ou bien « le masculin joue le rôle de neutre » exprime tout autre chose et a le mérite d’être exact. La première mesure nécessaire serait donc déjà d’enseigner correctement l’histoire de la langue et de modifier la formulation de la règle.
Les victimes de cette instrumentalisation de la langue par un discours dominateur qui s’est cherché légitimité en elle, ont tendance, à leur tour, à instrumentaliser la langue à leur profit. Cette réponse de la bergère au berger est d’autant plus compréhensible qu’elle prend place dans un système patriarcal ou ladite bergère a trop longtemps joué les seconds rôles voire a été écartée de l’histoire et ses œuvres passées à la trappe. Un fonctionnement de la langue en lui-même sans intention devient alors symbolique d’inégalité et changer la langue fait figure de conquête d’égalité.
Si la démarche est politiquement légitime, elle n’est pas pour autant linguistiquement ni langagièrement viable. Les grammairiens misogynes du XVIIème ont profité d’un fait de langue, la fusion du masculin et du neutre, pour l’interpréter de façon tendancieuse. C’était une distorsion de l’histoire de la langue, qui n’ébranlait pas son système, la modification des règles d’accords vise, elle, à en changer le fonctionnement. Toutes les modifications proposées en ce sens reposent sur la confusion du genre sexuel et du genre dans la langue. Cette instrumentalisation idéologique de la langue a ses raisons politiques et exprime un ressenti, mais n’en demeure pas moins linguistiquement fausse et langagièrement difficilement praticable car elle risque davantage de compliquer et d’obscurcir le message que d’éclaircir les idées. L’accord de proximité a lui-même évolué pour des raisons internes et pas seulement politiques. L’accord de choix brouille beaucoup les repères et celui de majorité est l’apothéose de la confusion du genre dans la langue et dans la vie.
Il faut, dans tous les cas, garder mesure. La volonté d’afficher ainsi de l’égalité est d’un effet limité par rapport au poids des représentations. Le neutre de la langue allemande n’a jamais empêché les Allemandes d’être reléguées aux trois K (Kinder, Küche, Kirche, les enfants, la cuisine, l’église). Et même si les propositions de féminisation du français ne sont pas la novlangue d’Orwell, dont le but est d’imposer une langue qui efface toute histoire, élimine la complexité pour empêcher la pensée, son spectre hante toute ingérence de l’idéologie dans la langue. Même écartés (accord au neutre ou de proximité avec le mot suivant) les espoirs et les craintes excessives (accord de proximité au risque que l’espoir ne soit pas perçu comme excessif), le débat ne se réduit pas à une opposition entre progressistes et réactionnaires. On ne peut évacuer d’un revers de main ni une revendication d’égalité ni l’objection d’ingérence directe de l’idéologie dans la langue même dans de bonnes intentions. D’autant plus que l’argumentation des « pour » et des « contre » ne se prive pas de simplifier et d’instrumentaliser à tout va, les « pour » en justifiant leur forcing comme un légitime retour de la violence subie au mépris d’une histoire de la langue schématisée comme de son fonctionnement et en rabattant le genre sexuel sur le genre dans la langue, les « contre » en minimisant les effets délétères d’une interprétation intentionnellement erronée et misogyne d’un fait de langue dans le sens d’une domination.
Qu’on veuille contraindre l’évolution de la langue ou en corseter l’usage, on intervient idéologiquement sur elle. L’évolution d’une langue est fait collectif et répond davantage à une logique interne qu’à des injonctions politiques. Au final, c’est l’usage qui trie entre plusieurs possibles et même l’Académie française n’a jamais fait qu’entériner des usages, avec réticence parfois, mais sans rien inventer. La langue appartient à tous les locuteurs et locutrices. C’est leur usage qui détermine ses évolutions, elles-mêmes possibles tant qu’elles n’affectent pas le système de la langue. Si cet usage est influencé aux marges par des représentations, il l’est surtout par la logique de la langue qui va toujours vers la simplification et non vers la complication. Que le féminin porte le neutre par généralisation du « e » serait, en cela, plus conforme au fonctionnement de la langue à défaut de l’être à son histoire!
À observer l’usage, on voit vite que les élèves, par exemple, n’ont pas eu besoin de théories ni d’être linguistes pour parler de « la prof » ou de « la proviseur » en appliquant spontanément le fonctionnement de la langue où l’article suffit à signifier le féminin quand la valeur, la liberté, la douceur comme la fureur s’en passent sans perdre leur « genre ». On peut comprendre la fonction (pas de « e » à ce féminin !) de la féminisation forcée des noms de métier, ajoutant à l’article ce « e » institué symbole du féminin même s’il ne l’est que pour l’adjectif, pour enfoncer le clou, mais l’étendre serait aussi absurde qu’infaisable car de la « fonctione » à la « vertue » en passant par la douleure, la vélocitée et tous les mots en finale « é » « n », « u », « r », qui sont au féminin sans « e » final, c’est un sacré chantier et surtout un beau chaos qui se profile à l’horizon ! La raisone ferait vite homophonie avec les verbes « raisonne » et « résonne » dans, au final, un charabia déraisonnable…
Une langue est un système, qui mute, évolue dans une logique interne, elle-même marquée par de l’accident et des illogismes (l’orthographe française et les régimes grammaticaux d’exception suffisent à le montrer) mais dans un minimum de cohérence qui maintient la cohérence linguistique et langagière globale. Au delà d’un certain seuil, elle se détruit. C’est ce qui rend les mutations décrétées inopérantes ou infaisables. Ainsi par exemple aussi bien la volonté de simplification de l’orthographe qui a été un temps de mode que la féminisation à outrance finissent-elles par introduire plus de complication que de simplification quand la complexité (en l’occurrence d’une langue) n’est pas davantage la complication que la simplicité le simplisme… La langue peut évoluer, elle évolue d’ailleurs qu’on le veuille ou non, hors décision, mais lentement et d’elle-même par l’effet de l’usage collectif qui obéit à des mécanismes internes à la langue et intègre des évolutions socio-politiques, plus lexicales d’ailleurs que grammaticales ou morphologiques même si ces dernières aussi ont lieu. C’est, dans tous les cas, l’usage collectif – la langue est collective et coercitive – qui détermine au final les évolutions non des décisions externes aux locuteurs et aux locutrices (je double volontairement ici, parce qu’il s’agit de personnes agissantes et que femmes comme hommes parlent et modèlent la langue, alors que la langue inclut masculin et féminin dans « locuteurs », le masculin portant le neutre).
Tout ceci nous rappelle surtout que parler n’est jamais innocent. Une langue porte cicatrices et marques du politique et de l’histoire. Faut-il effacer ces traces de l’histoire ou plutôt les éclairer? Une langue sans plus de traces, qui viserait à la transparence et perçue comme un décalque du réel dessinerait un horizon totalitaire. On n’en est pas là. On en est à constater que l’évolution sociale fait pression sur la langue et que la langue résiste car elle ne peut évoluer que tant que cette évolution est compatible avec son fonctionnement, ce qui n’est pas neuf.
À trop affirmer que la langue française serait sexiste, non seulement on dit une sottise – la langue porte cicatrices du sexisme, comme du racisme, comme de l’inverse, elle porte mémoire de toute notre histoire dans son ambivalence-, mais on touche à son histoire et à son système grammatical. Inversement défendre une langue immobile et intangible, qu’outragerait toute évolution, est mortifère. Les langues sont vivantes. Elles muent, meurent aussi en donnant naissance à d’autres langues. Elles sont à notre images, complexes, ni innocentes ni transparentes. Vouloir infléchir de force idéologiquement une langue va-t-il univoquement dans le sens d’un surplus d’égalité incontestablement nécessaire ou en même temps vers une perte de mémoire et une vaine complication? Je ne crois pas qu’on puisse vaticiner avec assurance à ce sujet.
Les écrivains et poètes, dont je suis, sont plutôt du « genre rétif » aux ingérences idéologiques et du « genre inventif » par rapport à la langue. Ils jouent avec. Ils l’expérimentent. Ils prennent le risque d’essayer, de proposer des possibles langagiers, mais ne les imposent pas. Des écrivaines ont travaillé depuis longtemps sur le « e » perçu comme une féminisation de la langue, d’autres ont rejeté cette mainmise du politique sur la langue sans être pour autant moins attachées aux droits et à la visibilité des femmes, considérant que ces derniers passaient moins par ce « e », de surcroit muet, que par l’impact et la reconnaissance d’une création littéraire des femmes, qui, comme l’écrivait Virginia Woolf, doit explorer l’entier territoire de la langue et s’emparer de toutes les thématiques et de toutes les formes sans être confinée aux questions du féminin. Aucune artiste, aucune écrivaine, aucune autrice n’accepterait plus que son travail soit qualifié d’écriture, de peinture féminines, mais le préjugé et les attentes les y assignent encore parfois implicitement ou les écartent de l’histoire commune. Les travaux de « l’herstory » sont essentiels dans ce domaine et les questions liées. La création et la visibilité des femmes dans la langue passe-t-elle par sa modification ? Certains (et ce « certains » est au choix d’interpréter comme accord de proximité avec le mot suivant ou neutre porté par le masculin) auteurs et autrices travaillent en ce sens, d’autres n’en sont pas convaincus (neutre, qu’il faudrait dé-neutraliser en u.e.s). Pour les uns (un.e.s ?) comme pour les autres, le risque est pour toutes et tous le même (le chiasme vaut ici en efficacité le point tiret) d’aboutir au chef-d’œuvre, qui influera sur la langue, ou au fiasco total.
Pour l’écrivaine que je suis, c’est la liberté et l’inventivité qui importent. Que ceux et celles qui sont convaincues (accord de proximité au risque qu’on entende peu de convaincus !) de la nécessité de l’inclusive, par exemple, l’emploient donc dans leurs livres, leurs articles, leurs discours. L’illustrent, la diffusent. Nous verrons si ça fonctionne et si ça prend.
On peut avoir des convictions, des utopies, des craintes, mais on ne décide pas de la langue seul.e (essayons donc l’inclusive) ni non plus seulement par décret aussi bien intentionné soit-il. Et il faut l’espérer car si de l’idéologique, quel qu’il soit, parvenaient aisément à modifier la langue pour la rationaliser dans son sens, la pensée et la liberté seraient en grand danger. Le débat et les points de vue contradictoires ont, eux, le mérite de les alimenter. Au final, la parole revient aux locuteurs à la fois collectivement et singulièrement. Car si la langue est collective et extérieure à soi en tant que système, nous l’actualisons chacun et chacune singulièrement – c’est notre style, notre manière de parler, d’écrire- et en avons une expérience personnelle et même intime.
Les relations à la langue et notre attitude face à elle recouvrent aussi de l’histoire personnelle, de l’inconscient et des affects. Je n’ai jamais vécu la langue française comme m’excluant, mais, au contraire, comme une alliée dans la construction de ma personnalité, la conquête de ma liberté, l’expression de ma pensée et de ma possibilité créatrice. D’autres expériences peuvent ressentir la langue comme plus marâtre que maternelle ou effaçant le féminin. Nous différons, ce n’est pas une découverte. Cela se nomme la singularité, que la langue conjugue sans problème avec le commun. Et non l’identité voire l’assignation identitaire, qui le met en cause.
Tout écrivain ne cesse de travailler la langue et d’en proposer des mutations, qui se révèleront viables ou pas. D’y mettre du je (de la singularité) et du jeu dans les rouages de l’idéologie, qui la rigidifie toujours en langue de bois doctrinale. En tant que poète, j’ai choisi depuis longtemps, par exemple, de dire « une poète » car poétesse a une connotation, pour moi, un peu vieillie, l’article suffit et « poeta » en latin étant du féminin, aux hommes de se nommer poét à pousser jusqu’à l’absurde ce prétendu « e » féminisant, qui ne l’est que pour l’adjectif ! D’autres autrices, en revanche, préfèreront revitaliser poétesse et je ne sais pas lequel des deux usages l’emportera ou si les deux cohabiteront. En tant que poète, poétesse, écrivain, écrivaine, j’ai une relation sensible, sensuelle et même charnelle à la langue, j’entends donc très bien comme une revendication de corps ce « e », significativement muet d’ailleurs, tant le corps et le désir des femmes ont été bâillonnés, mutilés, asservis, humiliés et le sont encore. Je ne peux pas être sourde à cela.
J’ai vécu comme toutes l’expérience de dévalorisation du féminin, j’ai combattu ma vie durant cette dernière, mais je n’ai jamais ressenti la langue comme responsable ou ennemie. La langue m’a donné parole ou je l’ai prise dans la langue. Quand on touche la langue, on touche aussi à l’intime et symboliquement aux corps. Les propositions d’amendement de la langue comme l’inclusive apparaissent pour certaines et certains inscription légitime du corps féminin dans la langue, agression pour d’autres. C’est, dans tous les cas, le corps des femmes qui fait effraction dans l’espace public comme dans les questions du harcèlement et des violences. De là l’âpreté et l’instrumentalisation qui dominent le débat. Car il touche aux corps des locutrices et des locuteurs. C’est à eux et à elles que revient la possibilité d’influer sur l’usage par l’usage.
Cela ne me convainc pas pour autant que la langue soit la bonne cible ni l’inclusive, l’accord de proximité ou de majorité, les bons moyens. Pour des questions de cohérence langagière déjà évoquées, mais aussi parce que ma conviction est que l’émancipation passe par les singularités, dont celles des femmes, non par l’identitaire, qui m’est toujours apparu comme l’idéologie par excellence de l’ultralibéralisme et l’outil de fractionnement des solidarités qui pourraient s’y opposer. Mais il est bien que les locuteurs et locutrices s’emparent de ce qu’ils proposent, en étendent l’emploi à des livres complexes. À écrire on prend des risques, à inciter les autres à suivre des chemins que l’on n’a pas expérimentés dans toutes leurs conséquences, c’est déjà moins risqué… Pour l’écrivaine que je suis, c’est le risque qui fonde l’écriture, la confrontation aux regards des autres.
Qu’on illustre donc ces propositions, on en est tout fait libre, mais je regimbe devant leur inscription forcée dans l’usage. Car cela renvoie à de multiples questions et pas seulement à celle de l’affichage du féminin. Par exemple est-on toujours et continument genré ou l’est-on variablement en situation ? L’est-on toujours quand on écrit ou quand on est sujet de parole ? Certes l’écriture s’enracine dans le corps, mais la réduction de l’écriture des femmes à la plainte ou à la louange du corps comme à la révolte sur leur condition est la première des assignations réductrices, une ghettoïsation, qui gomme à la fois leurs singularités multiples et le commun d’une humanité, dont le mâle a été et demeure trop souvent le « patron » au double sens de modèle et de maître. Akhmatova est épique, Tsvetaieva non réductible à un propos « féminin » quand en outre ce terme même est une construction sociale. Le « tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition » de Montaigne est à entendre comme tout humain portant cette forme entière quand le mot « homme » en français ne désigne pas le mâle, mais l’humain. Dommage qu’il n’y ait pas de « Mensch » allemand, mais « humain » fait l’affaire ! C’est donc à la fois expérience subjective et conviction qui s’expriment dans ma réticence. J’ai des compte à régler avec le patriarcat et la domination, mais pas avec la langue maternelle ni avec le lien paternel. Peut-être à cause d’une ascendance résolument libertaire. C’est mon histoire, ma singularité, ma décision aussi. Elles ne m’empêchent pas d’entendre celles des autres. Ni d’avoir ponctuellement recours à la féminisation forcée selon le contexte, la situation d’énonciation et la visée de mon propos. Les poètes et poétesses sont diables et diablesses qui ne se privent de rien en matière d’exploration langagière ! Car travailler la langue, y expérimenter, est aussi un plaisir, dont il sort « bonheurs d’écriture » comme la langue le dit justement ou échec de la tentative.
Ce qui compte dans une langue c’est son efficacité, sa souplesse, sa richesse en terme de communication certes, mais aussi de pensée et de création. Si on n’envisage la langue qu’en termes de « communication » et d’affichage politique, dans une illusoire transparence au réel, on oublie sa fonction essentielle que Saussure nommait poétique et on instaure la croyance en une adéquation du mot à la chose et en une transparence mirador telle que d’ailleurs la rêve et la diffuse la « com » de l’idéologie dominante. Toute manipulation idéologique d’une langue peut autant aboutir à des mutations émancipatrices et productrices de sens que finir en victoire d’une « com » simplificatrice sur la pensée. Sous la poussée de mutations sociales apparaissent des possibles qui ne sont ni à rejeter en bloc en brandissant l’anathème ni à sacraliser en panacée, ils peuvent avoir un impact comme n’être qu’épiphénomènes passagers. Dans tous les cas, le débat, lui, signifie.
Qu’en restera-t-il langagièrement ? Certaines propositions se révèleront sans doute viables d’autres non. Certaines, comme l’inclusive, peuvent aisément entrer dans un usage restreint, administratif par exemple, plus difficilement dans un ouvrage littéraire ou philosophique car l’écriture en devient acrobatique et la signification plus parasitée qu’éclaircie. Que ceux et celles qui défendent ces évolutions les mettent donc à l’essai dans leurs écrits, on prêche mieux par l’exemple que par l’injonction. La parole reviendra, au final, aux usagers et usagères car elle leur appartient.
Suis-je du genre mi chèvre mi chou à considérer les aspects contradictoires de la question ? Plutôt du genre poétique (qui signifie étymologiquement fabricant) à préférer la complexité et la nuance aux simplifications et l’esprit critique aux diktats idéologiques d’où qu’ils viennent, du genre rétif aux catégories, aux étiquetages et normalisations, du genre à prôner la singularité et à se méfier de l’identité et de ses assignations, – serais-je d’ailleurs, au passage, à classer gender fluid ou queer que mon écriture ne le serait pas pour autant quand le premier critère du poétique est d’abord et seulement sa poéticité…-, bref, du genre mauvais genre (c’est, en général, le lot des artistes) à préférer le libre jeu ouvert de la créativité, de l’imaginaire et les tentatives qui se confrontent à la création langagière plutôt que les décrétales. Au final, d’un genre humain ambivalent, volatile, incertain, complexe et ambigu, inventif et faillible, pour lequel il n’y aura de liberté véritable que si elle se conjugue à l’égalité réelle de tous ses membres délivrés de toutes les formes de domination. De cette nécessité je suis convaincue sans réserve, depuis toujours activement défenseuse, mais moins persuadée qu’elle passe par l’infléchissement forcé d’une langue. Il faut voir à l’usage, essayer, tester, tenter, risquer plutôt que de chercher à imposer dans l’instrumentalisation et la réduction d’une langue à un enjeu politique. À chacune et chacun de prendre ses risques quand la langue est toujours commune et écrire un pari risqué.
Claude Ber
CLAUDE BER

Ph.© Adrienne Arth
Source
■ Claude Ber
sur Terres de femmes ▼
→ Il y a des choses que non (note de lecture d’AP)
→ Épître Langue Louve (note de lecture d’AP)
→ In memoriam (extrait d’Épître Langue Louve)
→ La mort n'est jamais comme (note de lecture d’AP)
→ Je dis mer (extrait de La mort n’est jamais comme)
→ Les mots, le vent, les herbes racontent (extrait de Mues)
→ Sinon la transparence (extrait du recueil Sinon la transparence)
→ Vues de vaches (note de lecture d’AP)
→ Claude Ber, Pierre Dubrunquez, L’Inachevé de soi (note de lecture d’AP)
→ (dans l’anthologie poétique Terres de femmes) le miel à la bouche
■ Voir aussi ▼
→ le site de l’écrivain Claude Ber