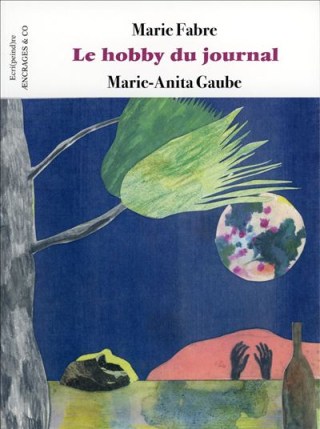Petite suite cap-corsine (extrait)
À la mémoire d'Augustin Meria, mon cher capitaine
À la mémoire de mon ami François Belfato, maçon-poète

"Le Cap Corse sens dessus dessous
Photo-Collage de G.AdC sur des photos d'Angèle Paoli
I. Topographie
C’est une échine maigre, la peau sur les os, un paysage toujours au bord de l’écroulement, surtout côté ouest, le plus violent. Le rocher et sa pente dictent leur loi, qui devient brutale avec les orages et les vents toujours plus déchaînés : éboulis, routes coupées, ponts détruits. À coups de barre à mine – dont les emplacements sont par endroits encore visibles – une ingénierie conquérante a taillé la route côtière célèbre pour ses virages, ses à-pics et pour les frayeurs qu’elle suscite chez les non-initiés. Une ingénierie régulièrement mise en échec et contrainte d’inventer les moyens, sans doute de plus en plus coûteux, de maintenir praticable ce lacet spectaculaire qu’on appelle la « route du Cap ». Elle sinue à n’en plus pouvoir, et tant bien que mal relie entre eux des villages qui ne se voient pas l’un l’autre. Certains s’accrochent à fleur de pente, comme repoussés au bord et prêts à dégringoler dans la mer : c’est ainsi que Minerbio m’a toujours paru en danger imminent, en équilibre précaire, comme Marinca où un mur de soutènement retient une partie du village.
Parfois pourtant, la pente s’adoucit, le paysage s’évase et laisse place à des étagements moins abrupts, comme à Barrettali ou, mieux encore, au bout du Cap, lorsqu’on quitte la route principale pour un étroit filet de bitume qui descend en douceur vers l’extrémité de ce monde-là, les minuscules villages de pêcheurs de Tollare et Barcaggio, séparés par une plage si belle et sans apprêts qu’on y retournerait encore et encore, saisis par la quiétude les jours de calme mais avec sous les yeux le rocher déchiqueté de la Giraglia et son phare pour rappeler que la violence des éléments n’est pas à prendre à la légère.
Des rochers donc, de l’austère en bien des endroits, une nature mise à l’épreuve sans cesse et d’un abord difficile pour les hommes qui ont vécu là. En face, la mer, presque toujours, sauf dans quelques courtes vallées qui s’insinuent vers l’intérieur. La mer, mais pas toujours jusqu’à l’horizon. Car lorsqu’on remonte la côte Ouest vers le nord, la vue s’arrête aux terres des Agriates, qui forment un profil délicat de l’autre côté du Golfe, parfois une série de paravents bleutés qui s’avancent doucement dans la mer, parfois au contraire une peau au grain net, d’une matérialité exacerbée, selon les variations de la lumière et des vents. Puis, passé Nonza, les contours du Golfe s’éloignent peu à peu et reste la mer elle-même, dont les changements d’état pourraient occuper une vie. L’exaltation peut venir les jours de libecciu, lorsque l’écume est violente et les couleurs de l’eau très denses sous un ciel blanc. Et la plus grande douceur, l’apaisement, les jours où une mer lisse, d’un bleu presque pâle, se fait à la fois matrice enveloppante et incarnation d’un infini familier.
II. Asymétrie
Le Cap, ses rochers, ses pentes sauvages, ses promontoires vertigineux, ses virages de mal de mer, oui. Mais il faut se souvenir qu’ici règne l’asymétrie. La vérité de l’Ouest, même avec ses nuances, n’est pas celle de l’Est.
On le pressent en arrivant au bout du Cap, on en est sûr en admirant la vue depuis Rogliano, un paysage qui fait place désormais aux ondulations s’abaissant vers la mer plutôt que d’y chuter abruptement. Les verticales deviennent des obliques plus ou moins fortes, les vallées s’évasent et s’allongent, les marines ne sont plus à l’à-pic du village mais au bout d’un cordon ombilical qui les relie assez tranquillement à des séries de hameaux réfugiés sur les hauteurs. On en a fini avec les précipices, les conducteurs peu aventureux peuvent désormais souffler et longer tranquillement la côte, faire une pause sur une plage de bord de route.
S’ils sont un peu curieux, ils remonteront pourtant les vallées vers Meria ou Pietracorbara ou Sisco, et découvriront des mondes plus terriens que maritimes, des villages de pierre qui résistent mal au glissement généralisé des populations vers les lotissements de bord de mer ou les villas plus ou moins luxueuses. Oui, les vallées sont sans doute plus surprenantes, chacune d’un dessin différent, certaines plus courtes et resserrées, d’autres plus larges et douces.
Il paraît que la vallée de Sisco, peut-être la plus hospitalière, était une terre de paysans plus que de marins, qu’on y cultivait des oignons réputés et produisait du lait. La vallée de Meria eut sa mine d’antimoine, celle de Luri ses vignes, ses vers à soie, ses cédratiers. Chaque vallée est un monde et raconte une histoire singulière. Mais ces histoires sont closes ou à réinventer pour que ce Cap de l’Est ne s’étrécisse pas en un ruban maritime qui renoncerait à toute profondeur, qui abandonnerait ces chemins privilégiés reliant la mer aux crêtes rocheuses avec des ponctuations de ruisseaux, de chapelles et de fontaines.
III. Déchaînements
Beau temps calme sur le Cap Corse, lumière, chaleur peut-être, paysages bordés de douceur maritime. Alors le libecciu se lève. Il emporte avec lui la mer. Il la creuse et lui fait battre galets et rochers en soulevant des bouffées d’écume. Les vagues submergent les jetées des minuscules ports de pêche, elles frappent les anciennes maisons de pêcheurs des marines construites au ras de l’eau, elles dévorent les plages, rongent les tours côtières, dispersent leurs embruns à des hauteurs inattendues. Le ciel est blanc, l’eau d’un bleu intense crêtée de moutons blancs, la hauteur des vagues se compte en mètres. Ce n’est pas l’Atlantique mais c’est violent, et dangereux.
Si tu es en mer et que le libecciu pointe au loin, tu ne fais pas le malin, tu rentres sans attendre. Sauf si tu fais partie des incroyants, de ceux qui pensent que la Méditerranée est une baignoire ou de ceux qui ne pensent rien et se laissent surprendre. Ceux-là, il faudra peut-être aller les chercher à la nage ou avec un bateau de secours qui disparaît dans les creux sous le regard de dizaines de badauds massés le long de la route côtière. Ceux-là peut-être ne se méfieront pas plus du feu qui s’engouffre l’été dans le sillage du libecciu. Un feu presque toujours sans origine connue, un sauvage furtif qui balaie les pentes, dévaste, tue cette végétation admirable d’opiniâtreté qui s’accroche encore et encore jusqu’à ce que vraiment plus rien de vivant ne soit possible. Le feu menace, coupe les routes, parfois lèche les villages. On guette celui qui a pris de l’autre côté du Cap et qui peut-être passera le sommet de la montagne. Il passe, il dévale l’autre versant, approche des premières maisons, qui ont été évacuées. Tu le regardes faire depuis la terrasse, ton grand-père te tient la main. Heureusement, les canadairs finissent par arrêter sa course. Mais la montagne est abîmée, les squelettes d’arbres craquent comme des os, le sol est noir ou gris de cendres, l’odeur de brûlé persiste. C’est un désastre qui se répète, même si au fil des années la lutte est devenue moins inégale, avec des hommes prévenus et plus aguerris. Mais qui peut vraiment lutter en même temps contre le feu qui file à son aise et un vent qui domine le ciel ? Qui peut faire mieux que calfeutrer les portes et les fenêtres, fixer les volets, mettre les barques à l’abri et se tenir éloigné des possibles écroulements ?
Arrivent les orages. On disait autrefois qu’ils venaient après le quinze août, comme des oiseaux migrateurs. Ce calendrier ne tient plus, il se dérègle aussi, sûrement. Orages, en juin, en août, en janvier, pluies diluviennes. Elles font surgir à flanc de montagne des cascades éphémères, comme des vermisseaux qui se tortillent quelques heures puis disparaissent. L’eau tombe fort, ravine, arrache. Les ruelles empierrées des villages deviennent ruisseaux, torrents parfois. Tout part à la mer. Puis plus d’eau. Sécheresse qui dure des mois. Les réserves s’épuisent. On s’inquiète, pour maintenant et pour plus tard, pour l’été, quand le vide d’hommes se transforme en trop-plein. Il faudra bien de l’eau pour les habitants, les absents de retour, les touristes, les plaisanciers. Trop d’eau, plus d’eau, violences croissantes du climat. Comment négocier avec l’extrême ?
IV. Traces
Que tu passes en voiture, que tu marches sur les chemins qui mènent à la mer ou grimpent vers les hauteurs, tu ne pourras pas les rater. Ils luttent contre la pente un peu absurdement ces murets de pierre sèche qui continuent de dessiner des terrasses depuis longtemps abandonnées.
Si tu as un peu d’imagination et un peu de curiosité pour le labeur des hommes, tu commenceras à mesurer ce qu’il a fallu de misère et de courage, mais aussi d’ingéniosité pour bâtir ces kilomètres de murs destinés à accueillir et retenir le peu de terre disponible. Tu les vois à moitié ruinés aujourd’hui, sauf ceux qui soutiennent de rares potagers de village, ou dans quelques microscopiques territoires où ils bordent encore des vignes cultivées soigneusement. Ils ont pourtant fait face, pendant des décennies, un siècle ou plus, avant de lâcher prise lentement, attaqués par le vent, la pluie, la végétation, vaincus par l’abandon, à moins qu’un individu ou une association ne décide d’en remonter quelques mètres en hommage aux générations passées ou par besoin de ne pas laisser la décision au temps.
Si tu as de la chance, peut-être rencontreras-tu un amateur de traces, un lecteur de paysages qui te dévoilera, en luttant contre les broussailles et les éboulis, un peu de la complexité des lieux. Il te fera suivre les rigoles d’irrigation desservant les jardins nourriciers, il te montrera les multiples bassins qui recueillaient l’eau, il te fera visiter quelque abri de pierre avec sa fausse voûte en dégradé, il te fera remarquer les escaliers pour géant – de simples pierres plates fichées dans le mur. Il remettra de l’intelligence et de la vie dans ce qui ne t’évoquait qu’un temps définitivement mort, et tu lui en sauras gré.
Peut-être même qu’il t’aura donné l’envie de poursuivre ces explorations, à la découverte de la plus modeste des chapelles de pierre, posée là on ne sait pourquoi, à la découverte de bergeries abandonnées dans un site grandiose dont tu ne révèleras l’emplacement qu’à des personnes de confiance, à la recherche d’aires à blé semblables aux vestiges de cercles rituels, et de tant d’autres constructions qui te relient pour un moment à une histoire lointaine.
Il te faudrait une chance presque miraculeuse pour que ces pérégrinations te mènent jusqu’à un maçon des pierres, un qui sait encore monter avec art un mur de pierres sèches, choisir, agencer, équilibrer, trouver la place juste. Tu verrais comme c’est subtil, tu admirerais ce simple comptoir ou ce four à pain, ces quelques mètres carrés qui demandent temps, patience et adresse. Tu observerais les variations de la pierre, les nuances de couleur, tu prendrais le temps de caresser ce mur encore chaud de sa journée d’été.
Mais tout ça sans nostalgie, non. Car qui pourrait être nostalgique de toute la peine contenue dans les tonnes de pierres charriées, taillées, assemblées, ce paysage humain qui, selon une réflexion que faisait souvent mon père, serait comme une réfutation tranquille de la légendaire fainéantise des Corses.
V. Trésors
Ce n’est pas une terre d’abondance. Ici ne pousse rien sans alliance avec le rocher et le vent: il faut amadouer un sol revêche et maigre et pentu souvent, déjouer les cailloux, ancrer profond sa survie. Il y faut de l’opiniâtreté, dont peut surgir la grâce: les œillets sauvages. Ils ne s’offrent facilement ni à l’œil ni au nez. À la fin du printemps, ils extraient des rochers ensoleillés leurs tiges graciles surmontées d’une corolle de cinq pétales effrangés – pas plus – d’un rose pâle ou plus dense. Une fleur sans grands éclats, mais pour qui sait se pencher, un parfum qu’il m’est aussi difficile d’oublier que de mettre en mots : léger et clair, un peu piquant, poivré peut-être. Mon grand-père, les matins de début d’été, lors de ses promenades sur la route qui fait face à la mer, en cueillait souvent un menu bouquet pour l’offrir à ma mère.
Ce sont les mots de René Char « pauvreté et privilège » qui me viennent pour évoquer ces fleurs et ces trésors végétaux étrangers à toute exhibition, qui n’existent que pour des passants attentifs. Ainsi des asperges sauvages, dont l’apparence ne laisse rien deviner de la puissance gustative. Pour les débusquer, il faut, au début du printemps, parcourir les terrasses et les chemins abandonnés, de préférence après quelques pluies, et repérer les pieds d’asparagus. Là, dans l’enchevêtrement des tiges plus ou moins piquantes, se dressent, solitaires ou en petits groupes, des asperges fines, d’un vert sombre, qui laissent échapper quand on les coupe un suc à l’odeur forte. Pour en cueillir une botte, il faudra peut-être se piquer les doigts, se mettre à genoux, s’aventurer dans des éboulis; parfois un petit cimetière de village pas trop entretenu fournira une cueillette inespérée grâce aux conseils d’un connaisseur qui, par amitié, vous a livré son lieu secret.
Et quand, pour le repas du soir, vous ferez revenir ces asperges à la poêle avant de les mêler à une omelette, quand vous partagerez ce plat avec quelques amis perplexes sur votre enthousiasme, quand vous verrez leur étonnement de découvrir un gout âpre et vert si éloigné de ce qu’ils associent aux asperges de leur connaissance, alors vous ressentirez de la gratitude pour l’ami complice, et aussi pour la terre dite ingrate qui peut concentrer de telles saveurs dans une plante apparemment sans qualités.
VI. Cousins d’Amérique
Du Cap Corse l’Amérique n’est jamais loin, qu’elle ait laissé sa trace dans le paysage ou dans les histoires de famille. Il y a bien sûr les maisons des Américains, ces demeures de modèle italien, hautes façades et toit à quatre pentes, terrasses à balustrade et jardins arborés. Chacune raconte une histoire de réussite, à Porto-Rico ou à Saint-Domingue, ou peut-être en Alabama. Un homme est parti, il a fait fortune dans des plantations ou dans le commerce, il est revenu inscrire sa réussite dans la pierrre et dans son paysage d’enfance. Une vaste maison pour la vie qui reste et la descendance, un fastueux tombeau pour la mort qui viendra, face à la mer de préférence.
Ces architectures d’enfants prodigues font désormais partie du patrimoine et de l’imaginaire local mais elles ne peuvent résumer à elles seules les aventures des Cap corsins partis en Amérique. Certains n’ont pas su faire fortune ou personne ne l’a appris car ils ont largué les amarres sans retour. Parmi ces fantômes, un parent inconnu qui proposait qu’on le visite aux Caraïbes pour parler tranquillement de sa part dans l’héritage d’une maison. Sa part ne valant pas le prix du voyage, la rencontre n’eut jamais lieu et l’identité même de l’homme s’est perdue. D’autres absents ont joué, au sens propre, le rôle d’oncle d’Amérique, mort et enterré là-bas, mais dont le legs permettrait aux heureux héritiers d’ici de s’inventer une vie nouvelle.
D‘autres encore, qui ont bâti leur vie et leur maison par-delà l’Atlantique, apparaissent de temps à autre et nourrissent un imaginaire qui fournit à de nombreux habitants des cousins d’Amérique. Dans mon village, ils revenaient l‘été, de loin en loin, avec leur famille. Avec eux arrivait une langue, l’espagnol, la seule parlée de leurs enfants et de leur femme ou de leur mère. Ils apportaient les images d’un ailleurs métissé, palmiers, haciendas, aisance financière.
Certains, nés et grandis dans la Caraïbe, mais porteurs encore des histoires d’une grand-mère nostalgique morte depuis longtemps, reviendraient in extremis déchiffrer les traces du passé familial. Ils demanderaient à visiter la maison natale de la grand-mère, ils feraient la connaissance de vagues cousins avec lesquels ils échangeraient plus de sourires que de mots, faute de langue commune, ils finiraient pas découvrir une cousine hispanophone qui leur traduirait les souvenirs de son vieux père, pour lequel les fantômes qu‘évoquait la grand-mère émigrée avaient été des êtres vivants. Et à la fin de la conversation, la cousine de Porto-Rico se tairait subitement en fixant le visage de son lointain parent. Elle se tairait d’émotion parce qu’elle aurait retrouvé dans son visage à lui les traits de son frère à elle, déjà mort. Une ressemblance plus forte que le temps passé et la distance, comme la résurgence de traits communs entre deux êtres qui avaient vécu sans se connaître dans deux îles aux antipodes. Comme une résurrection d’un instant, un aller-retour express Cap Corse-Porto-Rico-Cap Corse. (Petite suite, dans quelques jours)

Photo de Mathias Fournel-Meria
Maria Meria in Litteratura n°5, pp. 25 à 29, 2023.