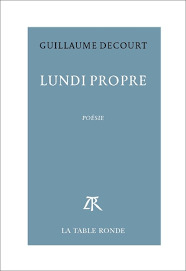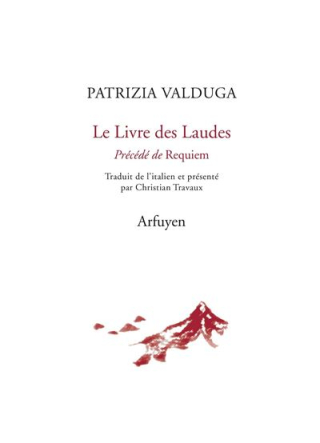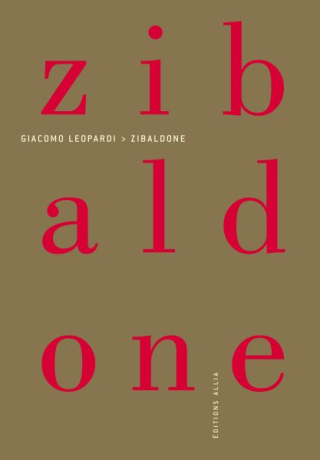A. Du Bouchet / J.-M. Reynard
Regard de l’indifférencié
Correspondance 1977-2001
Éditions le Bruit du temps, 2023
Lecture d’Angèle Paoli

Ph. DR
Regard de l’indifférencié
« Si vous arrivez à vous rejoindre à travers cette dépossession qui est une donnée de départ, vous pouvez du même coup rejoindre quelqu’un d’autre à l’infini. Il y a quelqu’un d’autre qui se reconnaît dans ce que vous avez écrit, et un échange redevient possible. » (25)
Ainsi s’exprime André Du Bouchet dans les Entretiens avec Alain Veinstein. (1979-2000)1
Si un vrai dialogue a eu lieu entre André Du Bouchet et Alain Veinstein, un échange profond a eu lieu avec Jean-Michel Reynard, poète et essayiste. Échange intellectuel et amical sur la langue, la poésie et la peinture, véritable partage d’idées, de réflexions, de goût, de sensibilité aux choses et au monde. Partage attentif « de cette matière commune de mots et de choses ». Parce que Jean-Michel Reynard, né en 1950, s’est intimement reconnu dans l’écriture d’André Du Bouchet, son aîné de vingt-six ans, et que cette écriture dont il s’est longuement nourri, a donné naissance à L’Interdit de langue, Solitude d’André Du Bouchet, essai qui a couronné le travail de lecture et d’annotations de Reynard. En amont, il y a une correspondance importante entre les deux poètes, preuve qu’ils étaient en confiance l’un avec l’autre depuis longtemps. En réalité leur première rencontre remonte à l’hiver 1976, dont l’on doit l’initiative au poète Jacques Dupin. Cette correspondance entre les deux poètes a duré vingt-quatre années, de 1977 à 2001. Écorché vif, homme d’émotion, d’une sensibilité exacerbée, Reynard place André Du Bouchet très haut, du côté de l’inatteignable. Très à l’aise dans l’art de pratiquer la prétérition et la confidence, Jean-Michel Reynard se livre puis finalement s’en veut ; avance des réponses possibles de Du Bouchet qui souvent réserve sa réponse ; ou n’en livre qu’une partie :
« Au fond, ma maladresse aura peut-être permis que je me précise cet aspect de votre travail. J’espère en tout cas que vous vous reconnaitrez mieux à présent et, encore une fois, que vous me pardonnerez ″l’ombre″ absurdement jetée par ce que je vous avais écrit. En attendant de vous revoir.
Bien affectueusement. Jean-Michel » (10/1981), p.54)
C’est cette correspondance, – Regard de l'indifférencié – à la fois difficile et passionnante mais aussi émouvante, qu’Antoine Jaccottet met à notre disposition dans sa maison d’édition « Le Bruit du temps ». Avec la complicité, la coopération et les regards croisés de Gilles Du Bouchet, de Corinne Blanchaud et de Clément Layet sur l’échange épistolaire entre les deux poètes. 2
La question du regard et de « l’indifférencié », qui donne son titre à cette correspondance, est présente dans les dernières lettres datées de juin 2000. Reynard évoque « l’identité indifférenciée conglobante de l’espace-temps » à quoi André Du Bouchet propose « l’unique réponse à laquelle il croit » :
« sur soi le droit de regard de l’indifférencié qui nous emporte, peut pour chacun de nous devenir son propre regard. »*
Et Clément Layet d’ajouter dans sa postface ce commentaire éclairant :
« Cette parole n’est susceptible d’aider Reynard, et aujourd’hui de nous aider, que parce qu’elle n’est pas spécifique à André Du Bouchet, et parce qu’elle fait pourtant retentir une voix qui n’appartient qu’à lui. Elle n’est pas différente, en son esprit, d’une parole de Reverdy, vis-à-vis duquel Du Bouchet s’était situé comme Reynard par rapport à lui-même :
« si l’homme disparaît, il reste la terre, les objets inanimés,
les pierres sans chemin. Si la terre disparaît, il reste tout
ce qui n’est pas la terre. Et si tout ce qui n’est pas la terre
disparaît, il reste tout ce qui ne peut pas disparaître** […] 3
Pour trouver sa langue, pour surmonter le défaut de sa personne : adopter le regard de ce « qui ne peut pas disparaître », fût-t-il cause d’une disparition universelle. »
La dernière lettre écrite par le poète André du Bouchet est datée du 26 février 2001, un mois et demi à peine avant la mort du poète, survenue le 19 avril de la même année. La première lettre, signée Jean-Michel Reynard, est datée du 18 mars 1977. La correspondance entre les deux poètes s’est effectuée de manière discontinue, avec parfois des espacements importants. Cependant comblés par des rencontres, notamment dans la Drôme où résidait souvent André Du Bouchet. Entre le début de cet échange épistolaire et la fin, le rythme et l’importance des propos se sont accrus et accélérés. Jean-Michel Reynard, passionné par la poésie de celui qu’il considère comme son maître, est alors un poète débutant, qui recherche dans l’aîné qu’il admire, son amitié, ses conseils, son regard critique ; mais aussi sa reconnaissance et son appui. L’œuvre d’André Du Bouchet, que Reynard analyse avec justesse et acuité sert au jeune poète de base de réflexion sur la langue, le langage, le rapport entre les mots et les choses. Sa formation philosophique lui permet d’aborder en profondeur les questions qui se posent à lui et qu’il adresse aussi à son correspondant. Ces échanges, de plus en plus nourris, même si une certaine disproportion se laisse entrevoir entre les longues lettres passionnées de Reynard et les réponses beaucoup plus resserrées de Du Bouchet, vont servir à Reynard pour la rédaction de l’essai qu’il consacrera plus tard à son maître : L’Interdit de langue, Solitudes d’André Du Bouchet. Essai dans lequel Reynard tente de saisir, derrière la « relativité » de l’écriture, le « violent sentiment de présence » que suscite la lecture des œuvres de Du Bouchet, « présence qui se vit pourtant, aussi bien comme une exceptionnelle épreuve de solitude. »
Cet essai paraîtra chez Fourbis en 1994.
Selon Gilles Du Bouchet, auteur d’un texte préliminaire à cette correspondance, L’Interdit de langue révèle que Jean-Michel Reynard a « conceptualisé » dans cet essai le « phrasé souterrain » de l’œuvre maîtresse et testamentaire qu’est L’Eau des fleurs. Ouvrage posthume, publié en 2005, deux ans après la disparition, en 2003, de son auteur âgé de 50 ans, L’Eau des fleurs est méditation autant que confession, œuvre nourrie en profondeur de la lecture d’André Du Bouchet ; de la réflexion autour de son travail de traducteur et de leur correspondance à tous deux. De cet ensemble de matériaux et annotations diverses, naîtra aussi, bien avant le recueil poétique L’Eau des fleurs, l’essai consacré à Du Bouchet : L’Interdit de langue.
Dans les deux ouvrages, l’on retrouve les préoccupations personnelles de Reynard, ses interrogations permanentes sur la langue, les conflits internes sur lesquels reposent ces interrogations. Mais peut-être, contrairement à L’Interdit de langue, L’Eau des fleurs est-il davantage un livre de « convalescence » et de sortie de crise dont l’auteur n’aura pas eu le temps de jouir.
À l’époque de leur rencontre, André Du Bouchet qui est aussi traducteur (Shakespeare, Mandelstam, Celan, Faulkner) et collabore à la revue L’Éphémère, travaille avec des artistes tels que Miklos Bokor, Pierre Tal Coat, Bram van Velde, Alberto Giacometti. Le lien entre écriture et peinture est un lien étroit, en dialogue permanent, qui touche à la diversité des langages. À la porosité qu’ils ont en partage. Cette passion de Du Bouchet pour tout ce qui a trait aux différents matériaux du langage, Reynard va l’habiter à son tour.
Dans la première lettre qu’il adresse à André Du Bouchet (lettre du 18-3-77) Reynard fait allusion à la charge qui a été confiée à son « maître ». Du Bouchet est en effet lecteur des manuscrits de poèmes pour le Mercure de France. Bien qu’hésitant et se disant « démuni » dans la démarche qu’il s’apprête à entreprendre, Reynard écrit :
« Pourriez-vous alors m’apporter simplement quelques indications qui me seraient précieuses, quelques conseils, ou repères qui me font défaut ? » … (p.34)
Suit un silence de plusieurs mois qui n’en est peut-être pas un puisque les deux poètes se rencontrent de manière intermittente et que par ailleurs la correspondance est incomplète. Il y a des blancs dans l’échange entre les deux hommes, comme il y a des blancs et des silences dans la poésie de Du Bouchet. Au fil du temps, André Du Bouchet élargit sa palette de sentiments envers son interlocuteur. Il l’encourage, le réconforte, le rassure sur lui-même et sur les doutes qui obsèdent sa nature inconsolée. Cependant, Du Bouchet préconise la « décantation » : ainsi dans cet extrait d’une lettre qu’il adresse à Reynard :
« Enfin, il me semble que ces pages, il faudrait qu’elles reposent un peu – leur accorder le temps de la décantation, en reprenant ce qui le lendemain tient toujours à vos yeux sans malentendu ni euphorie, et privé de l’élan qui à mon sens les déporte continuellement… » (p.101)
Mais il sait aussi reconnaître les qualités du poète Jean-Michel Reynard :
« Nécessité absolue de votre livre4 […] où je retrouve, au premier coup d’œil, ce qui m’avait retenu dans les poèmes lorsque je les avais lus il y a quelques années – et les voilà de retour, avivés, et eux-mêmes dans leur fractionnement qui n’a jamais été énigmatique, rendus de page en page à leur matérialité toujours en avant de soi, sans date par conséquent. Je m’en réjouis avec vous. André. » (p.124)
Sont également incomplets les « carnets » tenus tout au long de sa vie par Du Bouchet. Reynard revient à plusieurs reprises à ces fameux carnets qu’il aimerait pouvoir lire. Pour voir comment l’écriture évolue des textes non publiés à ceux dont l’écriture a été « retravaillée ». Reynard s’interroge sur le déploiement de ce qu’il appelle « la parole aléatoire ; celle qu’il dit sans destination ; détachée des contraintes temporelles ; destinées à la mobilité temps-espace…
« Ces plaques de langues variables […] s’articulent par des blancs, des silences, des retraits, des ajouts, eux aussi pour une part hors de tout projet cumulatif ou synthétique. » Et le poète de tirer de cette réflexion une analogie avec la vie :
« Mais n’est-ce pas ainsi que l’on vit, dès lors que notre vie, soustraite à l’apparence d’un projet, d’un but, d’un sens […] se révèle elle aussi constamment fragmentaire, provisoire, alternative… »
Et un peu plus bas :
« Vous écrivez comme on vit – on devrait vivre – et c’est pourquoi vous lire est si vivant – d’un vivant – vous-même – à un autre que vous forcez, si d’aventure l’inclination lui fait défaut- à vivre aussi, ou revivre. » (p.117)
Revenant un peu plus loin sur la notion d’aléatoire – « cette relativité qui fait qu’on ne peut se dispenser, vous lisant, de tout lire » – Reynard reprend son propos en insistant sur son désir de lire ces « carnets » dont Michel Collot a donné des extraits.
Les deux poètes avancent l’un avec l’autre, l’un épaulant l’autre, dans un échange de plus en plus nourri où la question de l’Autre se précise- dans des directions inattendues – et prend toute sa résonance sous leur plume respective. Celle de l’« ouvert » aussi occupe une place importante, avec l’aléatoire, le fragmentaire, l’émondage… et la nécessité en poésie et en peinture, d’aller contre.
Il reste encore beaucoup à explorer dans cette somme épistolaire. De quoi nourrir sa propre réflexion pendant des jours et des jours. Mais aussi de quoi méditer. Ce que je laisse à présent, à mes lecteurs et lectrices le soin de faire. Poursuivre la lecture de cet échange à leur rythme et d’en tirer tout le miel.
 Angèle Paoli / D.R. Texte angèlepaoli
Angèle Paoli / D.R. Texte angèlepaoli

Extraits
I.
Jean-Michel Reynard à André Du Bouchet
Paris, le 10-9-85
Cher André,
« Sortant » à l’instant d’une première lecture de vos pages 5 j’y retrouve, d’emblée, cette envie de rentrer en moi-même, au-dehors, que j’avais déjà ressentie après Peinture, qui m’avait dès lors suscité le désir d’en tenter, pour moi, la traduction que vous savez, et qui me fait vous écrire maintenant, plutôt qu’à tête reposée, à chaud, donc. Ce chemin extraordinaire qui va de la langue étrangère (l’exergue) à l’étrangeté intime de toute langue, à commencer par la nôtre – « je sais qu’il me reste encore à traduire du français » – , il est bien, à nouveau, celui de Peinture, mais à nouveau, aussi, relancé, revenant sur soi pour y incorporer le poids de la langue qui n’est jamais celui du monde, du point monde, de cette interruption que vivre, si par instants, j’habite, est incessamment traduire. Superbe départ que cette pensée de la soif : se désaltérer (boire, dire, marcher), c’est bien traduire le pays (langue incluse). Et du coup, par l’expérience de la soif, désaltérer retrouve son sens enfin, par quoi s’éclaire, dès l’ouverture, ce qu’il en est de la traduction de vivre : traduire → désaltérer, ce n’est pas en effet, ramener « l’autre » à soi, mais cet autre-à-moi-même que je suis d’abord, et toujours – étranger – à ce qui, par là, cesse, au moins momentanément, d’être l’Autre, – à soi. Je (me) traduis quand je cesse d’être autre à moi-même, au point où quelque chose comme ce moi-même peut alors, légitimement, être prononcé. Quelle émotion à lire : « ce qui toi, et toi seul, te regarde – ainsi la soif- ne m’est plus étranger » ! Comment ai-je pu écrire – en fait je le sais, je connais mon mal, ici, dans Le Détriment6 : « Ce que j’ai à te dire ne te regarde pas » … Il s’agissait là – il s’agit toujours, en un sens, de porter à cassure qui, sur cette cassure, ne peut que m’être retranché. C’était d’éprouver jusqu’au bout que la parole adressée à l’« autre » ne s’adressait alors qu’à ce qui, en cet autre-là, échappait à soi-même, à son désir, ou à ce qui se croyait tel jusque dans l’idée que je pouvais moi-même m’en faire […] Mais vous avez raison, André : bien avant que de s’épancher de l’autre, il y a à assumer sa propre soif, n’être plus, ou pas, par instants, l’autre à soi-même, autre que soi-même[…] Mais je me perds… Tout cela pour vous montrer au fond, ce que vos pages peuvent déclencher en moi quant à la nécessité de me ressourcer.
Ce que votre texte marque plus vivement encore, André, c’est donc cette matière de langue dont un des noms (une des choses) est monde, et qui fait qu’allant, la fendant, à vivre, comme une étrave la mer, je la dédouble – « langue au moins deux fois » – moi-même, du coup, fente de cette langue, ou langue fendue, mais à quoi, l’interrompre, en parlant , ou non, je désaltère mon « moi » à son dehors. Pardonnez-moi de dire si lourdement et si mal ce qui cingle de toute sa fraîcheur dans votre démarche. Tenir ces pages, c’est un peu tenir ce monde, cet ouvert qu’à défaut de pouvoir pareillement l’effectuer, le traduire, je pressens comme désirable, et donc désiré, déjà… » (p.102, 103,104)
II.
André du Bouchet à Jean-Michel Reynard, pp.103-104
[Sur l’enveloppe : 16-9-1985, Dieulefit]
le 15 septembre
Cher Jean-Michel, toujours vous aurez répondu à ma lenteur par la rapidité, et la pensée incisive – où plus d’une fois je me suis perdu. Car à tenter de penser la perception, et qu’elle reste perception plus encore que pensée dans cette matière de pensée qui est la langue, il est fatal qu’on se perde. Mais vous aurez su aussi que ces pages sont inscrites sur la lancée, souvent, de notre entretien- et plus d’une fois sans que je m’en aperçoive – ainsi du renversement inconscient de votre phrase « ne te regarde pas », mesure de l’attention que j’y ai prêtée et d’une objection que je n’étais pas parvenu à formuler. Là aussi, l’attention doit s’en remettre finalement à une inattention. Vous m’aurez soutenu au point où ces pages ne se soutiennent pas- votre attention, elle, jamais en défaut. (p.105, 106)
Bientôt, à vous
André.
_____________________________
1. André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein (1979-2000), « L’Atelier contemporain », François-Marie Deyrolle éditeur & Institut National de l’Audiovisuel, 2016, p.25.
2. Avant-propos de Gilles Du Bouchet ; Postface de Clément Layet ; Édition établie, présentée et annotée par Corinne Blanchaud.
3. Postface, p.259 :
*André Du Bouchet, lettre du 19 juin 2000, p.243.
** Pierre Reverdy, « En vrac », Œuvres complètes, II, Flammarion, collection Mille et une pages, 2010, p.818, cité par André du Bouchet, Matière de l’interlocuteur, Fata Morgana, Saint-Clément-de-Rivière, 1992, p.14.
4. Il s’agit du recueil de Reynard : Nature, et mortes, avec des gouaches de Jean Capdeville pour le tirage de tête, Ryoan-ji, 1987.
5. Il s’agit de « Notes sur la traduction » qui sera publié l’année suivante dans Ici en deux, Mercure de France, 1986 ; réédité avec une préface de Michel Collot, Poésie/Gallimard, 2011.
6. Le Détriment, op.cit. Les archives de Jean-Michel Reynard comportent des tapuscrits antérieurs portant le même titre (fonds Gilles Du Bouchet).