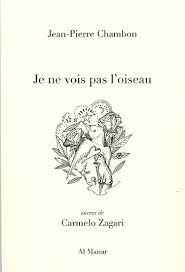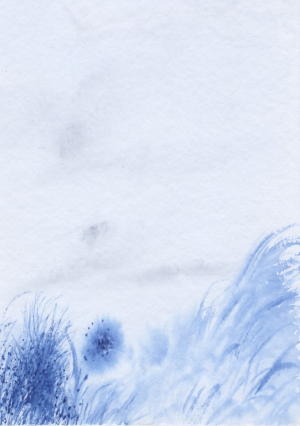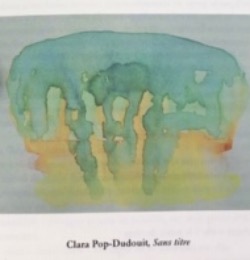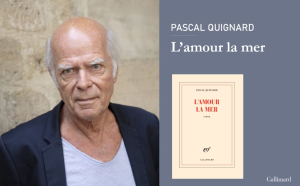→

Source
« IL FAIT PLUS CLAIR QUAND QUELQU’UN PARLE »
I
Restez vivants, dit la voix. Qui que vous soyez,
restez vivants à cause du vent lisse dans les roses
et dans vos délires. Restez vivants. Montrez-vous
avec vos syllabes et vos images. N’ayez pas peur
de toucher à votre mélancolie. Restez vivants
malgré les mouches et les brûlures, les petites
décorations, les armoires fermées de chacun.
Restez vivants les bras ouverts comme les pages
d’un dictionnaire. Respirez haut et fort entre les
signes, les miroirs, les petits croquis. N’oubliez
pas votre grigri et la grammaire latine. Restez
vivants malgré votre mère dans son bain, les
terroristes et les menteurs. Restez vivants dans
l’axe de la lune et touchez, touchez donc à vos
miroirs, aux bons endroits avant de vous
regarder partir. Restez vivants comme quelqu’un
qui n’est pas vous.
J’ai choisi d’ouvrir ce moment avec ce très beau poème de Nicole Brossard, poète québécoise d’aujourd’hui, parce qu’il me semble que, parmi les innombrables regards possibles sur la poésie, celui-ci va au plus juste.
Il y a dans tout poème, et quel qu’il soit, une injonction à devenir vivant. Tout poème est d’abord un appel.
Et c’est cet éclairage-là que j’ai choisi de porter aujourd’hui sur la poésie, sur son écriture et sur sa lecture. Nous savons tous qu’il y en a beaucoup d’autres.
« Je suis un homme qui pense à autre chose » disait Victor Hugo.
Cette autre chose, c’est la poésie. Toujours ailleurs que là où on croit l’attraper, la définir. Car n’est-elle pas un des noms de la liberté, celle que toujours la tyrannie des pouvoirs emprisonne, fait taire et assassine. Celle qui toujours comme l’oiseau phénix renaît de ses cendres. Celle qui toujours recommence sa voix !
Mon éclairage d’aujourd’hui est donc partiel, un peu partial et probablement dérisoire quand on pense à l’immensité, à la force du continent poétique.
Dans chaque poème une voix nous rappelle à la vie, nous remet au monde.
Cette voix est une voix qui vient de loin. Elle s’est glissée dans les mots, mais les mots le savent bien, elle les déborde de partout. Elle les entoure, elle les porte. Car c’est cette voix-là qui les a fait naître.
Les mots/ sont des pas/sur la neige ils gardent la trace …
Les mots / sont des pas sur la neige /ils s’y perdent souvent/ ils s’y enfoncent
La voix les retrouve/ qui berce la nuit
avec une douceur si jeune/ dans les doigts
avec une musique dans le corps/ où s’accroche le jour
la voix/ qui bâtit sa chair/ avec
Quel enfant en nous/ s’approche
qui regarde/ et qui n’a pas de mots/ encore
Quelle trace en nos yeux/ de cet enfant-là/ d’où nous naissons/
Quelle parole
Les mots/ sont des pas sur la neige nous avançons/ dedans
Ce qui tremble/ en nous/ dans le fond de la chair/
les mots/ le rassurent/ autour/ les mots l’apprivoisent
À l’enfant/ qui regarde et qui ne parle pas/
le lait obscur des mots/ coule en sa bouche à la chair se mélange
Cet enfant nous précède/ et nous cherchons sa main1
Cette voix qui nous appelle, poète et lecteur ensemble, vraiment ensemble, c’est effectivement une voix d’enfant, mais ce n’est pas la voix d’un enfant précis, et même pas celle du poète. C’est la voix de l’enfance en nous, celle que nous partageons tous. C’est une voix qui, sans cesse, cherche à nous réconcilier avec nous-même. Avec ce que nous avons égaré, perdu de nous, inéluctablement et depuis longtemps.
L’enfant, l’étymologie nous le rappelle, est celui qui ne parle pas, qui ne parle pas encore. C’est une voix d’avant les mots. Elle vient de cet immense espace où il n’y eut d’abord que des sensations. Elle vient du cri, du cri qui se module lui-même, et qui s’apprivoise. Pa/pa, ma/ma, Le tout petit commence par la rime nous fait remarquer le psychanalyste Gérard Pommier !
Nous apprenons le monde sans pouvoir d’abord le nommer. Nous apprenons le monde avec notre corps qui sera bientôt traversé par les mots des autres. L’enfant que nous fûmes tous est unique mais la langue accueillera bientôt ses expériences avec des mots qui sont à tout le monde, qui ne seront donc jamais totalement ajustés à ses propres sensations et pas plus à ses sentiments. Ce petit flottement, cet à-peu-près, cette indécision, notre parole à tous en porte définitivement la trace. Et vous voyez, Il semble bien que ce soit dans cette trace-là que les mots des poètes trouvent leur source. C’est ce pays perdu, ce temps oublié, c’est cet univers tombé dans nos veines que le poète tente de retrouver, de faire entrer dans les mots.
« Nous avons tous été chassés du paradis, disait Kafka, mais le paradis n’a pas été détruit pour autant. »
La langue bat/ contre le cœur // c’est
maintenant//
oui cette langue de parole/ au fond du souffle/ à
l’intérieur//
là dans les trous du vocabulaire//
Cette langue de chair / vient lécher tous les mots/
elle les soulève/ vers cet oubli seul/ qui les
rassure// qui les reconnaît2
Dans le discours on tente d’effacer cette voix au profit de la signification. On veut convaincre ou persuader, on veut faire partager.
« Tout ce qu’ils tentent de dire, de penser, n’est que la tentative d’assourdir leur propre voix. » disait déjà M Duras
Dans le poème, une expérience nous a brûlé, et c’est cette brûlure-là que les mots portent. Non pas seulement pour dire, mais pour éprouver, pour retenir cette brûlure et pour l’apprivoiser. Pour la rendre vivable et donc, peut-être, partageable. Pour la faire éprouver à son tour au lecteur, dans son corps à lui, dans sa vie à lui, dans sa manière toute singulière de la comprendre, c’est-à-dire de la prendre avec lui.
Car lire un poème c’est en faire l’expérience.
Alors la vie augmente. Pour le poète et pour son lecteur, la musique des mots, leurs sonorités, le rythme, les ruptures étonnantes dans la syntaxe, les répétitions, les néologismes… bref, tout ce qui fait un style montre que la langue poétique tourne toujours le dos à la langue de l’utile immédiat. Tout cela hallucine un autre monde. Mais il est dans celui-ci. Ce n’est ni un rêve ni un délire, simplement un élargissement, une ouverture vers d’autres possibles de nous.
Le poème parle le monde en le déshabillant de ses vieux vêtements et de ses habitudes, en le saisissant autrement « La poésie est un coup de gomme sur la réalité » disait Cocteau. « L’œil écoute » disait encore Claudel. On pourrait aussi ajouter que la parole voit. La parole du poète pose un autre regard sur le monde. « La poésie, c’est donner à voir » affirmait Eluard. On n’en finirait pas avec les définitions.
Car le poème ouvre sans cesse la porte de notre liberté. Celle qui inlassablement va inventer le monde en le regardant différemment, en le découvrant et en le faisant découvrir dans une autre parole.
Cet autre monde est en nous-mêmes, il vient de nos mots. Il vient de cette voix première, à jamais perdue au fond de notre corps et de notre mémoire, et pourtant toujours là dans son absence même. Nous viendrons au réel avec ce que nous aurons nommé de lui. Si nous voulons l’agrandir, l’ouvrir, il nous faudra lui donner une autre parole.
Car la voix, celle qui nous a transmis les mots est tombée dans les sensations qu’elle a provoquées. La poésie se glisse d’abord dans ces sensations et de là viendra frôler cette voix à jamais perdue. Elle viendra la toucher. En évoquant les sensations, les sentiments, elle nous ramène à leur source, à ce qui en chacun fait source. Elle ramène chacun d’entre nous, poète et lecteur, à la source de lui-même. Elle le reconduit vers ce temps aboli et pourtant présent dans un espace lointain de la mémoire, quand nous apprenions à vivre et à parler, vers ce temps disparu qui revient masqué à l’intérieur de nos images et de nos sentiments. Ce temps oblique qu’on appelle parfois l’oubli.
Elle réconcilie ainsi le poète avec lui-même et, le temps du poème, vient appeler le lecteur au même endroit.
Le poète est un homme de l’exil. Toujours en exil dans la langue car resté proche de ce qu’il y a « Avant les mots » ou « entre les mots »3 , c’est- à-dire de son corps de sensations.
Le poète ne raconte pas sa vie mais fait venir dans ses mots à lui cette première « pâte » dont nous sommes tous faits, ce corps émotionnel d’où émerge toujours le langage. Il se tient sur cette frontière, au lieu même du surgissement. C’est ainsi qu’il trouve sa parole.
Il y a dans chaque mot outre leurs significations une réserve immense d’émotions, de sensations et de sentiments multiples. Une sorte de kaléidoscope de vie. C’est là que se tient le poème.
« La poésie n’est-elle pas une sensation de l’esprit ? » se demandait Guillevic. « Une palpation mentale » reprenait Bernard Noël.
Si j’écris le mot « table » quelle table se dessinera au fond de chaque imaginaire ? Quelle table et son cortège d’images, de souvenirs, d’émotions, de sensations ?
Le poète ne cherche en rien à creuser sa subjectivité, à dérouler un tapis d’anecdotes biographiques, mais à entrer dans sa propre singularité et partant il convoque son lecteur au même endroit, là-même où la singularité se fabrique, c’est- à-dire là où ses mots sont d’abord des morceaux de corps, des bribes d’émotions et de sentiments. Là où sa parole ne se serait pas séparée de la totalité de son être. Cet impossible rêve, me semble-t-il, est au cœur de toute parole poétique. Et résiste. C’est là où le langage se montre comme individuation. Là où chacun, le temps du poème, peut se réconcilier avec lui-même. Entrer dans un temps immobile où se nouent passé présent et avenir, dans une fugace éternité.
Alors « le temps défait ses lacets, il court pieds nus et libre dans notre immensité. »4
« Écrire c’est parler dans un temps immobile » dit Patrick Dubost
Lire la poésie aussi.
Un poème, c’est une singularité en train de se manifester. Et que fait-il le poème, sinon installer la subjectivité au-delà d’elle-même et tenter de partager cette expérience avec le lecteur. Car le poète appelle son lecteur là où sa propre singularité à lui est en train de se faire. Il la lui fait briller, scintiller. Le poème en est la manifestation. Lire un poème c’est faire cette expérience-là.
« Le poème/te sort du complot du poids et du temps
Pendant qu’en lui tu plonges. //
Tu es comme la vapeur/ qui redevient eau/se refait vapeur. » écrit Guillevic dans son Art poétique
Nous sommes tous des exilés de l’intérieur. Le poème a pour fonction de nous le rappeler. De nous rappeler ce pays d’avant les mots où nous étions d’abord vibrations uniques. Partant, poète et lecteur vont, dans le poème, communier dans ce rêve d’origine qui est l’espace du rêvé réel. Ce rêve de nous-même qui inséparablement jumelle notre réalité. Ce qui s’est perdu, et qui nous hante. Ce double qui a donné tant de figures symboliques et qui parfois nous assiège.
L’enfant/ celui qui ne parle pas encore/que voit-il
Hors le cri le sourire/ cet enfant est muet
et son regard se mêle/ à sa propre chair//
Cet enfant en nous se repose/ il ne dort pas/ il habite en nos mots//
Il attend sa parole//
La neige lui ressemble//…
L’enfant bouge sa chair sans mots/
il te précède/
il te conduit//
Là d’où il vient/ cela fut mélange// cela fut partage//
Il est plus grand que toi/ plus large//
De quel espace est-il le ciel/ dont il porte la trace/ lui qui dans notre effroi/ sursaute//
Entre lui et toi/ la distance/ demeure inestimable/ interminable//
Cet enfant/ dans ta lèvre revient//
Il est le baiser d’une parole/ qui contiendrait tous les mots//
Toujours ta vie avance/ loin de lui//
Toujours tu cherches à le rejoindre//
Voilà ce tout petit frémissement/ dans les mots//
cette écorchure dans les significations//
cette brisure aussi/ dans ta parole//
Voilà ce souffle/ qui te fait unique//
voilà l’enfant qui marche vers son nom//5
II
« IL FAIT PLUS CLAIR QUAND QUELQU’UN PARLE »
Freud évoque ce mot d’enfant en proie à de violentes terreurs nocturnes. Un petit garçon appelle la lumière d’une parole pour se consoler. Impossible de s’endormir, de trouver la paix dans cette obscurité sans la voix de quelqu’un qui vient éclairer le noir, apprivoiser la peur.
Un nourrisson qui pleure se calme à l’appel de son nom, « qui lui donne l’adresse de son cri ». Qui met un mot sur le bouillonnement de sensations et d’affects qui l’habitent, et qui le sépare ainsi de son propre effroi. Entendre répéter son nom et pouvoir le situer dans la bouche de l’autre lui permettra d’organiser le chaos, d’apaiser sa peur de l’inconnu, de s’inventer une origine. Pourtant ces mots qui entrent en lui vont aussi le séparer peu à peu d’un paradis perdu, celui d’un temps où son corps propre n’était pas encore privé de lui-même. Nous sommes des êtres de contradiction.
Que fait donc un poète sinon aller chercher cette voix même là où l’ombre et la lumière se réconcilieraient. Il tente de rejoindre ce corps perdu qui reste mélangé à celui d’une mère. Au commencement était l’amour, les poètes et leurs mélancolies le savent bien ! Nous sommes des êtres de nostalgie.
Voici par exemple ce que dit Serge Pey :
« En fait la poésie c’est cela/ une langue qui entend/ et non une langue/ qui répond à ce qu’on entend// La poésie n’est surtout pas/ une imagination/ elle est la captation/ par le langage d’un réel/ qu’on ne voit pas/ mais qui à défaut de nous crever/ les yeux nous tranche la langue// La poésie doit rester/ sans imagination/ voir n’est pas imaginer/ mais trouer le réel/ pour voir le mot qu’il nous cache/ mais que nous devons inventer// »6
Un poème ne dit pas n’importe quoi. Il dit autrement. Il dit pour autre chose. Il n’informe pas, il donne à regarder, il donne à comprendre.
L’intelligence symbolique se sert aussi de la raison mais elle la met au service d’un tout autre désir, non pas celui de savoir, mais celui de naître. Et de temps en temps, il arrive qu’elle nous mette au monde.
Oui, le poème est d’abord une expérience qui appelle en son lecteur une expérience similaire mais qui ne sera reçue qu’à devenir la sienne. C’est une grande exigence ! Mais elle nous renouvelle !
« Le poème brûle les mots de l’Ancêtre pour qu’ils parlent enfin. »7(Gérard Pommier) Il retourne d’un coup tout le vocabulaire au profit de celui qui naît. Il marche souvent à contre-prose.
Nicole Brossard le résume à sa manière :
« Cette nuit-là on le dirait/ des siècles de métaphore iraient/ s’échouer/ sur la matière friable des paysages/ nos muscles tout à coup tressaillant/ au souvenir du bouche à oreille/ mot de jadis au trot/ dans la fraîcheur si longtemps cherchée/ des paragraphes d’éternité
Et encore : « on sait que le mot siècle enivre les oiseaux/ décore les ruines/ et nous fige dans l’abandon/ nous avons tous une vie capable de rouler/ jusqu’à la mer/ avec en dedans des toupies/ des bouts de corde suspendues/ phrases que nous touchons un peu/ certains jours comme à de la pluie, à de la mort »8
C’est vrai que la prose veut aller quelque part, la poésie s’attarderait plutôt au chemin.
On dirait qu’elle n’est écrite pour personne en particulier, sinon pour un lecteur potentiel, qui la lira peut-être plus tard… « Elle ressemble à une écriture jetée au-dessus de la schize qui sépare chacun de lui-même. Elle reconstruit un corps perdu. » commente Gérard Pommier
« Le poème n’est tout à fait lui-même qu’à condition de se soustraire, en partie du moins, aux conditions de réalisation de l’œuvre d’art. » nous rappelait Paul Celan. Car « Le poète est le barbare de la littérature en tant qu’il la « désécrit, qu’il y introduit des barbarismes, des mots qui n’existent pas dans la culture, des mots qu’il porte à l’existence du dire » (G. Pommier)
Dans le poème réussi quelque chose surgit qui n’est ni au poète ni au lecteur mais qui est dans leur rapport : la fabrique du sujet.
Qu’enfin sa parole appartienne à celui qui la prononce, tel est pour moi ce qui fonde la poésie.
On pourrait dire que le poète et son lecteur inconnu sont une seule personne qui se dédouble sur le papier. Ce qui surgit de cette rencontre est le sentiment qu’il n’y a de vraie parole que celle qui fabrique de l’universel particulier dans la langue.
Il y a quelqu’un dans la parole et il me prend la main. Il vient la toucher.
Guillevic écrivait :
« C’est quand tu
chantes pour toi
que tu ouvres pour
les autres
l’espace qu’ils
désirent »
Que fait le poème sinon, dans sa « sorcellerie évocatoire » la formule est de Baudelaire, permettre aux mots d’appartenir, c’est-à-dire de signaler la singularité d’où ils viennent. Le poème fabrique du sujet « et appelle le sujet en l’autre » (Claude Ber). Il y a toujours quelqu’un dans la poésie, le général est toujours reçu en particulier.
Les mots y sont à la fois les mots de tout le monde et les mots de chacun. Un poème montre que la parole est toujours unique et que chacun lui doit son propre règne, même si le monde veut nous le faire oublier.
« La société croit qu’il n’y a personne, or il y a quelqu’un » disait Artaud.
D’une certaine manière, le poète dit toujours JE, mais c’est le JE de la singularité, ce n’est pas celui de la subjectivité. Le Je du poète est celui qui permet à son lecteur de dire Je à son tour, le temps de le transmettre peut-être à un autre lecteur, à un autre je. « Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre » comme aurait dit Verlaine est cette voix qui tente dans chaque poème de mettre la parole au monde, cette parole qui fait l’humain. Ni tout à fait la même ni tout à fait une autre est la voix que chaque lecteur va rencontrer, retrouver en lui.
Écrire, lire, « toucher le centre des paroles/ là où quelque chose nous met au monde/ tète à même l’espace. »9
Le poème n’est pas un journal intime, il n’a que faire des confidences, de ce « misérable tas de petits secrets » que Jean-Paul Sartre a évoqué. Le poète ne cherche pas à s’exprimer, cela ne l’intéresse pas de raconter sa vie. Le poète parle de loin, pour cet être des lointains que nous sommes tous et que décrivait Husserl. Il a l’intérieur lointain, comme aurait pu le dire Henri Michaux.
Vous voyez, le poème nous le rappelle, nous sommes plus grands que nous. Plus grands que ce que l’on veut faire de nous, plus grands que ce que nous faisons de nous-mêmes.
Nos mots portent l’histoire du monde. Ils ne sont pas qu’information. Comment nous glissons-nous dedans, questionne sans cesse la poésie.
« Quand je parle dit Hofmannsthal, un millier de morts se réveillent ». Nos mots viennent de si loin dans l’histoire des hommes.
Parce que la poésie fait le sacre de la parole. Elle en manifeste le caractère sacré. Nous sommes embarqués » pascaliennement » embarqués.
Nous jetons notre filet dans l’océan des mots et nous en ramenons quelques-uns pour nos vies. Parfois, comme ces poissons dans le texte sacré, ces mots iront nourrir une grande foule. Se multiplier et chacun aura sa propre part. C’est ainsi que surgit un poème.
« Chacun en a sa part et tous l’ont tout entier » Victor Hugo parlait ainsi de l’amour, de l’amour maternel. Mais la poésie aussi est nourricière, elle alimente en nous ce qui nous donne le monde et nous situe en lui, je veux dire notre parole.
Aucun mot ne nous appartient en propre mais le poète est celui qui cherche à habiter sa propre parole. Si son Je n’est pas biographique, il est ce qui en lui fait signe de l’humain, de ce qui parle le monde. C’est cette inépuisable merveille de la parole qu’il appelle chez son lecteur. Un poème réussi est toujours un poème qui manifeste en secret l’étonnante singularité de chacun, poète et lecteur. Il y a quelque chose d’initiatique dans le poème…
Elle appartient à chacun cette parole, elle habille les mots d’une singularité ouverte sur celle de l’autre.
De ton corps/ jusqu’à ta parole/ un collier de
chair/ chaude entoure scintille// une caresse/
dans la peau profonde// un appel trop tôt enfoui/ qui se décline
Ouvrez la tête disait Satie// tu marches sur la
terre/ tu la prends dans tes yeux/ et dans tes
mains//dans ta bouche aussi// quand tu parles/ tu
la donnes à dire/ à goûter// c’est elle aussi qui
vient…
Entre ton corps et tes mots/un pont toujours est à
construire//une distance recommencée/ une
parole à venir vraie10
Ainsi parle l’enfant de neige blotti entre le poète et son lecteur.
« Quel est ce lieu/ où la naissance du monde/ écoute à l’intérieur de nous » écrit Zeno Bianu. Ce lieu c’est la poésie.
Nous nommons les choses pour qu’elles nous protègent du gouffre du désêtre et de l’infini. Nous les glissons dans notre corps par la bouche, nous les plongeons dans nos sensations, dans notre filet musical.
Mais le signifié mutile le signifiant, le poème le répare. Lui rend un peu de son espace originaire. Cela se fait dans la musique, dans le rythme, cela passe par le surgissement polysémique.
La poésie est peu lue parce qu’elle n’entre pas dans le culturel. On ne peut pas en faire une sorte de discours consensuel. Elle ne s’adresse pas à tout le monde, mais à chacun. C’est ainsi qu’elle « bondit hors du rang des meurtriers » comme aurait dit Kafka. Elle a à voir avec le sacré, avec ce que notre monde aujourd’hui rejette inlassablement.
Le sacré est ce qui nous met en rapport avec l’origine, dans une singularité affirmée et partagée. C’est par définition l’inverse du subjectivisme qui envahit notre société.
Le Je du poète n’est pas le moi. Ce n’est en rien le « moi je ». C’est le JE de l’individuation : celui qui manifeste ce en quoi la langue se courbe sur les mots de chacun. Notre parole cherche à s’appartenir, et le poème en est l’éclatante évidence. « Le poète trouve ce que le psychanalyste démontre » dit Lacan.
Écoutons la poète Claude Ber dans « Épître Langue Louve :
Langues langes où tètent les mots la salive/ étêtés
de leurs crêtes à en apprivoiser l’amer/ la lecture
cantillée des Hébreux/ l’inconjugable verbe
mourir du gabonais/ les tons du parler bantou ou
l’idiome nüshu de femmes interdites d’écrire/
conjuguent langue mère/ dépareillée éparpillée/
comme la mienne livrée aux lambeaux/ mêlée
de sources et de nous pleins de peurs de rires et
de syllabes/ que dites-vous qui ne soit nôtre ?
interrogeaient les fous et leur bouée précaire je
la serre autour de la taille avec la cage de la
raison comme un moulin à prière taillé dans un
tibia/ continuant déraisonnablement de dire en
mémoire glossolalique de paroles perdues et
interdites…
Langues langes les corps qui se prononcent en
elles tu les entends ?/
leur pulpe de paroles qui
va disparaissant/ dans notre soustraction/ c’est
ma frayeur dans ce jour dur/ que son fini
entame…11
Vous voyez, Lorsqu’il se met à parler, un enfant se quitte. Son cri va être dompté par les mots qu’on lui adresse et qu’il apprend. En pénétrant dans les mots, le monde de notre enfance se précise et en même temps se rétrécit. Le corps de sensations va se discipliner, s’assagir et s’éloigner, voire s’effacer. Nous allons commencer à nous perdre.
Le poète ira à rebours. Réintroduisant les sensations, retrouvant quelque chose du corps dans le rythme et les sonorités, floutant la précision réductrice par l’explosion polysémique. S’il retrouve en nous quelque chose de l’enfant d’avant les mots que nous fûmes tous, ce n’est pas la nostalgie qui l’occupe, mais le désir infini, cette question posée à l’origine, et constamment renouvelée.
Tout le monde se souvient de l’aphorisme de René Char : « Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir ».
Comme au corps/ la peau s’étire/ jusqu’aux lèvres de bouche et de parole//
quelque chose là/ vient habiter le signe//
installe le vocabulaire/ dans sa lumière//
Poème est souvenir/ qui roule vers l’avant//
qui ouvre ce qui viendra//
Poème en surprend le passage12
Le poète plonge dans la grande marée de l’impensé. Il trouve dans les mots non pas ce qu’ils ne disent pas, mais ce qu’ils n’ont pas encore dit, il fait miroiter notre trésor non pas celui de tout le monde mais celui de chacun. La poésie ne sait compter que jusqu’à Un.
Le poème fait le sacre de la parole, nous bascule ensemble, poète et lecteur vers ce qui n’est pas une énigme, mais notre extraordinaire mystère. Vers la terrible pâte de lumière que sont nos mots, leur inépuisable fertilité !
Plier le blanc/ vers le mot
Vers l’improbable accord
Ce vertige/ qui rend libre13
Le poème est le lieu d’une expérience du monde, c’est-à-dire d’une pensée inséparable de la sensation et du sentiment.
C’est quelque chose comme la chair de la philosophie.
On écrit donc forcément avec soi-même, mais ce n’est pas le JE, c’est le SOI.
« Il s’agit de déranger le monde que le discours a rangé » (Claude Ber).
Ça se fait dans la parole, ce langage mélangé de corps qui est donc toujours au singulier, à charge pour le poète de le mettre au monde, pour qu’il surgisse et augmente ainsi notre vie commune en appelant chacun dans sa propre autonomie.
Comme une insurrection du langage la poésie montre que chaque parole est irremplaçable. Et ainsi de chaque être qui la profère.
Elle contredit fondamentalement et totalement ce que le monde actuel tente de nous faire admettre. Non, nous ne sommes pas interchangeables ! La poésie est toujours un pacte de liberté et de libération. C’est pourquoi les tyrans, sans cesse, lui coupent la langue.
« Ô mon enfant, ma sœur, souvenons-nous de Baudelaire, songe à la douceur d’aller là-bas vivre ensemble / aimer à loisir, aimer et mourir/ au pays qui te ressemble. »
Ce pays, c’est la poésie. Un pays où les mots font de la musique, où la parole prend un rythme qui nous enveloppe, qui nous caresse et nous console ainsi de sa signification, elle qui dit souvent la dureté du monde, la difficulté de vivre.
« Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté…
Non pas que tout soit apaisé, lénifiant, au royaume de poésie. La souffrance y est constamment offerte
« Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble
…Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond » chante Louis Aragon.
La poésie connaît la loi du monde, et qu’elle est cruelle.
Mais le chant même du poète fait que quelque chose est rédimé. En nous lecteurs, quelque chose est touché et se révèle comme un refuge.
« L’homme crie où son fer le ronge/ et sa plaie engendre un soleil/ plus beau que les anciens mensonges »
« La poésie c’est autre chose » disait lui aussi Guillevic. C’est cette autre chose que le poème cherche à atteindre et qu’il nous donne
C’est cette autre chose qui nous appelle.
Dirions-nous que c’est la beauté, le sentiment de la beauté ? comme le voulait Dostoïevski. Ou bien qu’il s’agît de ce que des poètes comme François Cheng appellent le divin en nous ? Ou bien encore de ce que Yannick Haenel appelle le royaume en précisant bien que cela passe par des phrases, c’est-à-dire un style ?
Peu importe le nom que nous lui donnerons, mais il y a en chacun de nous une sorte de point indemne, au-delà du temps et de l’espace, au-delà de nous-mêmes. Un point fixe, un point refuge. Le poème avec ses mots nous y transporte. Écrire ou lire de la poésie, c’est toucher ce point-là. Je crois bien qu’il n’y a poésie qu’à ce prix !
C’est dans ce point-là que se trouve transporté le lecteur de poèmes. C’est à cet endroit qu’il il est appelé. C’est pourquoi on a pu dire, et ce n’est pas faux, que la lecture faisait elle aussi le poème. Oui, le lecteur de poèmes est responsable de sa lecture puisque, par définition, celle-ci lui fait éprouver sa propre liberté et qui s’invente en même temps que le poème le guide.
III
En effet, une fois que le poète a pris par la main cet enfant intérieur qui tient dans sa voix le secret des mots, il peut davantage affronter le monde et son désastre permanent. Regarder le désespoir dans les yeux et ne pas s’effondrer tout à fait. Il peut tenir la main de son lecteur.
« Chacun est seul comme le soleil » écrit Patrick Laupin.
« À quoi servit la mienne vie/ qu’ai-je ajouté à la poézie/ d’une époque si troublée/ que notre survie est en jeu/ Ah quelle folie n’est-ce pas d’y/ accumuler mille fois le trésor/de mon inutile minutie…Nous nous sommes trompés : nous n’étions que/ les décorateurs de l’agonie… »14 s’attriste Jean-Paul Klee
« À ce jour partout la guerre/ les plaines les forêts de bouleaux/ le vent, l’herbe, la lumière rasante// la terre est pillée et les corps sont abandonnés/ils ont changé le nom des pays/ ils ne savent même plus de quoi ils parlent// et nous à ces frontières béantes//
« Je suis debout, et je n’ai plus de gestes de secours »15 écrit Isabelle Baladine Howald.
Mais, voilà, dit-elle encore, « J’écris pour aller plus vite que la douleur »16
Á l’égal de la poète, le lecteur aussi peut se laisser porter par les mots et par leur étrange envoûtement pour aller plus vite que sa propre douleur ! Porter ensemble cette douleur, peut-être, et reprendre le chemin !
Dans kaddish pour Paul Celan Zéno Bianu célèbre la grandeur sacrée d’une telle poésie après Auschwitz.17
« …nous t’écoutons/ dans ton entêtement à écrire/encore et toujours/ après même le dernier vers/ du dernier livre/ quand tes mots/ prennent un goût de figue métallique//
nous t’écoutons/ parce que tu t’écartes du courant/ parce que tu traverses/ l’infinie première fois/ parce qu’il y a dans tes mots/
quelque chose d’immortel//…
Tes poignées de mots/ sont des poignées de terre/ des poignées de terre et de main/ une façon de dénaître/ et de renaître/ des sourires aérés d’angoisse/ des frôlements de non-réponse/ des rumeurs de pas dans la nuque//
Fais sauter les cales de lumière/ la parole flottante est au crépuscule/ la pluie chante/ étrangement/ jusqu’aux contreforts du cœur/ le chœur/ des ombres englouties/ le chœur des ombres/ debout sur la carte du monde//
des ombres qui ont perdu leur chemin/ des ombres qui ont perdu leur voix/ des ombres qui ne savent plus/ escalader le ciel/ des ombres/ avec des tessons sur la langue//
Fais sauter les cales de lumière/ la parole flottante est au crépuscule/ un bandeau aveugle l’horizon/ les nuages vont éclater/ partout/ on s’inquiète de toi/ cependant/ que tu répètes les psaumes/ cependant que tu les fracasses/ avec une tendresse vibrante/ pour ouvrir les portes de l’âme/ cependant que tu les démantèles/ pour ouvrir les portes du ciel//
Partout on s’inquiète de toi/ de cette nuit de poison noir/qui coupe la parole/ de ces fleurs de cendre/ qui font dormir les noms/ le nom de l’amour/ le nom de la vie/ le nom des racines//
Viens/ il est temps/ viens/ avec tes veines ouvertes/ en jeunes éclairs/viens/ faire courir les enfants/ viens faire entendre/ le signe des signes//
Tout près/ tout près/ par-delà ce qui fut/ et ce qui sera/ oui viens renverser le souffle/ vers nous vers nous//
Viens prononcer ta bénédiction//
La rose de personne est sans pourquoi/ la rose de personne est sans pourquoi/ la rose de personne est sans pourquoi.
Et Je laisse maintenant à Roberto Juarroz le soin de conclure :
« Entre celui qui donne dit le poète, et celui qui reçoit, entre celui qui parle et celui qui écoute, il y a une éternité inconsolable. Le poète le sait ».
Il me semble que le lecteur l’éprouve.
Claudine Bohi
Banquet du livre de Lagrasse
Mai 2022

Voir sur youtube
[1] L’enfant de neige, Bohi Claudine, éditions L’herbe qui tremble 2020
[2] On serre les mots, Bohi Claudine, éditions Le bruit des autres, 2013
[3] Avant les mots, Bohi Claudine, éditions Po&psy Eres 2012
Entre les mots, Bohi Claudine, éditions du pauvre erre Odile Fix, 2015
[4] Naître c’est longtemps, Bohi Claudine, éditions La tête à l’envers, 2018
[5] L’enfant de neige, Bohi Claudine, éditions L’herbe qui tremble, 2020
[6] Mathématique générale de l’infini, Pey Serge, éditions Gallimard, 2018
[7] La poésie brûle, Pommier Gérard, Galilée, 2020
[8] Ardeur, Brossard Nicole, éditions Mazette, 2018
[9] Divan, Bohi Claudine, éditions Chambelland, Le pont de l’épée, 1990
[10] L’enfant de neige, Bohi Claudine, ib.
[11] Épitre Langue Louve, Ber Claude, éditions de l’Amandier, 2015
[12] Naître c’est longtemps, Bohi Claudine, éditions La tête à l’envers, 2018
[13] ibid.
[14] Décorateurs de l’agonie, Klee Jean-Paul, p. 93, bf éditions, 2013
[15] Les états de la démolition, Howald Isabelle Baladine, p. 23, éditions Jacques Brémond, 2002
[16] Secret des souffles, Howald Isabelle Baladine, p. 48, melville (éditions Léo Scheer), 2004
[17] Le Désespoir n’existe pas, Bianu Zeno, éd Gallimard, 2010
____________________________________________________________________________
Voir aussi sur → Tdf


 Angèle Paoli / D.R. Texte angèlepaoli
Angèle Paoli / D.R. Texte angèlepaoli