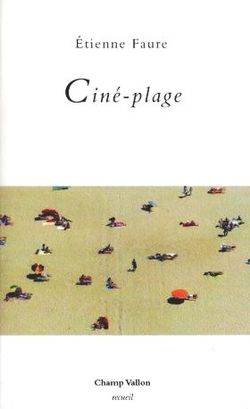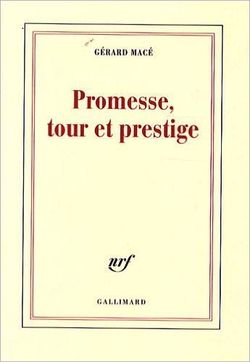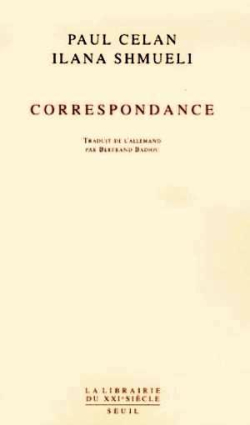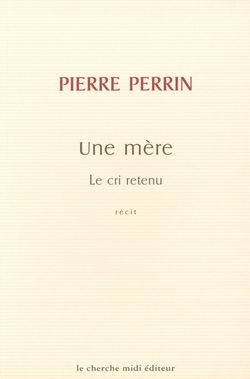« JE FROTTE LES MOTS COMME DES SILEX »
Par l’entremise de l’exergue sont mises en évidence les fréquentations littéraires d’un écrivain, ses lieux et ouvrages de prédilection. En choisissant Montaigne et, dans les Essais, le chapitre I « Que philosopher, c’est apprendre à mourir », Pierre Perrin ouvre pour le lecteur un chemin de réflexion dans lequel la mort a son mot à dire. L’auteur du récit Une mère, récit à caractère autobiographique, côtoie sans cesse la mort et conduit le lecteur vers elle. Celle en premier lieu du père mais surtout celle de l’être le plus chéri au monde. La mère. Un amour resté en suspens, en-deçà de la parole, gardé au secret dans le silence. Jusqu’à l’incompréhension. Une incompréhension réciproque qui taraude le narrateur, l’interroge sans relâche, nourrit sa pensée et certains de ses actes, le pousse dans les moindres recoins de ses contradictions ; et justifie à elle seule le sous-titre Le cri retenu. Qui devient titre à part entière.
Le cri de la mère celui du fils à jamais arrimés l’un à l’autre, l’un et l’autre tenus en suspens au-dessus de l’abîme.
Une mère. « À nos mères ». Derrière l’indéfini du titre, qui voudrait noyer la mère dans l’anonymat, ce sont toutes les mères que Pierre Perrin cherche à rejoindre en dédiant son récit « à nos mères ». Mères plurielles, dont celle de l’auteur n’est que l’une d’entre elles, parmi tant d’autres. Unique cependant, parce que sienne. Elle est sienne et elle est « Rose », une paysanne née dans l’entre-deux-guerres, éduquée à l’ancienne, c’est-à-dire selon le rude mode des campagnes, en vertu duquel, à douze ans, une fois obtenu le certificat d’études, les filles rejoignaient les champs l’étable les travaux de la ferme en attendant d’éventuelles épousailles. D’études, point. Cela n’était pas discutable. De tendresse, pas davantage. Les temps ne sont pas aux effusions. C’est de cet univers — qui comporte toutefois ses plaisirs et ses découvertes — qu’hérite le jeune garçon. L’adulte, lui, bien des années plus tard, tente de recréer de mémoire le lien qui l’unissait à sa mère dans le monde rural qui était le leur. Une relation tissée de solitude mal partagée, entre un père que l’enfant perçoit comme délaissé par son épouse, et une mère taiseuse et triste qui s’acharne au travail rabroue son fils le taloche parce que sans cesse insatisfaite de lui. Sans doute parce qu’elle voudrait pour lui ce meilleur dont elle a été privée, exigences inaccessibles qui font de l’enfant un rebelle.
Peu encline à accueillir les gestes tendres de son fils — ceux-ci résonnent dans le vide comme un appel désespéré —, la mère entretient chez son rejeton un sentiment proche de la haine. Leur difficulté à se comprendre, à communiquer, à se sentir au diapason l’un de l’autre, renforce l’enfant dans sa cruauté. Le sentiment d’impuissance, l’insatisfaction permanente de ne pouvoir atteindre celle que l’enfant aime en silence et de la fléchir afin qu’elle accepte de lui cet amour indicible, poussent le garçon jusqu’à souhaiter la mort de celle qu’il chérit pourtant à en mourir. Et cet amour perdure, par-delà les années écoulées, par-delà la séparation définitive. L’inéluctable travail des ans sape les souvenirs et la mémoire se révèle faillible, qui transforme à sa manière le peu qu’il en reste ; de sorte que l’on en vient à se demander si le désaccord profond entre ces deux êtres a bien été réel ou s’il est imaginaire. Et les doutes persistent aussi chez l’adulte, qui le soumettent à la torture du remords et le laissent sans réponses.
« Je reste le cœur dévoré d’incertitudes. Les reins cordés, les côtes striées de nœuds jusqu’aux épaules depuis des années, les remords rabattent comme la fumée dans une cheminée. Tout ce que je ne t’ai pas donné, tout ce que je t’ai volé de naturelle tendresse, de joie, de paix, qui m’auraient peu coûté, monte dans ma gorge, coud mes paupières sans contenir mes larmes. C’est trop tard, irrémédiablement, voilà que je t’aime. Tu n’es plus là pour sourire, de tes lèvres si tristes, qui ne sifflaient pas l’amertume. Insultée parfois, saisie à la gorge, tu me rejetais sans violence, tu pleurais. Tu ne condamnais que mon orgueil. »
L’écriture permettra-t-elle — à celui qui n’a, jusqu’à la mort de la mère, « retroussé que du vent » — de recoudre les blessures, d’entamer un peu la digue élevée contre la mère et de recréer son visage ? De lui restituer « le timbre de sa voix » ? De percer des secrets demeurés impénétrables ? Difficile entreprise que cette quête éperdue contre le temps et contre le poids du silence. D’autant que la disparition de la mère s’est faite sans le fils. Du reste, si peu d’éléments tangibles demeurent. Quelques lettres égarées quelques pauvres clichés qui « tireraient des larmes à une pierre ». Comment retrouver sous les traits flétris et gâchés de la vieille femme décharnée ceux de la jeune fille innocente et fraîche que « le malheur n’a pas encore frappée » ? Sur quelles données s’appuyer pour comprendre ce qui a pu se passer entre le père et la mère, ce qui a fait de leur histoire à tous trois un trou noir insondable tissé d’animosité de rancœur et d’impossible partage ?
« Écrire, c’est aussi marcher sur ces traînées, une torche à la main », confie Pierre Perrin dans le chapitre qui suit immédiatement le récit de la mort du père. Les traînées, ce sont « les barbelés » imposés par la mère autour du corps malade du père. Et ce mur d’incompréhension « plus vaste que le désespoir », qui les « a séparés vivants. » Mais, à travers le cheminement des six chapitres qui constituent le livre — et des six rétrospectives en italiques qui s’y insèrent —, Pierre Perrin s’essaie. Il s’essaie par l’écriture à faire reculer ce qui l’enserre. Il s’essaie à recréer l’histoire d’un amour qui se consume dans le naufrage. Il voudrait, par ce livre, « désincarcérer » la mère, afin que morte, elle gagne une liberté qu’elle n’a pas connue de son vivant. Mais il trébuche, convaincu que l’œuvre n’est qu’« un trompe-l’œil » et que rien ne sert de s’illusionner. « Il n’est aucune échappatoire. » Une seule vérité demeure : « Elle est morte sans son fils ». Et les mots qui ont manqué ne sont que des « leurres ». Des « orphelins dans la nuit froide et noire ».
« Ce mieux, que je déterre, est un leurre ; l’oubli est le contraire de ce que je cherche. Je frotte les mots comme des silex ; d’autres peut-être se chaufferont à mon feu. » Et Pierre Perrin de regretter ailleurs : « Nos deux petites lumières se tournaient le dos, qui ne se croiseraient plus. »
Il semble pourtant qu’il y ait eu une histoire d’amour, une promesse de jours heureux et de bonheur palpable à recueillir entre les mains. Le bonheur a-t-il pris fin avec la venue de l’enfant ? Était-il déjà ébréché du temps de l’exil du père en Poméranie ? Cet homme désiré, attendu dans la confiance d’un retour sans faille. Peut-être n’était-ce là qu’un rêve ? Quelque chose a eu lieu, qui a le goût amer de la déception. Et ouvre au sein du couple une blessure que rien ne viendra plus refermer. « Elle comprenait chaque jour davantage que sa longue patience n’était rien à côté de celle qu’elle devrait fournir encore et encore, si elle voulait trouver avec lui la vie presque agréable. »
Il suffit parfois d’un rai de lumière sur les pétales des dahlias d’une balade à vélo sur les chemins forestiers pour entrevoir une paix possible entre les âmes, pour susciter une forme de miracle image d’une tendresse partagée. Où que le fils aille et quoi qu’il fasse, la mère est là, qui le pousse de l’avant : « Comprenne qui voudra, ma mère est devant moi. » Avec son poids de chagrins de désillusions de solitudes indéchiffrables. Avec ce regard triste qui le suit dans sa vie. Jusque dans sa tanière d’écrivain. « Elle est là, derrière ma tête, tout près de mon épaule, mais j’ai beau promener un miroir alentour, il reste vierge et mon souffle, solitaire. »
L’écrivain poursuit son chemin et comme au temps de la petite enfance où il accompagnait son père à travers champs sur Pony, le tracteur rouge, il creuse ses sillons, patiemment, une tranchée après l’autre, repoussant les doutes et les résistances, rejetant « la cotte de mailles » qui depuis si longtemps l’emprisonne ; toujours plus enclin à la méditation qui ouvre à l’écriture des espaces d’« inconnaissable ». « Cela qui valait la peine de se jeter sur la route. » Progressivement, le regard de l’écrivain se déplace, modifiant peu à peu son angle de perception. Pierre Perrin le suggère avec les mots qui structurent sa propre histoire, filant la métaphore des murs et de la porte :
« À force de scruter de l’ongle presque chaque pierre des murs de mon enfance, l’une a dû dans mon dos réveiller je ne sais quel secret ; une porte peut-être oubliée a tourné sur ses gonds… »
Il faut cependant bien du temps encore pour que prenne forme le dialogue du fils avec sa mère ; avant que celle-ci ne se manifeste à lui par-dessus son épaule ; et que le regard qu’il porte sur elle ne gagne en bienveillance :
« J’ai donc, cette année, rêvé, marché, parlé avec ma mère. Elle a répondu, quelquefois, par-delà son silence obligé. »
De cet échange bienveillant et de la réconciliation qu’il inaugure, peut naître l’écriture. Ainsi Pierre Perrin peut-il confier :
« À mesure que s’entrouvre son visage, ma propre voix, dans l’écriture, trouve enfin une consistance. »
Le livre peut désormais filer vers l’achèvement de sa course. Un très beau livre qui touche en profondeur, tant par la qualité d’une écriture très personnelle que par l’exploration sensible des sentiments qu’elle donne à vivre. Et à partager. Une fois le livre fermé, il restera en chaque lecteur « comme un parfum qui s’étiole sans tout à fait mourir malgré la nuit ». Et pour Pierre Perrin, l’assurance de voir son désir le plus cher réalisé : tenir sa mère entre ses bras. « Jusqu’à son dernier souffle. » L’embellie peut se vivre dans la plénitude de la sérénité enfin trouvée. Ainsi du moins le suggère l’excipit du Cri retenu :
« L’air sent la mûre, par endroits la prunelle. Trois troupeaux paissent sur les communaux. Une bergeronnette, tête haute, traverse le chemin qui domine encore la tour du château en ruines. À ses pieds, serait-ce toi qui viens à ma rencontre, vêtue de gris, mais d’un gris que je n’ai jamais vu, presque aussi lumineux que le bleu du ciel ? Tu souris comme aux plus beaux jours. Pour la première fois, je crois que l’été n’est pas près de s’effacer. »
Angèle Paoli
D.R. Texte angèlepaoli
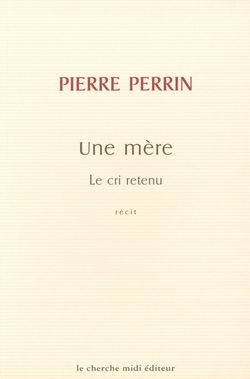
|