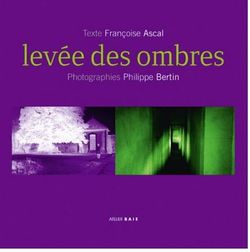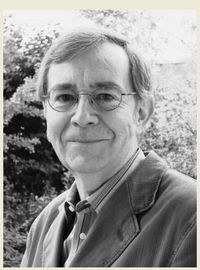Éditions La Pierre d’Alun, 2013.
Flexographies de Kikie Crêvecœur.
Préface de Jean-Louis Giovannoni.
Lecture d’Angèle Paoli
 Ph., G.AdC
Dans sa préface du Baron perché, François Wahl souligne que le récit allégorique d’Italo Calvino est en réalité un « autoportrait » de l’auteur. « Celui d’un jeune homme élevé sur les pentes en vergers de la côte ligurienne, par des parents botanistes, un père chasseur […], au milieu d’un grand jardin »… Dans son Autoportrait en Arbres, Christine Caillon, en « Hommage à Italo Calvino », prend appui sur Le Baron perché pour composer à travers l’ouvrage singulier qui est le sien, un autoportrait d’elle-même avec arbres, mythes, poésie, littérature. L’ensemble, tissé~entrelacé avec ses goûts et sa réflexion sur l’art (musique, peinture, sculpture…), est précédé d’une préface de Jean-Louis Giovannoni. À l’intérieur des cahiers (non cousus), des vignettes ponctuent le texte — poèmes et proses — et des planches en noir et blanc déploient troncs et enchevêtrements de feuillages, nervures et racines dressées vers le ciel, à l’image des frondaisons étranges qui ouvrent l’espace de la poète. Des flexographies de Kikie Crêvecœur. « Il n’y a de mots sans images ». Pour la poète et pour l’artiste, telle est la devise. Celle également de la maison d’édition : La Pierre d’Alun, dont le logogramme a été dessiné par Pierre Alechinsky.
L’ouvrage de Christine Caillon s’ouvre sur un célèbre larghetto de Haendel. Ombra mai fu. Un récitatif extrait de Xerxès. Un chant d’amour de l’empereur perse pour un platane de Lydie :
« Ombra mai fu
di vegetabile
cara ed amabile
soave più »
« Jamais l’ombre
d’aucun arbre ne fut
plus chère
ni plus aimable
ni plus douce »
Lancé ce prologue musical, avec un arbre pour objet de déclaration amoureuse, la poète peut amorcer son propre hommage aux arbres. Avec une écriture solidement chevillée à Italo Calvino et à son Baron perché. L’histoire du jeune Côme Laverse du Rondeau se présente comme un conte, introduit par la formule consacrée, chère à Perrault ou à Grimm :
« Il y avait une fois ».
Répartie en plusieurs épisodes qui viennent s’enchâsser dans le texte courant — proses et poèmes —, l’histoire du jeune Côme — que sa révolte contre les adultes pousse à s’implanter dans les arbres et à ne les plus quitter jusqu’à sa mort —, se distingue visuellement par le choix des italiques. Christine Caillon reprend à sa manière — « Copie de Maître » — la vie dans les arbres du jeune baron — d’yeuse en orme, d’orme en caroubier, de caroubier en noyer… —, qui restera fidèle, à jamais, au monde arboré qu’il s’est choisi. De son perchoir mouvant — qui assure à cet esprit indépendant et contestataire la hauteur de vue nécessaire pour évaluer les situations —, le baron d’Ombreuse découvrira délices et déceptions amoureuses (d’abord, en son jeune âge, par l’entremise de Capelinette la futée, puis, ultérieurement, par celle de la belle Violette, sans parler d’autres dames qui viendront le visiter à califourchon sur les branches), traversera les révolutions de son époque, en partagera les combats et les désillusions, depuis les Lumières jusqu’à la Bérézina et à La Restauration. Du cœur des frondaisons, il rêvera « un projet de Constitution pour une Utopia qu’on installerait dans les arbres », il y décrira la « République imaginaire d’une Arborée » destinée aux seuls justes… Il découvrira aussi, inexorables, « la solitude dans les arbres » et « la fuite du temps ». Mais toujours, quoi qu’il ait à vivre, les arbres, leurs écorces, leurs branches, leurs troncs et leurs canopées, lui seront un havre précieux et un soutien sans égal. De cet « univers arboricole » savoureux, « matrice topologique du récit du Baron perché », Christine Caillon fait la pierre angulaire de son Autoportrait en Arbres, pour le plus grand plaisir du lecteur.
De là s’ouvrent de multiples arborescences, non dénuées d’aspérités, qui contribuent à façonner une « idée d’arbre », pour peu que l’on donne sa pleine mesure au sens olfactif : « l’idée d’arbre commence par la forme
pour la comprendre
il faut la couvrir d’empreintes, la sentir,
le nez à la place des mains
il faut humer son regard
c’est la seule façon »
Pour cela, il faut déplacer le regard, se mettre à l’écoute des fantômes, « réinventer la vibration », laisser parler la « peau du bois ». Il faut « se coucher pour comprendre leur debout ». Et laisser les questions monter à soi, comme la sève monte du sol afin d’irriguer les ramures : « [E]st-ce qu’un arbre a forcément des branches ? » ou bien « [U]n arbre peut-il tourner le dos ? » ou encore « [U]n arbre est-il droitier ou gaucher ? »
L’enfance n’est jamais loin, qui surgit à l’improviste avec ses personnages-clés et les questions qu’ils ont laissées en suspens :
Robin des Bois a laissé son empreinte d’« écureuil communiste » ; la [B]elle au bois dormant, ses énigmes syntaxiques. Ses arborescences nous diront-elles jamais « qui, de la belle ou du bois, dort » ? Cendrillon au jardin (image d’un paradis perdu ?) a semé mille trésors sous les pas de l’enfant :
« — des grains citron pâle — j’ai là la fleur
courte, blanche, poudrée, une idée de gaze, lin, maillage nafré,
gaufré, avec au fond comme une odeur de coton qui embue les
narines — j’ai là les journées de miel sous les humeurs du seringa :
Cendrillon a mille ballerines à chausser ! tout est feuille d’or !
j’ai six ans
l’arbre s’assied par terre
comme un ours lourd… »
Au rebours de l’enfance, en amont des épisodes calviniens, il y a l’origine.
« à l’origine : « le mythe, le myrte, la myrrhe ». Il y a « la peau de Daphné ». « Daphné avant le laurier ». Il y a le souvenir lointain d’un jardin. De ce foisonnement anaphorique d’« il y a », qui donne naissance aux choses nommées – depuis « la taille du cyprès » jusqu’ « aux fabriques des racines » en passant par la fleur du grenadier, les charpentes et les feuilles, les gouges et les entailles, « les ossatures d’ailes » et « l’arbre de généalogie » surgit inattendu, le Saint-Sébastien de Camille Corot.
« Vous saviez que Corot avait peint un Saint Sébastien ? » interroge la poète.
Un Sébastien « d’avant le martyre » — sans « l’ombre d’une flèche » — qui participe de l’arbre, des ligatures de ses branches, se fond dans les veines de son écorce. Et qui, comme Daphné, « a un devenir arbre : ses bras sont d’autres branches ». « [L]es bras feuillus de Daphné [autoportrait d’une obsession] », confiera plus loin la poète.
Et Christine Caillon d’ajouter :
« c’est l’un des tableaux les plus silencieux que je connaisse. » Il a l’air de dormir, en effet, ce Sébastien de Corot, « danseur dormant debout à sa barre ».
Dans « la lenteur d’une année d’arbre » la poète poursuit son autoportrait de femme-arborée :
« je rassemble mes gestes, mes
feuilles comme autant de paupières et j’essaie de
recomposer/poster pour le printemps
qui soulève, mû par l’en-dessous »
Peu à peu, comme Daphné et Sébastien, elle aussi mue, au contact des écorces, des racines des branches ligneuses :
« je prends le pli des feuilles mortes »
« j’écorce le rêve », écrit-elle, entremêlant à son histoire l’histoire de Côme Laverse du Rondeau :
« combien de contes inouïs au prix de ton bras endormi (je ne vois pas ton visage mais j’entends ta voix, j’entends encore les gommiers doux, les espèces singulières, les acacias complaisants, les faux poivriers () je bois la véranda des thés verts et sous ton bras lourd qui faisait bien le poids du temps (le bruit que faisait le temps qui passait là), j’écorce le rêve »
Le rêve évolue vers d’autres formes, d’autres aspirations. Celle de s’élever, dont Côme Laverse du Rondeau, à l’article de la mort, nourrit encore l’espoir, jusqu’à l’apothéose finale de son envol en montgolfière. Et de sa disparition dans les airs. Ainsi de la Daphné d’Antonio del Pollaiolo (Apollon et Daphné, 1470-1480). L’arbre qui engendre la métamorphose de la nymphe, se fait « icarien ». Daphné « lévite, et le pauvre amant divin a l’air d’un enfant qui quémande une taille impossible /
elle est Icare ; alors qui navigue au bord de sa toile ? »
Lequel des deux, de Daphné ou d’Apollon se métamorphose ? Selon Christine Caillon,
« la seule vraie métamorphose est celle d’Apollon : sa folle posture l’atteste : il va tomber, il est en tombant tombé amoureux, il est devenu autre, et par là appartient au temps, le dieu s’est fait mortel : lui seul s’enracine »
Poursuivant son canevas en milieu pictural, la poète évoque ensuite Helmingham Dell de John Constable. Dont « la fourrure des arbres » la renvoie à La Mort d’Actéon de Titien et La Mort d’Actéon à une autre toile de John Constable : The Cenotaph to the Memory of Sir Joshua Reynolds. Une réflexion remarquable, nourrie par la comparaison entre les différentes toiles du même peintre court de page en page, sur la peinture et son sujet. Comment le peintre parvient-il, en l’absence délibérée du sujet — animal ou homme — à faire ressentir « la présence humaine ou animale » ?
« j’ai envie de défendre les arbres de C. — les glaiseux, les mouillés, les tourbeux — non pour leur effet de “déjà vu” ou “anesthésiant” mais pour le velours de tons verts qui hantent la toile : en personnes ». « Le sujet reste la couleur », confie la poète.
D’autres arbres ancrent leur fiction dans l’imaginaire pictural de la poète. Ainsi celui qui occupe une partie du retable de Sainte Marie-Madeleine lisant, œuvre du peintre vénitien Le Tintoret.
« Arbre extraordinaire qui pousse le châssis, la toile vers le haut, qui s’étire comme un homme-cerf qui aurait levé ses bois »…
On retrouve ici la fascination de Christine Caillon — « tellement d’arbres en moi » — pour toutes les formes que peut prendre le bois, qu’il soit à l’état de tronc — noueux, creusé ou lisse et vernissé comme celui qu’a peint Constable dans le Study of the Trunk of an Elm Tree —, de branches ou de ramures cervidées. « Lire comme dans les runes ». Les « troncs retors et membrus », mais aussi les anamorphoses de la nature, bois de cerf et bois de hêtres, de chênes ou de peupliers, confondus.
Quant au poème qui suit l’évocation du Tintoret, il est tout à la fois prolongement de l’observation de la toile et arborescences référentielles dont l’auteure a le secret mais aussi présence de l’une de ces poussées qui montent en elle et réalisent l’appel de la verticalité. Verticalité qui se manifeste, dans les peintures d’inspiration religieuse, au-delà des bras dressés de la croix, jusque dans la « bouche verticale » qui figure « la plaie du Christ ». Symbole de baiser.
Pourtant, au cœur de ces anatomies de l’arbre qui prennent racine dans la peinture occidentale et en traversent l’histoire, quelque chose manque à notre regard. Que sans doute, nous nous refusons à voir :
« jusqu’où sommes-nous capables de ne pas
voir »,
interroge Christine Caillon. Peut-être faudrait-il laisser la mémoire et les gestes renouer avec l’homme et à l’homme cette volonté d’accepter que s’inversent les rapports qui le lient à la forêt :
« la mémoire de la forêt
consiste à parcourir
l’homme/si les racines
et/ou proposer une sculpture
un geste végétal
comme un événement
manquant »
Peut-être faudrait-il laisser le tronc parler le langage du sens. Celui du « moment religieux » où « vocation à la cicatrice » et vocation « à l’écriture » se rejoignent. Ainsi de « l’arbre-tableau » du Tintoret, cet « arbre pantocrator, peint à la feuille d’or comme une icône »… Christine Caillon voit en lui « autre chose que ce qu’il dit ». Si « quelque chose de spirituel est représenté » (ce qui semble incontestable), ce n’est pas du côté de la sainte qu’il faut regarder ni de la Contre-Réforme. Mais plutôt faudrait-il y lire un « hymne aux divinités païennes crucifiées. » Et au-delà, dans « cette torsion organique » de l’arbre colossal, lire « la dévotion fervente de l’artiste… à son art ».
Parvenue à l’extrême lisière de son exploration arborée, Christine Caillon se penche sur une dernière œuvre picturale. Celle de la fresque réalisée par Masolino pour la chapelle Brancacci, à Florence. La Tentation d’Adam et Ève. Interrogeant l’œuvre, la poète cherche une voie possible d’interprétation. Un autre regard traverse, qui inverse les analyses et propose une lecture singulière :
« cet arbre interdit était de toute façon indéracinable parce que ce n’est pas lui, la métaphore, c’est Nous : c’est lui qui allait Nous goûter, Nous, ses fruits, allions tomber, mûrir, et désapprendre le jardin, appeler le cri, griffer le bois, souffrir, parler et puis blettir et pourrir
Nous avions cet arbre en Nous et toutes ses réitérations éternelles… »
Mais, pour conclure de manière moins tragique sur la question sournoise du mal, Christine Caillon propose une pirouette :
« les personnages de Masolino plaident à leur façon : Nous sommes innocents et élégants, Nous n’avons fait que poser… »
|
CHRISTINE CAILLON ■ Christine Caillon sur Terres de femmes ▼ → [quelle est la surface d’un arbre ?] (extrait de Autoportrait en arbres) ■ Voir aussi ▼ → (sur le site Les Journées Poésie de Rodez) d’autres extraits d’Autoportrait en arbres [PDF] → le site des éditions La Pierre d’Alun |
Retour au répertoire du numéro de novembre 2013
Retour à l’ index des auteurs
Retour à l’ index des « Lectures d’Angèle »