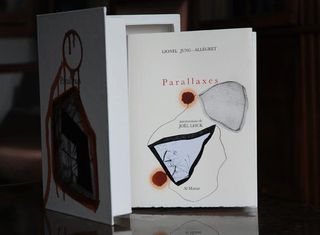Ph., G.AdC
[UNE POÉTIQUE FUNAMBULESQUE] Ph., G.AdC
[UNE POÉTIQUE FUNAMBULESQUE]
Poursuivant leur travail salutaire de défrichage du territoire poétique italien, les éditions NOUS offrent aujourd’hui aux lecteurs français, après Zanzotto et De Angelis, l’occasion de découvrir l’une des figures majeures de la poésie contemporaine italienne, Edoardo Sanguineti. Né en 1930, Sanguineti a d’abord été l’un des chefs de file de la néo-avant-garde italienne du Gruppo ’63, aux côtés de Nanni Balestrini ou encore d’Antonio Porta, représentant d’une génération qui a voulu rompre les cadres d’une poésie italienne perçue comme trop provinciale et trop frileuse. Au cours des années, son travail poétique ne perd rien de sa radicalité formelle, s’arrondissant cependant au fil d’un travail plus autobiographique, où le poète tire le meilleur parti de l’anecdote et du mot d’esprit. Le recueil Corollaire (1997), traduit par Patrizia Atzei et Benoît Casas, se place dans la lignée de Postkarten (1978), appliquant la fameuse recette stendhalienne du « petit fait vrai » 1. Le poète nous y convie à le suivre dans ses errances mondiales, nous livrant au fil de compositions numérotées un ensemble de poèmes oscillant entre la carte postale adressée, le sonnet revisité, la déclaration d’amour, le rébus et le testament.
Le premier poème, programmatique, nous fournit l’introduction rêvée à l’œuvre entière de Sanguineti. « Acrobate » est le premier mot du recueil, qui s’ouvre par un autoportrait en forme de définition du dictionnaire :
acrobate (n.m.) est celui qui marche tout en pointe (de pieds) : (tel, du moins,
pour l’étymon) : mais ensuite il procède, naturellement, tout en pointe de doigts, aussi,
de mains (et en pointe de fourchette) : et sur sa tête : (et sur les clous,
en fakirant et funambulant) : (et sur les fils tendus entre deux maisons, par les rues
et les places : dans un trapèze, un cirque, un cercle, sur un ciel) :
il voltige sur deux cannes, flexiblement, enfilée dans deux verres, deux chaussures,
deux gants : (dans la fumée, dans l’air) : pneumatique et somatique, dans le vide
pneumatique : (dans de pneumatiques plastiques, dans des fûts et bouteilles) : et il saute mortellement :
et mortellement (et moralement) il tourne :
(ainsi je me tourne et saute, moi, dans ton cœur) :
Nous voilà donc introduits à une poétique funambulesque, où le rythme se réinvente dans la ponctuation qui fait avancer le poème par précisions successives, sur la « pointe des doigts », en de gracieux sauts périlleux. Jacques Roubaud fait remarquer dans sa Préface la « cohérence formelle et sémantique » exceptionnelle de cette œuvre, forgée dans une constance que Sanguineti poursuit depuis ses premiers recueils. Notons donc la disposition du poème, avec ses marques « déposées » que sont : les deux points venant suspendre et rouvrir à tout moment le propos, ponctuation « pneumatique », signature invitant à poursuivre par-delà la conclusion, et les parenthèses incessantes qui enferment digressions, explications, gloses ironiques, understatements. Au fil des années, Sanguineti s’est forgé bien plus qu’un style : c’est un ton, une voix, une posture à la fois maladroite, pointilleuse et dégagée que l’on retrouve de recueil en recueil.
Frappe dès l’abord, malgré les énigmes multiples et le goût de la cryptoréponse (poème 2 : « qu’est-ce que je te demande, si tu me le demandes, je te cryptoréponds ainsi : »), l’éminente sympathie de cette poésie enlevée, où le poète assume (ce n’est pas la première fois !) la posture du vieux, accumulant les bilans tout en soufflant sur les braises d’un désir encore juvénile, la morale de l’histoire poussant toujours vers le copulo ergo sum du poème 32. Un hédonisme dont le poète aura fait sa profession de mécréant : impossible de ne pas lire en miroir le testamentaire « je n’ai cru en rien : » de Postkarten (50) et l’épigraphique « j’en ai joui, moi, de ma vie : » de Corollaire (3). Ainsi le recueil marie volontiers la sophistication extrême à la quotidienneté dans ses plaisirs élémentaires :
à la fin (comme madrigalaient ces presque aurorales voix mixtes d’Antioquia),
c’est la tristesse qui est la muerte lenta :
je laisse de côté les choses simples (las pequeñas, las queridas) :
et j’en viens au point qu’elles recommandaient (tout comme Mercedes) : muchacho, no partas ahora :
(entonces, c’est vrai que je ne peux pas le rêver, vieillard, el regreso) : mais c’est encore plus vrai, et bien
plus effrayant, que l’amour est simple : (y las cosas simples las devora el tiempo) :
(si la transcription Juan Diego est correcte) :
c’est vrai, enfin, c’est vraiment vrai, que j’ai aimé
ma vie : (la vie) : c’est ainsi, dans cette luz major, qu’aujourd’hui, les filles, je me meurs :
Au bout du compte, même le mea culpa du poète « épouvantable encyclopédie de conneries encouillonnées, de semi-criminelles/supergaffes » se clôt dans la tendresse :
ce que j’ai eu, je le garde ainsi : (pourvu que je te garde, moi je me garde, à l’identique) :
L’acrobate ne se contente pas cependant de discussions graveleuses et de déclarations. La poésie de Sanguineti garde aussi toute sa vocation critique, dans l’enregistrement d’une réalité néocapitaliste mondialisée (ses 4×4, ses hôtels Hilton, ses pré-pubères en chaleur fans de Take That). Le tout dans un joyeux plurilinguisme babélico-bordélique, qui nous mène de residencia en retiro, d’aéroport (Tegel) en taxi, d’universitaires pisans sur une plage de Tibériade en macédoniens buvant du cognac à Alger. C’est tout le bric-à-brac culturel cosmopolite de nos sociétés qui apparaît alors, passant à travers les perceptions, le corps, la langue, les rencontres, les contradictions du poète, selon une méthode d’immersion chaotique jamais reniée. La dimension politique de sa poésie est à nouveau réaffirmée à travers l’incursion dans le territoire de la « poesia civile », là où le poète-sénateur (car l’acrobate a plus d’un tour dans son sac, et Sanguineti est aussi essayiste, traducteur, professeur, politicien), comme un Pétrarque ou un Leopardi de son temps, engage le « lecteur coélécteur » à libérer « cette serve Italie forzitaliénée », ce « pays bordélisé berlusconisé » par le « simple secours d’un bulletin sagace » (48). Et le clerc organique 2, l’intellectuel toujours gramscien de conclure :
cher camarade prolétaire,
je sais bien que le Quatrième état a presque perdu, chemin faisant,
sa conscience de classe, il y a de ça un moment (même si pas pour toujours, j’espère
bien) — et pas le Tiers état, parce que le bourgeois c’est le bourgeois, avec un esprit encore fortement
conscient de lui-même : et le capitalisme c’est le capitalisme (c’est le souverain — le suprême) :
(et il n’y a pas forcément une grande envie de communisme, là, maintenant, par ici) :
mais là
— là il faut voter, pour commencer, contre les libertés et leurs seigneuries : contre nos
servitudes et chaînes :
il faut les relever, tous ensemble, tombés dans cette boue,
à nouveau, ces quelques vieux drapeaux : (et nous réveiller, entre temps, à notre rêve) :
Pour l’Italie, on sait que cette année-là (1996) fut celle de l’élection de Prodi, mais on connaît aussi la suite jusqu’à aujourd’hui, sans un brin d’utopie.
Reste à saluer le travail à la fois précis et créatif des deux traducteurs-éditeurs (qu’on pourrait donc qualifier de passeurs organiques, sinon d’acrobates) pour ce volume soigné, mais surtout pensé jusqu’au format et à la mise en forme originale du recueil bilingue, où le lecteur italianophile pourra trouver, après la traduction française, l’intégralité du texte italien.
Marie Fabre
D.R. Texte Marie Fabre
pour Terres de femmes
_________
NOTES
1. Voir la célèbre recette de Postkarten (49). Le recueil fait partie des rares ouvrages traduits en français, aux éditions L’Âge d’Homme, 1990 (trad. Vincent Barras).
2. C’est le titre d’un recueil d’essais de Sanguineti : Il chierico organico, Scritture e intellettuali (Milan, Feltrinelli, 2000), lui-même tiré d’un article écrit par Sanguineti en 1988 sur « Gramsci et la figure de l’intellectuel organique ».

________
NOTE d’AP : ancienne élève de l’École normale supérieure (Lettres et Sciences humaines), Marie Fabre est agrégée d’italien. Après un « master 2 » à l’université de Bologne sur Italo Calvino et Elio Vittorini, elle a soutenu en décembre 2012 (sous la direction de Christophe Mileschi, à l’Université Stendhal – Grenoble 3) une thèse de doctorat sur les rapports entre utopie et littérature chez ces mêmes auteurs. Marie Fabre est aujourd’hui maître de conférences en études italiennes à l’École normale supérieure de Lyon.
|
![Accorder [...] son attente aux évocations des pierres Accorder [... son attente aux évocations des pierres](/wp-content/uploads/2025/09/6a00d8345167db69e201901e6a607f970b-320wi.jpg)