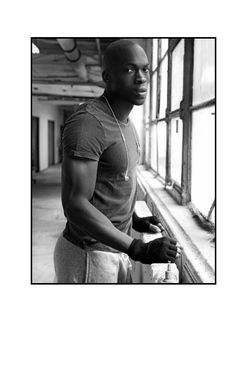Le
31 juillet 1784 meurt à Paris
Denis Diderot. Son corps est inhumé le 1
er août dans la chapelle de la Vierge de l’église Saint-Roch, dans le quartier Saint-Honoré à Paris.
 Image, G.AdC
Image, G.AdC
Dans ses Mémoires, Madame de Vandeul, la fille de Denis Diderot, raconte :
« Il se mit à table, mangea une soupe, du mouton bouilli et de la chicorée. Il prit un abricot ; ma mère voulut l’empêcher de manger ce fruit. “Mais quel diable veux-tu que cela me fasse ?” Il le mangea, appuya son coude sur la table pour manger quelques cerises en compote, toussa légèrement. Ma mère lui fit une question ; comme il gardait le silence, elle leva la tête, le regarda : il n’était plus. »
Très tôt fasciné par la diversité des choses et la dialectique qui naît des contradictions du monde, Diderot est engagé en 1746 par le libraire Le Breton comme traducteur-contrôleur de la Cyclopaedia de Chambers. La même année, en juin 1746, il publie sa première œuvre personnelle : les Pensées philosophiques sont condamnées le mois suivant par le Parlement de Paris. En juin 1747, le « misérable Diderot » est dénoncé au lieutenant de police Berryer par le lieutenant Perrault comme « homme très dangereux » et libertin. En octobre 1747, Diderot et D’Alembert prennent la direction de l’Encyclopédie. Parallèlement, Diderot rédige la Promenade du sceptique et Les Bijoux indiscrets.
LES BIJOUX INDISCRETS
Premier roman de Diderot, Les Bijoux indiscrets a d’abord paru en Hollande. Composé de cinquante-quatre chapitres, le roman fut rédigé en quinze jours. Ainsi en attestent les Mémoires de Madame de Vandeul qui confie aussi que son père avait besoin de cinquante louis pour couvrir les dépenses de sa maîtresse, Mme de Puisieux. Il s’agissait également pour Diderot de convaincre cette noble dame qu’il était tout à fait possible d’écrire un conte licencieux aussi excellemment que Crébillon fils, à condition de tenir « une idée plaisante, cheville de tout le reste. » C’est donc à la suite d’une dispute de société que l’on doit à Diderot d’avoir réalisé ce long roman qualifié de libertin mais qui se démarque néanmoins des codes du genre par le biais du pastiche. « L’idée plaisante », Diderot l’emprunte au fabliau Du Chevalier qui fist les cons parler, qui venait d’être adapté par le comte de Caylus (Charles de Caylus) sous le titre Nocrion, conte allobroge (ouvrage parfois attribué à François-Joachim de Pierre de Bernis et à Thomas-Simon Gueullette), Nocrion étant l’anagramme de « con noir ». Même si le sujet de l’ouvrage n’est pas très original, Les Bijoux indiscrets remporte immédiatement un très vif succès. Le roman est réédité plusieurs fois en l’espace de six mois, traduit en anglais en 1749, à nouveau réédité en 1756, 1772, 1786. Mais l’intérêt majeur du roman ― outre les « bigarrures » et chatoiements de son style, réside dans le fait qu’il contient en germe les thèmes et les idées philosophiques que l’auteur polygraphe ne tardera pas à développer dans la suite de son œuvre. Il faut cependant attendre 1798 pour que Les Bijoux indiscrets soit publié par Jacques-André Naigeon dans son intégralité. Il manquait en effet aux précédentes éditions les chapitres XVI, XVIII et XIX.
Diderot, regrettant plus tard de s’être adonné à l’écriture de ce roman polyphonique ― qui « joue de toute la gamme de la fiction contemporaine » ―, le qualifia de « grande sottise ». Cependant, on y trouve nombre de scènes cocasses et les personnages présents qui y sont confrontés, sont aisément identifiables. La brillante société « congolaise » n’est autre que celle de Paris et derrière les noms exotiques de Mangogul et de Mirzoza se cachent le roi Louis XV et sa maîtresse, Madame de Pompadour, dont la liaison avec le roi était connue depuis 1745.
Mangogul, sultan du Congo, s’ennuie. La présence de Mirzoza, sa favorite depuis si longtemps, ne lui est plus d’un grand secours. Pour le distraire, le génie Cucufa lui remet un anneau mystérieux à passer à son doigt en lui disant : « Toutes les femmes sur lesquelles vous en tournerez le chaton, raconteront leurs intrigues à voix haute, claire et intelligible : mais n’allez pas croire au moins que c’est par la bouche qu’elles parleront.
― Et par où donc, ventre saint-gris, s’écria Mangogul, parleront-elles donc ?
― Par la partie la plus franche qui soit en elles et la mieux instruite des choses que vous désirez savoir, dit Cucufa ; par leurs bijoux… »
CHAPITRE DIX-NEUVIÈME
De la figure des insulaires, et de la toilette des femmes, Extrait.
« Un jour, au sortir de table, mon hôte se jeta sur un sofa où il ne tarda pas à s’endormir, et j’accompagnai les dames dans leur appartement. Après avoir traversé plusieurs pièces, nous entrâmes dans un cabinet, grand et bien éclairé, au milieu duquel il y avait un clavecin. Madame s’assit, promena ses doigts sur le clavier, les yeux attachés sur l’intérieur de la caisse, et dit d’un air satisfait : Je le crois d’accord ; et moi, je me disais tout bas : Je crois qu’elle rêve ; car je n’avais point entendu de son… “Madame est musicienne, et sans doute elle accompagne ? ― Non. ― Qu’est-ce donc que cet instrument ? ― Vous l’allez voir.” Puis, se tournant vers ses filles : “Sonnez, dit-elle à l’aînée, pour mes femmes.” Il en vint trois, auxquelles elle tint à peu près ce discours : “Mesdemoiselles, je suis très mécontente de vous. Il y a plus de six mois que ni mes filles ni moi n’avons été mises avec goût. Cependant vous me dépensez un argent immense. Je vous ai donné les meilleurs maîtres ; et il semble que vous n’avez pas encore les premiers principes de l’harmonie. Je veux aujourd’hui que ma fontange soit verte et or. Trouvez-moi le reste.” La plus jeune pressa les touches, et fit sortir un rayon blanc, un jaune un cramoisi, un vert, d’une main, et de l’autre, un bleu et un violet. “Ce n’est pas cela, dit la maîtresse d’un ton impatient ; adoucissez-moi ces nuances.” La femme de chambre toucha de nouveau, blanc, citron, turc, ponceau, couleur de rose, aurore et noir. “Encore pis ! dit la maîtresse. Cela est à excéder. Faites le dessus. ” La femme de chambre obéit ; et il en résulta : blanc, orangé, bleu pâle, couleur de chair, soufre et gris. La maîtresse s’écria : “On n’y saurait plus tenir. ― Si madame voulait faire attention, dit une des deux autres femmes, qu’avec son grand panier et ses petites mules… ― Mais oui, cela pourrait aller…” Ensuite la dame passa dans un arrière-cabinet pour s’habiller dans cette modulation. Cependant l’aînée de ses filles priait la suivante de lui jouer un ajustement de fantaisie, ajoutant : “Je suis priée d’un bal ; et je me voudrais leste, singulière et brillante. Je suis lasse des couleurs pleines. ― Rien n’est plus aisé”, dit la suivante ; et elle toucha gris-de-perle, avec un clair-obscur qui ne ressemblait à rien ; et dit : “Voyez, mademoiselle, comme cela fera bien avec votre coiffure de la Chine, votre mantelet de plumes de paon, votre jupon céladon et or, vos bas cannelle, et vos souliers de jais ; surtout si vous vous coiffez en brun, avec votre aigrette de rubis. ― Tu veux trop, ma chère, répliqua la jeune fille. Viens toi-même exécuter tes idées.” Le tour de la cadette arriva ; la suivante qui restait lui dit : “Votre grande sœur va au bal ; mais vous, n’allez-vous pas au temple ? ― Précisément ; et c’est par cette raison que je veux que tu me touches quelque chose de fort coquet. ― Eh bien ! répondit la suivante, prenez votre robe de gaze couleur de feu, et je vais chercher le reste de l’accompagnement. Je n’y suis pas…, m’y voici… non… c’est cela… oui, c’est cela… vous serez à ravir… Voyez, mademoiselle : jaune, vert, noir, couleur de feu, azur, blanc et bleu ; cela fera à merveille avec vos boucles d’oreilles de topaze de Bohême, une nuance de rouge, deux assassins, trois croissants et sept mouches…” Ensuite elles sortirent, en me faisant une profonde révérence. Seul, je me disais : Elles sont aussi folles ici que chez nous. Ce clavecin épargne bien de la peine. »
Mirzoza, interrompant la lecture, dit au sultan : « Votre voyageur aurait bien dû nous apporter une ariette au moins d’ajustements notés, avec la basse chiffrée. » LE SULTAN : « C’est ce qu’il a fait. » MIRZOZA. « Et qui est-ce qui nous jouera cela ? » LE SULTAN : « Mais quelques uns des disciples du brame noir ; celui entre les mains duquel son instrument oculaire est resté. Mais en avez-vous assez ? » MIRZOZA : « Y en a-t-il encore beaucoup ? » LE SULTAN : « Non ; encore quelques pages, et vous en serez quitte… » MIRZOZA : « Lisez-les ».
« J’en étais là, dit mon journal, lorsque la porte du cabinet où la mère était entrée, s’ouvrit, et m’offrit une figure si étrangement déguisée, que je ne la reconnus pas. Sa coiffure pyramidale et ses mules en échasses l’avaient agrandie d’un pied et demi ; elle avait avec cela une palatine blanche, un mantelet orange, une robe de velours ras bleu pâle, un jupon couleur de chair, des bas soufre, et des mules petit-gris ; mais ce qui me frappa surtout, ce fut un panier pentagone, à angles saillants et rentrants, dont chacun portait une toise de projection. Vous eussiez dit que c’était un donjon ambulant, flanqué de cinq bastions. L’une des filles parut ensuite. “Miséricorde, s’écria la mère ; qui est-ce qui vous a ajustée de la sorte ? Resterez-vous… ! vous me faites horreur. Si l’heure du bal n’était pas si proche, je vous ferais déshabiller. J’espère du moins que vous vous masquerez.” Puis, s’adressant à la cadette : « Pour cela, dit-elle, en la parcourant de la tête aux pieds, voilà qui est raisonnable et décent. » Cependant monsieur, qui avait aussi fait sa toilette après sa médianoche, se montra avec un chapeau couleur de feuille morte, sous lequel s’étendait une longue perruque en volutes, un habit de drap à double broche, avec des parements en carré longs, d’un pied et demi chacun ; cinq boutons par devant, quatre poches, mais point de plis ni de paniers ; une culotte et des bas chamois, des souliers de maroquin vert ; le tout tenant ensemble, et formant un pantalon. »
Ici Mangogul s’arrêta et dit à Mirzoza, qui se tenait les côtés : « Ces insulaires vous paraissent fort ridicules… » Mirzoza, lui coupant la parole, ajouta : « Je vous dispense du reste ; pour cette fois, sultan, vous avez raison ; que ce soit, je vous prie, sans tirer à conséquence. Si vous vous avisez de devenir raisonnable, tout est perdu. Il est sûr que nous paraîtrions aussi bizarres à ces insulaires, qu’ils nous le paraissent ; et qu’en fait de modes, ce sont les fous qui donnent la loi aux sages, les courtisanes qui la donnent aux honnêtes femmes, et qu’on n’a rien de mieux à faire que de la suivre. Nous rions en voyant les portraits de nos aïeux, sans penser que nos neveux riront en voyant les nôtres… »
Denis Diderot, Les Bijoux indiscrets in Contes et romans, Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, 2004, pp. 60-61-62-63.