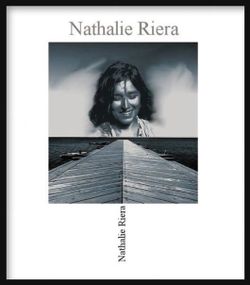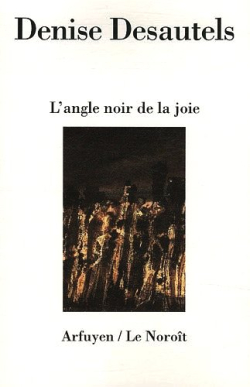Le
18 juin 1964 meurt à Bologne, sa ville natale,
Giorgio Morandi.
Né le
20 juillet 1890, Giorgio Morandi fait ses armes de peintre et de graveur par la fréquentation de maîtres tels que Giotto et Piero della Francesca ; puis de Chardin, de Corot et de Cézanne. Diplômé des Beaux-arts de Bologne en 1913, Morandi est révélé au grand public lors de la Biennale de Venise de 1928. Vingt ans plus tard, en 1948, Morandi reçoit le Premier Prix de peinture à la même Biennale de Venise. Le peintre connaît dès lors un succès international et ses œuvres font le tour du monde.
L’essentiel de l’œuvre de Morandi tourne autour de quelques sujets de prédilection qu’il explore ― paysages, natures mortes et fleurs – et auxquels il a consacré son art et sa réflexion.

Giorgio Morandi, Natura morta, 1959
aquarelle sur papier, 27 x 37 cm
Bologne, Musée Morandi
Source
PHILIPPE JACCOTTET, LE BOL DU PÈLERIN (MORANDI), extrait
Comme je refeuillette maintenant le catalogue de l’exposition d’aquarelles présentée à Florence, au Palais Medici-Riccardi, en 1991*, mon admiration croît, de page en page, jusqu’à une sorte de stupeur ; cet art en sourdine, cet art du presque rien, paradoxalement, me porte à l’acclamation. De page en page, c’est-à-dire, plus ou moins précisément, d’année en année, de mois en mois, on a l’impression de monter de plus en plus haut, vers une cime. Et les premiers mots qui viennent à l’esprit pour qualifier ces feuillets seront « noblesse », « élégance », « altitude » : je n’en peux mais.
À cause de ce mouvement de montée, de ces paliers successifs, j’ai tout naturellement pensé à Dante, aux chants du Purgatoire et du Paradis ; ce qui ne signifie pas, faut-il le dire ? que je compare ces œuvres, encore moins que je veuille hisser Morandi à côté de Dante dans un nouveau Parnasse, ce qui serait absurde.
Mais il s’est tout de même fait dans mon esprit un rapprochement plus précis, sinon plus légitime. À cause d’une phrase qui y flottait du critique Cesare Brandi notant que, dans la peinture de Morandi, les choses semblent venir à nous du fond de l’espace comme les souvenirs remontent du fond du temps et précisant : « Comme ce point au loin sur la mer qui devient peu à peu un vaisseau… » Du coup, je n’ai pas pu ne pas me rappeler le moment prodigieux, au chant II du Purgatoire, de l’arrivée, par mer, de l’ange nocher, dans une accélération fulgurante de la lumière :
Or comme on voit, saisi par le matin,
Mars rougeoyer dans les vapeurs épaisses,
vers le couchant, sur la plaine marine,
telle m’apparut, et je la vois encore,
une lumière venant si vite sur la mer
que nul vol n’est égal à sa course.
Quand j’eus un peu détourné mes yeux d’elle,
afin d’interroger mon guide,
je la revis plus brillante et plus grande.
Puis j’aperçus, tout autour d’elle,
je ne sais quoi de blanc, et peu à peu,
un autre blanc en sortit par-dessous.
Mon maître encore ne disait rien,
quand les blancheurs premières apparurent des ailes ;
mais lorsqu’il reconnut le nautonnier,
il cria : « Fléchis, fléchis donc les genoux.
Voici l’ange de Dieu ; joins les mains ;
tu verras désormais des officiers semblables.
Il dédaigne, tu vous, les instruments humains ;
il ne veut pas de rame, ni d’autre voile
que ses ailes, entre des rives si lointaines.
Tu vois comme il les dresse vers le ciel,
frappant l’air avec ses plumes éternelles,
qui ne changent pas comme poil terrestre. »**
Or, si excessif que cela doive paraître, ces premiers « blancs » qui se révèlent des ailes, je les avais vus dans certaines aquarelles de 1959 où on ne sait plus s’ils sont de hautes bouteilles blanches ou des intervalles, des lacunes qui se dresseraient, précisément, comme une paire d’ailes sans taches…
Accueillons ce rapprochement comme un nuage qui traverserait l’esprit de sa candeur et disparaîtrait en n’y laissant qu’à peine une trace et une indication.
D’une certaine manière, au demeurant, si la lecture de Dante nous exalte, au sens propre du mot, on pourrait dire que cela n’a rien d’extraordinaire ; et que, si elle y manquait, le poète aurait été inférieur à sa tâche.
Or, nulle Béatrice n’aimante le regard et la main de Morandi ; et l’on ne peut sérieusement vouloir retrouver dans son œuvre aucun ange « frappant l’air avec ses plumes éternelles ». N’empêche : cette impression de montée, indéniable quand on observe l’évolution de l’œuvre, si elle ne nous leurre pas, comment la comprendre ? Et n’assiste-t-on pas tout de même, à partir de ces choses presque insignifiantes, de ces sempiternels vases, brocs et bouteilles, à une espèce d’ascension, voire d’assomption qui ne semblerait vraie et ne nous parlerait que, justement, parce que ce ne sont plus des ailes d’ange, ni la danse et le rire d’aucune Mathilde qui l’annoncent et la préparent ?
Philippe Jaccottet, Le Bol du pèlerin (Morandi), La Dogana, 2006, pp. 69-70-71-72-74.
* Marilena Pasquali, Morandi, Acquerelli, Catalogo generale [Firenze, Museo Mediceo: Palazzo Medici Riccardi, 16 maggio – 30 giugno 1991], Mondadori Electa, Milano, 1991.
** Dante, Purgatoire, Chant II, vers 13-36, Flammarion, Paris, 1988. Traduction de Jacqueline Risset.