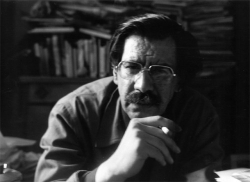Ph., G.AdC
« DE L’EAU COULE TOUT BAS »
Ph., G.AdC
« DE L’EAU COULE TOUT BAS »
[…], le corps est prêt
dans son abandon, mais sans relâche elle veille,
depuis le haut de son visage, ou le visage entier.
Dans ce recueil, le premier de Marie-Hélène Archambeaud, une voix de fin silence nous conduit jusqu’à la source intérieure où s’avère le pouvoir de métamorphose qui est la poésie même. En ce point très secret, l’abandon rejoint la vigilance la plus subtile. Dans ces pages,
de l’eau coule tout bas ; elle requiert l’attention d’une écoute plus lointaine et plus proche à la fois, une écoute qui nous rappelle à un autre âge : âge d’or où la royauté revient à l’enfant
1, à son
visage entier comme à une unité où la générosité de la langue maternelle (le suédois) rejoindrait le monde en devenir, « les petits bruits d’oiseaux » (04.06) pour les rassembler en un unique chant :
Les trains venant de loin comme un hommage à
la vie retrouvée
*
Ici, la vie retrouvée des sensations, des joies de l’enfance, du pays natal (la confiture de roses, le lait chaud, les fruits d’hiver, les robes blanches…) est aussi celle d’une communion à la nature
2 et à autrui à travers le regard :
Juste à nous regarder. Qui nous étions. Car un même désir habite les poèmes de Marie-Hélène Archambeaud : celui d’une plénitude
(l’image si douce m’est revenue d’une femme enceinte moulée dans le sable d’une plage), celui d’une union des corps
(quand il referme son bras sur moi je m’enfonce plus profond), d’une harmonie avec les éléments :
Oui, seule. / Dans un rêve de soleil et de mer (01.04).
De ce point de vue, on devine des accents rimbaldiens dans cette poésie. On pense à « Sensation » ou à « Soleil et chair » où le jeune Rimbaud exprime cette quête érotique d’union à la nature : « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : / Mais l’amour infini me montera dans l’âme… » (« Sensation », mars 1870). Comme lui, Marie-Hélène Archambeaud « s’abandonne » à la plénitude sensible et laisse monter en son âme la joie spacieuse. Emplie par un désir de surabondance, par des obsessions de gonflement et de débordement (20.01 ; 27.01 ; 27.11), elle est aussi travaillée par une secrète peur : la peur d’un temps qui défigure ces contours, qui brise l’unité et nous confronte à la blessure de la perte, et à l’enfermement :
[…] Mais le pigeon l’appât qui
battait craintivement des ailes était piégé, toute
blanche – une colombe c’en était plus de cruauté. 3
Prise en cette tension entre l’aspiration à la plénitude et la pesanteur du monde, Marie-Hélène Archambeaud cherche son identité dans un monde fragmenté : « Je tâtonne aussi dans le noir. » (18.01), car elle sait « la forêt perdue » (01.02) Rimbaud lui-même ne parlait-il pas, dans
Poésies, des « rousseurs amères de l’amour » ?
Les fleurs encore blanches, droites et rouges mais
l’eau croupie sentait,
même au bout de peu de temps. (15.08)
Celle qui écrit ces vers affirme une conscience nostalgique : elle est aussi loin d’une enfance du monde, avec ses mythes, qu’elle se sent loin de la sienne propre (30.06) ; elle s’en trouve comme plus lucide et plus fragile (
Läcker, délicate 4), aux prises avec une secrète déchirure, elle lutte contre ses peurs. Et c’est en cette blessure si proche du soleil qu’elle va trouver sa force : celle d’écrire, de risquer une plongée intérieure dans la source de l’être :
Je voudrais nager sous la peau de glace la rivière
couler plus vite (29.08)
Et c’est ce risque même qui sauve du « tragique », car il permet de dépasser la peur, de consentir à la grâce de la transformation ainsi que l’ultime poème de ce recueil l’exprime : « Quand libérée de cette peur comme une ancienne peau tombera. » (01.11) Il est alors possible de nager « vers d’autres nébuleuses » (voir l’exergue d’Apollinaire, extrait d’
Alcools, au début du recueil), vers ce pays de tous les possibles qui est l’immense promesse d’une naissance à soi, à la maturité de son être :
Elle ne dit jamais « je », mais elle dit ce qu’elle
pense après l’avoir longtemps gardé. (28.07)
Mais si loin que soient ces deux enfances, elles ne sont pas tout à fait perdues, puisque la mémoire en garde trace, de même que l’on peut recueillir les éléments épars du présent (29.07 ; 27.01), les lier en gerbe dans cette lumière de nostalgie :
Vacker som en tavla, belle comme un tableau
disait Morfar, mon grand père suédois.
Belle à regarder, mais le visage calme et
peut-être comme dans l’immobilité d’un regard,
qui vient d’elle vers nous. (30.08)
Il y a la distance du temps ; il en est d’autres, apparemment infranchissables, entre la poétesse et les choses (26.02 ; 01.03), ou entre la poète et ses « autres vies » (27.11), mais là encore, on peut « quelque chose » : « Et la présence était claire comme un (grand) cil. » (21.09). Les images de Marie-Hélène Archambeaud sont alors moins choisies que données par une certaine orientation de sa vigilance à l’intimité du réel : chacune se lit comme une délivrance (26.10 ; 28.07).
Le travail de la mémoire devient ainsi libérateur : par une voix qui ne trompe pas, n’enchante pas et qui s’éloigne de toute sensiblerie, Marie-Hélène Archambeaud pénètre dans le dédale des souvenirs où la mélodie s’interrompt, où l’orchestre (ses assonances, ses allitérations) fait entendre le son de chaque instrument par éclats successifs ou associés (15.01 ; 29.07). Ici, il faut faire silence, car « de l’eau coule tout bas ». Comment ne pas penser à Marcel Proust qui, à la faveur d’une sensation, entreprend lui aussi un voyage dans la mémoire : « …et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s’élever, quelque chose qu’on aurait désancré, à une grande profondeur ; je ne sais ce que c’est, mais cela monte lentement ; j’éprouve la résistance et j’entends la rumeur des distances traversées
5. »
Écouter les vers de Marie-Hélène Archambeaud requiert l’attention au plus discret, à cette part de lumière intime où l’incarnation se vit comme une grâce de transfiguration sans cesse renouvelée : une « fraîcheur » qui, toujours déjà là, est aussi commencement – celui d’une délivrance, d’un élargissement, l’indication d’une ouverture plus grande à soi et au monde :
Le froid sur mes jambes, je sens qu’il vient de la
fenêtre, comme en Suède des bruits dehors, me
rappelle qu’à la chaleur du bol, de mon lait chaud
succédera de loin comme depuis toujours,
à chaque fois que j’y reviens, reconnaissante,
une fraîcheur. (28.08)
Dans l’instant de la sensation, un chemin s’ouvre : une
fraîcheur vécue comme une nouvelle naissance.
Comme une ancienne peau tombera annonce le titre du recueil. Car ici les poèmes disent l’expérience d’une mue : celle de la voix de la poète qui, telle un papillon, sort de sa chrysalide, pour prendre son envol.
*
Aussi la voix de Marie-Hélène Archambeaud est-elle empreinte de cette mélancolie qui lui donne son timbre propre. Ses poèmes nous plongent au cœur d’une expérience intérieure du temps et de l’autre (de ce
je qui est
un autre), avec une syntaxe syncopée, un effacement de toute référence qui nous conduit, par-delà notre compréhension habituelle de la poésie, à un langage dépossédé de ses peaux, à cette voix nue qui serait alors comme l’éternité retrouvée de Rimbaud : « la mer allée au soleil » (« L’Éternité »). « Comme une ancienne peau tombera » signe un mouvement d’offrande caché au fond des choses, un geste secret, ou l’œil à notre rencontre (21.09), l’odeur dans les cheveux ou la poitrine d’un homme (03.08). Cette espérance de la rencontre à soi-même comme à l’autre porte tout ce recueil avec une modestie de ton, une justesse, mais aussi une tendresse (sans ombre de mièvrerie). Marie-Hélène Archambeaud inscrit son regard dans la réalité sensible tout en l’ouvrant à un ciel plus vaste qu’elle-même.
Isabelle Raviolo
D.R. Texte Isabelle Raviolo, Paris, juin 2011
__________________
1. Héraclite, fragment LII.
2. On pense alors à ces paysages suédois où la terre s’allie à l’eau, celle de la mer, mais aussi celle des lacs et des rivières.
3. Cf. 16.10 (Gédéon) : « mais tout autour était sec. »
4. Elle, 21 MAI 20..
5. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, in À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 1992, p. 50.