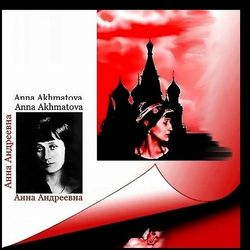Jean-Baptiste Isabey (1767-1865)
Jean-Baptiste Isabey (1767-1865)
Portrait de Madame de Staël à trente ans, 1797
Crayon noir, estompe, 20,3 x 14,4 cm
Paris, Musée du Louvre
Source
« JE SUIS LA FILLE DE M. NECKER »
Née le 22 avril 1766, rue de Cléry, à Paris, Anne Louise Germaine Necker avait huit ans lorsque Louis XVI fut couronné et vingt-six au moment où tomba la tête de Louis Capet. C’est dire qu’elle a déroulé ses années d’enfance et de jeunesse au crépuscule de l’Ancien Régime et au cœur de la Révolution. Mais ce fut à partir d’un double observatoire dont personne d’autre ne pouvait se prévaloir : à la fois depuis le salon des Lumières que tenait sa mère et depuis, au moins pour une saison — mais une saison incandescente —, le ministère des Finances dont son père, Jacques Necker, était le titulaire, véritable Premier ministre, porté aux nues avant d’être disgracié.
Elle fut d’abord la fille de sa mère, Mme Necker, née Suzanne Curchod, qui avait des idées très précises sur l’éducation des filles, et particulièrement sur celle de sa fille unique, qu’on appelait alors Louise. Fille d’un pasteur exerçant à Crassier, près de Lausanne, tôt orpheline, elle était réduite à la pauvreté. Elle avait cependant une excellente instruction, savait lire et écrire en latin, détenait des rudiments de sciences, jouait du clavecin et avait une certaine habileté pour l’aquarelle. Cette blonde aux yeux bleus avait de surcroît une beauté qui attirait les jeunes gens du voisinage, et mieux encore ceux de Lausanne où elle se produisait dans un cercle d’admirateurs. Un projet de mariage avait été ébauché avec l’historien anglais Edward Gibbon, qui était du même âge qu’elle, et qui avait été touché par les grâces de son esprit et de son visage : « Je la vis et je l’aimai », dira-t-il en parlant d’elle. Le projet resta sans suite, Gibbon alléguant le refus de son père.
Suzanne Curchod ne manquait pas de protecteurs, en particulier le pasteur Moultou, fils d’un réfugié français, qui devait rester son ami, et aussi des femmes distinguées venues s’installer sur les bords du Léman pour consulter un médecin réputé, le docteur Tronchin. C’est la rencontre avec Mme Vermenoux à Genève qui décida de son sort. Veuve, jolie, sa protectrice avait connu Suzanne par l’intermédiaire de Moultou ; s’était intéressée à elle et lui avait proposé de l’emmener à Paris comme demoiselle de compagnie. Pleine d’attraits, Mme Vermenoux exerçait son pouvoir de séduction qui n’avait pas épargné Jacques Necker, une de ses relations, prêt à lui demander sa main. Ses assiduités étant restées sans succès, Necker se consola en demandant en mariage la demoiselle de compagnie, qui accepta sans hésiter. Mariés sous l’enseigne de la raison consolante, Jacques et Suzanne s’aimèrent d’amour et formèrent un couple d’une fidélité partagée et à toute épreuve. « Des tourterelles qui ne se quittèrent jamais », écrira leur fille […]
Dès l’âge de cinq ans, « Minette », comme ses parents appelaient leur fille, est admise au salon, sur un tabouret près de sa mère. Elle écoute les philosophes, retient leurs formules, et, très vite, se plaît à répondre à leurs remarques quand ils s’adressent à cette petite qui leur paraît si bien douée. Parmi les habitués, l’enfant prodige écoute le spirituel Melchior Grimm, écrivain allemand ami des encyclopédistes et dont la
Correspondance littéraire est un précieux témoignage sur la vie parisienne ; Marmontel, auteur des
Contes moraux et encyclopédiste, dont les lettres à Mme Necker sont pleines d’effusion et d’adulation, l’abbé Morellet, auteur d’articles sur la religion dans l’
Encyclopédie ; le célèbre d’Alembert, philosophe et grand mathématicien, fils naturel de Mme de Tencin, un des piliers des autres salons avant la mort de Julie de Lespinasse (en 1776) et celle de Mme Geoffrin (1777) ; le littérateur Thomas ; l’académicien Suard ; le grand savant Buffon, qui résidait à Montbard mais ne ratait pas une occasion, lors de ses venues à Paris pour son Jardin du roi, de manifester de près à Mme Necker la tendresse qu’il lui prodiguait de loin dans ses lettres ; et puis Diderot, parlant à Sophie Volland d’« une femme qui possède tout ce que la pureté d’une âme angélique ajoute à la finesse du goût ». Mme de Staël fut élevée au Collège de France […]
En 1778, pâlotte, tour à tour languide et surexcitée, Germaine doit quitter l’hôtel parisien de ses parents, rue de la Chaussée-d’Antin, pour vivre hors de la capitale, sur le conseil du fameux docteur Tronchin. Necker avait acquis une maison de campagne à Saint-Ouen ; les parents y installent « Minette » avec une gouvernante, une bonne et une femme de chambre. Le bon air fera le reste, car très vite la santé de la petite s’améliore. Contre la solitude, Madame Mère avait ménagé à sa fille une compagnie en la personne de son professeur de clavecin, Catherine Huber, une Genevoise, protestante comme il se doit. Les premières lettres de Germaine de Staël datent de cette époque ; elles sont au nombre de sept, toutes adressées à sa mère. À les lire, on est frappé par sa maîtrise de la langue et son goût pour l’exaltation des sentiments, où l’on subodore l’influence de
La Nouvelle Héloïse :
« Quelle que soit ma joie, écrit-elle ainsi, lorsque j’ai de vos nouvelles, je ne puis désirer de recevoir plus souvent de vos lettres. N’en dois-je pas sentir tout le prix ? Je les baise cent fois. Ah ! Ma chère maman, ces moments se perpétuent pour moi, lorsque vous passez une demi-heure à m’écrire, ces moments se perpétuent pour moi et me rendent heureuse jusqu’au moment où je vous vois, et je puise dans vos yeux une nouvelle source de bonheur. Mais quelle sera mon ivresse lorsque je retournerai près de vous, que je serai sous les ailes de la meilleure de toutes les mères, que son exemple sera pour moi la plus excellente de toutes les leçons ! Ma joie n’aura plus de bornes, et je dirai bien du fond de mon cœur que les moments que je passerai près de vous, et de mon papa, seront les seuls heureux de ma vie. Jamais, ma chère maman, quelle que soit ma destinée, je ne trouverai de bonheur aussi pur que celui que je goûte maintenant ; en grandissant j’obéirai à un nouveau maître et je n’aurai jamais pour lui le quart de la tendresse que j’ai pour vous. »
Mme Necker s’émeut un peu des expressions exagérées de sa fille, et lui conseille le
moderato. Peut-être sent-elle aussi au cours de ce séjour à Saint-Ouen que son influence sur sa fille est en passe d’être éclipsée par l’influence paternelle.
Michel Winock, Madame de Staël, Éditions Fayard, 2010, pp. 15-16-18-19.