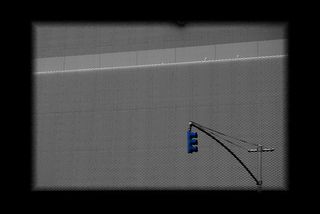Ph., G.AdC
SOMBRER DANS LE BLEU
D
Ph., G.AdC
SOMBRER DANS LE BLEU
Dans une lettre du 30 avril 1926, Virginia Woolf écrit : « Hier j’ai fini la première partie de
La Promenade au phare et j’ai commencé la seconde aujourd’hui. Je n’arrive pas à ce que je veux. J’en suis au passage le plus difficile, le plus abstrait. Je dois exprimer une maison vide ; pas de personnages humains, le passage du temps, tout cela sans yeux, sans traits, et rien à quoi se raccrocher ; eh bien je m’y précipite et tout aussitôt je noircis deux pages. » *
Ce « passage le plus difficile, le plus abstrait », cette partie médiane du roman dans lequel Virginia Woolf vient de s’engouffrer, un an après la publication de
Mrs. Dalloway, c’est
Le temps passe. Achevé en mai 1926 et considéré par l’auteur de
La Promenade au phare comme une nouvelle à part entière, le récit en neuf chapitres du
Temps passe a été traduit pour la première fois en français par Charles Mauron, et publié dans le Cahier X daté « Hiver 1926 » de la revue
Commerce (revue littéraire fondée en 1924 par la Princesse di Bassiano).
Livre sur le vide, vacuité de l’espace et vacuité du temps, uniquement occupé du mouvement envahissant de la vague,
Le temps passe s’ouvre sur les pages visionnaires du retour au chaos initial. Une chape d’obscurité tombe en cataracte sur le monde, l’envahit, le pénètre, s’insinue, s’infiltre par les moindres interstices, engloutit formes et objets, se focalise au cœur des choses. De cosmique, l’univers se miniaturise. Le tourbillon cataclysmique plonge, par resserrement de focale, de l’infiniment grand à l’infiniment petit, de l’extérieur vers l’intérieur, balayant tout sur son passage. Et effaçant, au gré de la progression des ombres, jusqu’à la distinction des sexes. De ce chaos d’avant la genèse surgissent des corps fantomatiques et asexués. Leur apparition au cœur de « la ténèbre » peuple soudainement la « maison vide », désertée depuis nombre d’années et réveillée d’un profond sommeil par leur sarabande effrontée.
Que s’est-il passé en amont du chaos ? Une vie a existé. Une famille et tout son entourage ont occupé jadis la vaste demeure au bord de la mer, l’ont investie de rires et de saisons. Mrs. Ramsay, Mr. Andrew, Miss Prue, la cuisinière Mildred ou Marian ― personnages de
La Promenade au phare ― font une brève apparition dans la mémoire de Mrs. McNab, puis retombent, informes, anéantis dans la mort d’où ils ont été tirés au gré des caprices du souvenir.
Visionnaire, Virginia Woolf fait revivre le néant, l’anime de « souffles épars » et « espions ». La vaste demeure, en proie aux pleurs et aux gémissements, devient le théâtre d’ombres errantes qui s’unissent pour faire entendre leurs lamentations. Un instant dépoussiérés par le passage des ombres, les objets révèlent, dans leurs craquelures et leur jaunissement, le passage du temps. Puis retombent, fanés et désœuvrés, dans leur inanité première. Pendant ce temps, le fracas des vagues bat son plein. Il rythme cet univers dantesque, soumis à la confusion des eaux du ciel et des eaux de la mer. L’élan épique se propage, gagne la nuit dans une forme personnifiée, proche de la prosopopée.
« Les vagues qui se brisent semblaient être le geste même de la nuit : elle secoue la tête et désespérément en laisse tomber la ténèbre, et médite, et gémit, comme pour pleurer le destin qui a noyé la terre… »
Il faut cependant attendre le chapitre IV pour voir surgir, au plein battant de cette tourmente, le personnage inattendu et vacillant de Mrs. McNab. L’antique domestique de la demeure, abandonnée elle aussi à la vieillerie de sa carcasse. « Silhouette oscillante » armée de balais et de frénésie nettoyeuse, « édentée, embonnetée », la vieille Mrs. McNab est la métaphore incarnée de la tempête et des vagues qui assaillent la maison, en même temps que de la décrépitude généralisée des objets qui l’habitent.
« Tandis qu’elle allait roulant (car elle donnait de la bande comme un navire en mer) et lorgnant (car ses yeux ne tombaient sur rien directement, mais par un regard de côté qui conjurait le mépris et la colère du monde ― elle manquait d’esprit, elle le savait), cependant qu’elle s’accrochait à la rampe et se halait le long de l’escalier, cependant qu’elle roulait de pièce en pièce, elle chantait… »
Suit un portrait indirect de Mrs. McNab, une présentation déformée par le point de vue décentré qui s’attache à sa personne. Pour accéder au personnage paradoxal de la domestique, il faut en passer par le prisme du mystique et du visionnaire, ces esprits éclairés avec lesquels Mrs. McNab n’a rien en commun. La vérité sur le mystère de la nature et les sentiments qu’ils inspirent aux « esprits hauts », sont hors de sa portée. Et Mrs. McNab, bien que « piétinée dans la boue pendant des générations » peut continuer sans trop d’angoisse existentielle à chanter ses chansons stupides tout en s’activant à ses tâches inutiles. Pendant ce temps, avec la pénétration des souffles de l’été, la maison et ses objets sortent provisoirement de leur silence, puis retombent dans l’abandon où ils étaient tenus.
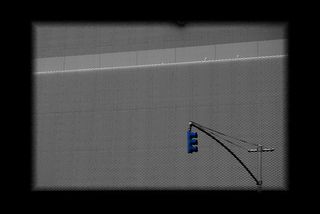 Ph., G.AdC
Ph., G.AdC
« Réflexion sur la fuite du temps et son effet sur la signification des choses »,
Le temps passe est « une plongée directe, à corps perdu, dans dix années de désagrégation. » De cette interrogation obsédante naissent les pages sublimes qui composent cette nouvelle, puissamment arrimée aux questionnements sur la nature et sur les rapports symbiotiques que l’homme entretient avec elle :
« Pourquoi nous envelopper dans la beauté de la mer, pourquoi nous consoler de la lamentation des vagues qui se brisent, si en vérité nous ne filons ce vêtement que de terreur, si nous ne tissons cet habit que pour le néant ? »
Peut-être faut-il accepter de « sombrer dans la nuit, sombrer dans le bleu, et se résigner, et oublier… » Comment ne pas trembler en lisant cette phrase, qui préfigure en filigrane la décision ultime de Virginia Woolf ?
Angèle Paoli
D.R. Texte angèlepaoli
_________________________________
* Virginia Woolf, Journal d’un écrivain, Christian Bourgois Éditeur, 10|18, 2000, page 148.